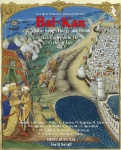01/04/2014
Un talent particulier
 Joseph Kessel, La paresse, Les éditions du Sonneur, 2013
Joseph Kessel, La paresse, Les éditions du Sonneur, 2013
Les éditions du Sonneur publient régulièrement dans leur « petite collection » des textes au format réduit mais à la teneur dense (voir par exemple ceux de Jeremiah N. Reynolds, William Wilkie Collins, Willa Cather, Victor Hugo ou Émile Littré – liens ci-dessous).
La paresse, extrait des Sept péchés capitaux de Joseph Kessel (1929), est un délicieux voyage sous les différentes latitudes de ce que l’auteur nous décrit comme l’une des grandes qualités humaines, à conditions qu’on la pratique « résolument, sans pudeur ni regret » – comme cela peut se faire lors des grandes traversées en bateau…
Les Russes, trop passionnés, et les Américains, trop énergiques (excepté quelques habitants d’Honolulu), ne connaissent pas le bonheur de la paresse ; mais les coolies chinois, oui ! Et bien d’autres encore. Avec Kessel, nous suivons un itinéraire mondial du bien-être, et côtoyons en des pays lointains des groupes cosmopolites et des individus pittoresques, dans l’après-guerre de 14-18 – avec comme unique critère l’aptitude au loisir intérieur. Et qu’on se le dise : « On ne devient point paresseux. On naît avec la grâce. Il y faut du don, du talent. ».
Jean-Pierre Longre
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2014/01/05/chasse-...
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2012/05/10/le-rien...
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/12/12/allumer...
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/07/28/le-labe...
15:02 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, joseph kessel, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/02/2014
Métamorphose de la bande dessinée
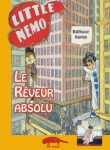
Balthazar Kaplan, Little Nemo, le rêveur absolu, Ab irato, 2014
Winsor McCay (1869-1934) est un pionnier, et son Little Nemo in Slumberland, créé en septembre 1905, publié en feuilleton à partir de cette date, renouvelle radicalement l’esthétique de la bande dessinée, en en faisant un genre à part entière, distinct du récit illustré. Cela, Balthazar Kaplan le rappelle, bien sûr, mais ne s’en contente pas : il analyse aussi d’une manière explicite et détaillée, quasiment exhaustive, ce qu’il faut savoir sur une œuvre que l’on peut considérer comme la première bande dessinée moderne.
En deux grandes parties, « Préambule au rêve » et « Au cœur du rêve », l’exploration du monde imaginaire de Little Nemo se fait de plus en plus incisive, de plus en plus pénétrante. Il y a, comme il se doit, l’ancrage dans une Histoire, l’héritage culturel – Jules Verne, Lewis Carroll, Andersen, les mythes populaires… Il y a l’humour, lié aux dysfonctionnements et aux transformations, l’onirisme évidemment, puisque les rêves et la fantaisie, le merveilleux et le monstrueux, l’illusion et la théâtralité sont autant de ressorts de la fiction.
Mais Little Nemo ne donne pas prise aux simplifications. Si l’imaginaire en est une constante, il cohabite avec le réel, en une subtile dialectique ; de même pour ce qui est de celle qui commande les relations entre « construction » et « perturbation » du monde. « Rien n’est stable, tout se transforme – être, chose, lieu », écrit l’auteur. Ajoutons à ces considérations celles qui concernent le dessin, toujours en mouvement (lignes et couleurs). Car « ce qui est fascinant avec McCay est qu’il ait si tôt et si vite compris les possibilités de la bande dessinée ». Le « génie » du dessinateur réside, entre autres, dans le jeu sur les cadres et sur les planches elles-mêmes, qu’il envisage d’une manière globale.
Faute d’entrer dans les détails de cette étude, disons qu’elle est à la fois savante et accessible, complète et éclairante, et que les illustrations (planches entières ou détails de dessins) qui la ponctuent, outre le rôle de preuves qu’elles jouent régulièrement, accentuent le plaisir de la lecture.
Jean-Pierre Longre
http://abiratoeditions.wordpress.com
Voir aussi Little Nemo 1905-2005, un siècle de rêves, album collectif, Les Impressions nouvelles : http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/little-n...
09:26 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, bande dessinée, francophone, anglophone, winsormccay, balthazar kaplan, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/01/2014
« La mélancolie partagée »
Bal.Kan, Miel et Sang, Les Cycles de la Vie, Voix de la Mémoire. Hesperion XXI, Jordi Savall. Livre-disque, AliaVox, 2013
La péninsule balkanique, on le sait, est un puzzle dont les fragments qui au cours de l’histoire se sont formés, déformés, reformés s’emboîtent plus ou moins bien selon les époques, en fonction des options politiques, religieuses, linguistiques, culturelles. Cette diversité, qui tout récemment encore fut ferment de tragédies, est aussi un atout que l’objet esthétique intitulé Bal.kan, Miel et Sang met magistralement en valeur.
Sur une idée originale que Montserrat Figueras put présenter et développer avant sa disparition en novembre 2011, Jordi Savall a réuni des musiciens de tous les pays de la région interprétant des morceaux venant eux aussi de tous horizons (Macédoine, Hongrie, Serbie, Roumanie, Grèce, Bosnie, Turquie, Arménie, sans oublier les musiques tsiganes et sépharades). Voix et instruments traditionnels se mêlent, se succèdent, suscitant larmes et rires, rêveries et danses, une harmonie singulière et indéfinissable dont l’unité est inséparable de la diversité sonore, entre Orient et Méditerranée.
En trois CD de haute qualité, six chapitres musicaux suivent un cheminement temporel fidèle à la succession des saisons (Création : univers, rencontres et désirs. Printemps : naissance, rêves et célébrations. Été : rencontres, amour et mariage. Automne : mémoire, maturité et voyage. Hiver : spiritualité, sacrifice, exil et mort. (Ré)conciliation). Un découpage qui n’a rien de hasardeux, rien d’artificiel, puisqu’il correspond aux cycles de la vie, obéissant aux « voix de la mémoire » dont Jordi Savall, dans son introduction, développe l’idée en insistant sur les portées humaine, civilisatrice, créatrice de la musique, de cette musique qui, ici, sonne sur tous les registres : joyeux, nostalgique, tendre, rebelle, pathétique, violent, doux…
Il y a la musique et, pour l’occasion, il y a le livre (en français, anglais, castillan, catalan, allemand, italien, bulgare, grec, hongrois, roumain, serbe, turc), dont les textes de Jordi Savall, Manuel Forcano, Tatjana Marcović, Jean-Arnault Dérens, Paolo Rumiz et Sergi Grau Torras dressent un panorama historique, géographique, artistique, humain de ces Balkans aux multiples cultures, où coulent « le miel et le sang » (puisque ces deux mots traduisent la double signification du nom Bal/Kan). Le tout est complété par de belles illustrations (cartes historiques, portraits des musiciens, images anciennes), par une chronologie précise du passé mouvementé de la région, par les paroles des chants… Bref, nous avons bien affaire à un objet esthétique complet, dominé certes par la présence essentielle de la musique, mais qui parle à l’être entier, aux sens, à l’âme, à l’esprit, dans cette « mélancolie partagée » poétiquement évoquée par Paolo Rumiz. « Et vous ne pouvez rien comprendre véritablement aux Balkans si vous ne voyez pas la petite lumière qui vous appelle, cette lumière perdue au bout du monde, lumière unique restant immobile dans les trafics des bateaux, des poissons, des hommes et des mouettes. ».
Jean-Pierre Longre
18:49 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, image, essai, histoire, balkans, jordi savall, montserrat figueras, aliavox, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/11/2013
Le messager noir, quatrième galop
 The Black Herald – nr 4, octobre 2013, Black Herald Press
The Black Herald – nr 4, octobre 2013, Black Herald Press
Poèmes, proses, essais, photographies : le nouveau numéro de la revue bilingue (et même multilingue, en l’occurrence) offre un choix toujours exigeant, toujours gratifiant, et d’une haute tenue constante.
With / avec Steve Ely, Pierre Cendors, Edward Gauvin, Paul B. Roth, Jean-Pierre Longre, Rosemary Lloyd, Boris Dralyuk, Paul Stubbs, Georgina Tacou, John Lee, Cristián Vila Riquelme, Philippe Muller, Michael Lee Rattigan, Desmond Kon Zhicheng-Mingdé, Vasily Kamensky, David Shook, Oliver Goldsmith, Michel Gerbal, Gary J. Shipley, Anthony Seidman, Fernando Pessoa, Cécile Lombard, Anne-Sylvie Salzman, Heller Levinson, Jorge Ortega, Blandine Longre et des essais sur / and essays about Robert Walser, Arthur Rimbaud, Raymond Queneau, E.M. Cioran.
Images: Raphaël Lugassy, Pierre Cendors.
Design: Sandrine Duvillier.
The Black Herald
Literary magazine – Revue de littérature
Issue #4 – October 2013 - Octobre 2013
160 pages – 15€ / £12.90 / $20 – ISBN 978-2-919582-06-8 (ISSN 2266-1913)
Poetry, short fiction, prose, essays, translations.
Poésie, fiction courte, prose, essais, traductions.
now available / disponible
To order the issue / Pour commander le numéro
The Black Herald’s editors are Paul Stubbs and Blandine Longre.
Comité de Rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre.
An interview with Paul Stubbs in Bookslut (October 2012)
Un article paru dans Recours au Poème (Octobre 2013)
22:04 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, anglophone, francophone, poésie, nouvelle, essai, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/10/2013
Portraits équestres
 Jérôme Garcin, Galops, Perspectives cavalières, II, Folio / Gallimard, 2013
Jérôme Garcin, Galops, Perspectives cavalières, II, Folio / Gallimard, 2013
On connaît la passion que Jérôme Garcin voue aux chevaux. Et comme la littérature est aussi son fort, cela donne de beaux ouvrages équestres que nous lisons soit avec le regard naïf du néophyte, soit avec l’admiration complice du connaisseur, et toujours, selon les circonstances, aux rythmes des « trois allures ».
Dans Galops, l’auteur continue à dessiner avec brio et sensibilité ses « perspectives cavalières ». Les souvenirs personnels forment l’antichambre d’une galerie de portraits dont, évidemment, le cheval est le protagoniste. Portraits de comédiennes (dont celui, intime et tendre, d’Anne-Marie) et de comédiens (dominés par la silhouette rieuse et raffinée de Jean Rochefort), puis d’écrivains (Paul Morand et Flaubert en première ligne), d’artistes aux yeux perçants, d’un présentateur de télévision érudit, et bien sûr celui, en plusieurs épisodes, de Bartabas, « l’homme cheval », le « Centaure » dont les spectacles exigeants, piaffants, baroques et toujours renouvelés sont autant d’hymnes à l’animal royal. Pour finir, quelques considérations sur la féminisation du monde équestre (dont, visiblement, l’écrivain cavalier ne se plaint pas) et sur les engagements politiques divers du cheval (eh oui!), avant le portrait le plus émouvant, celui d’« Eaubac, le roi nonchalant », vieux compagnon à qui l’auteur rend le plus souvent possible visite « dans son petit royaume de verdure ».
Ces évocations, ces méditations, ces réflexions, ces récits, ces descriptions doivent certes beaucoup aux personnages animaux et humains qui les peuplent, mais beaucoup aussi à l’art du portraitiste, qui ne recule ni devant les confidences personnelles, ni devant les images fulgurantes, ni devant les jeux verbaux (à commencer par le néologisme « hippothèque » ou par l’homonymie de « selles »…). Une prose séduisante qui, sans les percer, laisse entrevoir les mystères d’un animal libre et fascinant.
Jean-Pierre Longre
10:07 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, portraits, francophone, jérôme garcin, folio, gallimard., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/07/2013
Une vie d’écriture
 Benjamin Fondane, Poèmes retrouvés 1925-1944, « Édition sans fin » établie et présentée par Monique Jutrin, Parole et silence, 2013
Benjamin Fondane, Poèmes retrouvés 1925-1944, « Édition sans fin » établie et présentée par Monique Jutrin, Parole et silence, 2013
Benjamin Fondane, Comment je suis né, textes de jeunesses traduits du roumain par Marlena Braester, Hélène Lenz, Carmen Oszi, Odile Serre, présentés par Monique Jutrin, Caractères, « Cahiers latins », 2013
Le premier trimestre 2013, si riche en publications franco-roumaines, richesse à laquelle le Salon du Livre de Paris ne fut pas étranger, a vu paraître coup sur coup deux ouvrages réunissant des textes de Benjamin Fondane présentés par Monique Jutrin, qui connaît parfaitement l’écrivain et son œuvre.
Le premier, Poèmes retrouvés 1925-1944, porte le beau sous-titre que l’auteur avait donné à sa deuxième version d’Ulysse, « Édition sans fin », qui « pourrait convenir à l’œuvre tout entière ». Pour ce volume, Monique Jutrin a opéré un choix à la fois draconien et significatif parmi les nombreux manuscrits que la sœur de Fondane lui confia un beau jour de 1996. Composés entre 1925 et 1944, ces poèmes en français sont « une prise authentique sur le réel », ce réel dont font partie les brouillons, corrections, repentirs et reprises dont l’œuvre finale est le résultat. Ainsi nous sont livrés un certain nombre des « premiers poèmes en français », de même que des textes « en marge » des grands recueils, Titanic, L’Exode, Ulysse, Le Mal des Fantômes. Le tout, augmenté de « poèmes épars » et des « vestiges d’un recueil abandonné », donne une belle idée du travail d’écriture d’un homme dont la poésie, pour primordiale qu’elle fût, n’était que l’une des nombreuses activités intellectuelles et artistiques.
 Le second, Comment je suis né, réunit des textes de jeunesse traduits par Marlena Braester, Hélène Lenz, Carmen Oszi, Odile Serre. Comme le rappelle Monique Jutrin, Benjamin Weschler, devenu B. Fundoianu puis Benjamin Fondane, fut un écrivain particulièrement précoce, puisqu’il commença à publier dès 1912, à l’âge de 14 ans. Pas étonnant, donc, qu’il ait fallu faire le tri « parmi la centaine de textes publiés et de manuscrits inédits datant des années 1912-1922 ». Répartis en trois sections (« Textes autobiographiques », « Lectures », « Poèmes en prose »), ces écrits d’adolescence et de jeunesse sont déjà, ou presque, des productions d’écrivain adulte, faisant montre d’un recul étonnant par rapport à son activité (« J’écris des mémoires. Je tiens probablement à contredire Faguet, qui pense que seuls les vieux écrivent des mémoires. »), voire d’un humour d’homme déjà mûr (« Hertza est une petite bourgade de 3.000 habitants, comptant 4.000 tavernes, un maire, 20 kiosques, deux sergents de police, et d’innombrables voleurs. »). En même temps, c’est d’un sens certain de ce qu’est la littérature, d’une culture à toute épreuve, d’un esprit critique sans concessions que fait preuve le jeune homme, qui fréquente assidûment et intimement l’œuvre d’écrivains français de son époque, ainsi que les « livres anciens », et qui n’hésite pas à écrire par exemple : « Personne ne lit plus, personne ne se livre plus au plaisir ni à la souffrance ; personne ne se tourmente plus pour faire jaillir de lui une passion plus pure – et cependant l’admiration pour les grands artistes se perpétue avec une ardeur éloquente – et pieuse. ».
Le second, Comment je suis né, réunit des textes de jeunesse traduits par Marlena Braester, Hélène Lenz, Carmen Oszi, Odile Serre. Comme le rappelle Monique Jutrin, Benjamin Weschler, devenu B. Fundoianu puis Benjamin Fondane, fut un écrivain particulièrement précoce, puisqu’il commença à publier dès 1912, à l’âge de 14 ans. Pas étonnant, donc, qu’il ait fallu faire le tri « parmi la centaine de textes publiés et de manuscrits inédits datant des années 1912-1922 ». Répartis en trois sections (« Textes autobiographiques », « Lectures », « Poèmes en prose »), ces écrits d’adolescence et de jeunesse sont déjà, ou presque, des productions d’écrivain adulte, faisant montre d’un recul étonnant par rapport à son activité (« J’écris des mémoires. Je tiens probablement à contredire Faguet, qui pense que seuls les vieux écrivent des mémoires. »), voire d’un humour d’homme déjà mûr (« Hertza est une petite bourgade de 3.000 habitants, comptant 4.000 tavernes, un maire, 20 kiosques, deux sergents de police, et d’innombrables voleurs. »). En même temps, c’est d’un sens certain de ce qu’est la littérature, d’une culture à toute épreuve, d’un esprit critique sans concessions que fait preuve le jeune homme, qui fréquente assidûment et intimement l’œuvre d’écrivains français de son époque, ainsi que les « livres anciens », et qui n’hésite pas à écrire par exemple : « Personne ne lit plus, personne ne se livre plus au plaisir ni à la souffrance ; personne ne se tourmente plus pour faire jaillir de lui une passion plus pure – et cependant l’admiration pour les grands artistes se perpétue avec une ardeur éloquente – et pieuse. ».
Ces deux publications sont plus que des compléments aux livres de Benjamin Fondane ; elles sont des pièces à part entière de l’œuvre à la fois abondante et diverse d’un jeune Juif roumain qui, devenu écrivain français par conviction et vocation, a tant apporté à sa culture d’adoption.
Jean-Pierre Longre
16:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, autobiographie, essai, francophone, roumanie, benjamin fondane, monique jutrin, marlena braester, hélène lenz, carmen oszi, odile serre, parole et silence, caractères, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2013
Des lectures à foison
 Nicolae Manolescu, Sujets français, traduit du roumain par Dominique Ilea, Ginkgo éditeur, 2013
Nicolae Manolescu, Sujets français, traduit du roumain par Dominique Ilea, Ginkgo éditeur, 2013
Nicolae Manolescu, l’une des grandes figures de la critique littéraire roumaine et européenne, livre ici une infime partie des articles qu’il a écrits dans les années 1970 et 1980, lorsque la littérature permettait, d’une manière plus vive qu’à n’importe quelle autre époque, d’échapper au moins momentanément aux affres de la bêtise totalitaire. Point commun de ce choix de textes : la langue, la littérature et la culture françaises – ce qui nous vaut des pages d’une richesse inouïe sur un patrimoine que l’auteur connaît à la perfection.
Que ce soit à propos de Balzac, de Flaubert, de Gide, de Malraux, de Cioran, de Victor Hugo, des écrits du Moyen Âge, de Stendhal, de Proust (on en passe…), la réflexion du critique va bien au-delà de la description et de l’histoire, pour entraîner le lecteur hors des sentiers battus, sans toutefois le perdre dans un maquis de vaines considérations. La plupart des développements sur la littérature partent de l’expérience du lecteur francophone et francophile, certes, mais aussi du lecteur bilingue, pour qui la littérature française et la littérature roumaine sont deux points d’accroche concrets, même si le livre porte essentiellement sur la première ; cela donne d’intéressants rapprochements, tel celui qui est fait entre les couples Victor Hugo / Chateaubriand et Vasile Alecsandri / Mihai Eminescu.
On ne peut tout évoquer de ce recueil propre à susciter des lectures multiples. Il y a les évocations de promenades parisiennes – toujours en référence à la culture, à l’art, aux livres (et cela donne, par exemple, une belle évocation de Caragiale à propos de tableaux parisiens). Il y a les tentatives (réussies) de définition, de défense, de critique de la critique elle-même, à propos de Sainte-Beuve notamment. Il y a la précision des mots et la mesure de leurs enjeux. Il y a, surtout, l’amour des livres, ceux du passé et du présent, ceux d’ici et d’ailleurs, cet amour qui guide l’auteur entre les différentes facettes de cette vaste culture dont il fait profiter le lecteur. « Mes livres sont la chair de ma chair ».
Jean-Pierre Longre
14:45 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roumanie, littérature française, nicolae manolescu, dominique ilea, ginkgo éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/06/2013
« Une affinité mystérieuse » ?
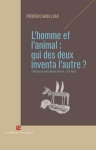 Frédéric Grolleau, L’homme et l’animal : qui des deux inventa l’autre ?. Préface de Jean-Claude Poizat, Les éditions du Littéraire, 2013
Frédéric Grolleau, L’homme et l’animal : qui des deux inventa l’autre ?. Préface de Jean-Claude Poizat, Les éditions du Littéraire, 2013
« Si l’homme et l’animal ne font pas toujours bon ménage, ils s’entr’appartiennent néanmoins l’un à l’autre, fût-ce pour s’entre-déchirer, s’entre-dévorer ou s’entre-tuer », rappelle à juste titre Jean-Claude Poizat dans la préface de cet ensemble de dix dissertations (exactement neuf dissertations en bonne et due forme et une lecture de tableau).
Toutes les grandes questions liées à la relation homme-animal sont clairement posées, impeccablement traitées selon des schémas plus que méthodiques (introduction, trois parties, conclusion – démarche aussi rigoureuse que distanciée), richement documentées (comme en témoignent les nombreuses notes et annexes qui prolongent la réflexion, ainsi que les innombrables références littéraires et historiques). Les grandes questions, donc : le cannibalisme et la nourriture, les métamorphoses et la « part animale » de l’homme, l’intelligence humaine et animale, la guerre et la barbarie… Des figures récurrentes parcourent ces développements, telle celle du loup, qui les clôt aussi par l’intermédiaire de La Fontaine, Chagall et Nietzsche.
Evidemment, l’ouvrage à lui seul ne peut pas épuiser le thème. Mais il établit des distinctions éclairantes entre les notions et entre les mots (par exemple, au hasard, entre « conflit », « guerre » et « violence »), il met la philosophie au service d’une interrogation fondamentale et inhérente à la vie, il convoque les grands mythes de l’humanité, et rappelle quelques vérités peu glorieuses (« Qui veut faire l’ange fait la bête » ou « L’homme peut se vanter d’être en vérité l’espèce vivante qui extermine le plus sciemment son prochain »), au risque de nous mettre en mémoire quelques belles et terribles velléités baudelairiennes :
« Je jalouse le sort des plus vils animaux
Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide »…
Jean-Pierre Longre
09:36 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, philosophie, francophone, frédéric grolleau, jean-claude poizat, les éditions du littéraire, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/02/2013
Papiers millimétrés
 Jean-Jacques Nuel, Courts métrages, Le Pont du Change, 2013
Jean-Jacques Nuel, Courts métrages, Le Pont du Change, 2013
Le texte bref, malgré les apparences, n’est pas un genre facile. Il n’est pas donné à tout le monde de réussir à dire (ou, le plus souvent, à suggérer) en quelques lignes ce que d’autres développent en plusieurs centaines de pages. Il faut pour cela non seulement le sens de la concision, la maîtrise du mot et de l’expression justes, l’art de la chute, mais aussi de l’imagination, beaucoup d’esprit et beaucoup de travail.
Ces qualités, Jean-Jacques Nuel les réunit dans ses Courts métrages, qui donnent un avant-goût déjà fort savoureux de ses Contresens à venir. Ces ensembles, taillés au millimètre (de trois lignes à une page), se succèdent sur les modes humoristique, étrange, désespérant, poétique… De l’épigramme classique au conte absurde, de la leçon morale à l’anecdote terrifiante, de la fable sociale au récit d’anticipation, il y en a pour tous les goûts, et chacun peut cueillir parmi ces quatre-vingts œuvres en puissance ce qui lui convient au moment voulu, dans un contexte donné.
On aurait envie de faire profiter tout le monde de sa cueillette personnelle, et de citer ce qui tombe, même au hasard, sous le regard. On se contentera d’un exemple, « Le bureau des admissions » : « Les candidats attendaient toute la nuit dans la rue, sous la pluie ou dans le froid, devant les grilles de la préfecture, pour être certains d’obtenir dès l’ouverture du bureau ce précieux ticket, délivré en nombre limité, qui leur donnait le droit d’attendre, la nuit suivante, dans la rue, sous la pluie ou dans le froid, devant les grilles de la préfecture ».
Jean-Pierre Longre
Et relire J.-J. Nuel…
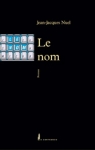 Le nom, éditions A Contrario, 2005
Le nom, éditions A Contrario, 2005
La littérature est d'abord une affaire de mots, et le tout est de pouvoir utiliser ce matériau artistiquement, le fin du fin consistant en une combinaison harmonieuse du plus petit nombre de mots possible avec la plus grande longueur de texte (voir par exemple Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau).
Jean-Jacques Nuel - ou, en tout cas - le protagoniste-narrateur (l'unique personnage) qui, dans le livre, s'appelle Jean-Jacques Nuel, a tenté de battre tous les records : bâtir une œuvre d'ampleur infinie, universellement reconnue comme telle, conférant à son auteur l'aura des idoles, en n'utilisant qu'un petit mot de quatre lettres, qui passe par le truchement de l'écriture réitérée à l'envi du statut de nom propre à celui de nom commun décliné sous toutes ses faces, dans toutes ses dimensions, selon toutes les formes esthétiques. Ce petit mot est tout bonnement le nom du narrateur (qui est aussi celui de l'auteur), lieu commun ainsi renouvelé (ce par quoi Cocteau définit la poésie), nom trop usé résonnant de son étrangeté fictionnelle, "comme si c'était appeler les choses / Justement de ce bizarre nom qui est le leur " (Aragon).
L'obsession du nom s'empare du souci de perfection définitive, et alors survient la folie des nombres, l'utopie de la machine littéraire donnant toutes facilités au scripteur, dans une tentative d'épuisement (toute perecquienne) de la vie littéraire : déambulations quotidiennes dans l'appartement, dans le quartier (une Part-Dieu lyonnaise qui n'a en soi rien pour inspirer l'artiste…), courriers aux éditeurs (réponses négatives ou inexistantes), reniement des œuvres antérieures, vains espoirs de notoriété… tout cela pour s'apercevoir au bout du compte que l'écrivain est un homme, avec des souvenirs, le sentiment de la vie et de la mort, qu'il doit faire ce qu'il a à faire, se reposer de temps en temps (disons chaque septième jour), et que la création n'est pas seulement une questions de mécanique et d'arithmétique.
Le nom est un roman de la création, et aussi - prénom oblige - une véritable confession d'écrivain.
http://lepontduchange.hautetfort.com
09:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : : récit, essai, roman, jean-jacques nuel, le pont du change, a contrario, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/02/2013
Honneur aux méconnus
 Alain Gerber, Petit Dictionnaire Incomplet des Incompris, Alter Ego Éditions, 2012
Alain Gerber, Petit Dictionnaire Incomplet des Incompris, Alter Ego Éditions, 2012
« Ils ont fait l’Histoire, mais l’Histoire ne leur a pas fait de cadeaux. Car l’Histoire est ingrate, quelquefois : des hommes l’écrivent, mais elle rechigne pourtant à inscrire leurs noms sur ses monuments. Le musicien sous-estimé n’est pas une denrée rare dans le jazz. Il est encore plus répandu que le musicien surestimé, ce qui n’est pas peu dire ». Alain Gerber y remédie à sa manière, en mettant son érudition jazzistique au service des « méconnus », des « invisibles », des « transparents », des anonymes, de ceux qui ne sont qu’une « silhouette furtive » empruntant des « chemins de traverse », de ceux qui se mettent « à contre-courant », des solitaires, des malchanceux… Bref, de Dolorez Alexandria Nelson, dite Lorez Alexandria, à Attila Zoler, l’auteur passe en revue les « incompris » ou (ce qui est encore autre chose) les « non compris ».
« Incomplet », ce dictionnaire ? Peut-être, puisqu’il le dit – impossible d’en juger. En tout cas, fort documenté : en matière d’histoire du jazz, on ne fait pas plus précis, pas plus affectueux, non plus, pour ces figures que la plupart du temps on n’aperçoit que de profil – si jamais on les aperçoit. Il y a aussi ceux dont la malédiction n’est pas celle de l’anonymat, mais celle de la réputation : « déclarés sulfureux », alcooliques, violents, la plume d’Alain Gerber les tire de l’enfer ou de l’oubli – même si, selon lui, « il n’est pas impossible qu’au bout du compte, ce déficit de notoriété ne soit pas préférable à la gloire trop brutale à laquelle d’autres furent confrontés ». Il y a ceux, aussi, qui ratent jusqu’à leur échec, comme « Jelly Roll » Morton, ou dont « l’apport inestimable reste trop largement méconnu », bien que leur prestige soit « universel », comme Martial Solal.
Un dictionnaire, certes, dans l’ordre alphabétique, avec un index des musiciens et des instruments, mais un dictionnaire qui ne se contente pas de la savante sécheresse des ouvrages spécialisés. Cette recension, pour méthodique qu’elle soit, baigne dans la prose poétique d’Alain Gerber. Qu’on lise, par exemple, les débuts de l’article sur Robert Leo « Bobby » Hackett, évoquant les « hommes du bord de mer, nés dans des villes lointaines… », ou du texte sur Eli Thompson, dit « Lucky », ne s’en laissant pas conter par « les mots errants, [qui] traînent à travers le monde, et parfois se collent à nous ». Sans oublier ce sens de la formule synthétique et de l’image savoureuse dont ou voudrait donner de multiples échantillons, du genre « Il y a des musiciens d’escabeau, des musiciens trônant sur des taupinières, mais que l’on a portés aux nues, non sans parfois de grandes contorsions » ; ou encore « Un géant peut en cacher un autre » ; ou encore… Ce « petit » dictionnaire est un grand ouvrage, qui a le mérite non seulement de réhabiliter les « incompris », mais encore de se lire comme un recueil de nouvelles que l’on peut parcourir à grandes enjambées ou déguster à petites doses, selon l’humeur.
Jean-Pierre Longre

Dans la collection « Jazz Impression » des éditions Alter Ego, n’oublions pas deux ouvrages récemment parus :
- Les Blessures du Désir, Pulsions et Puissances en Jazz, de Jean-Pierre Moussaron (tout récemment décédé, en octobre 2012), série de « portraits » et « esquisses » d’autant plus émouvants qu’ils sont très personnels.
 - John Coltrane, La musique sans raison, de Michel Arcens, « Esquisses d’une philosophie imaginaire » et « Essai pour une phénoménologie du jazz », ouvrage qui dépasse Coltrane, sans le contourner, pour construire une véritable esthétique musicale.
- John Coltrane, La musique sans raison, de Michel Arcens, « Esquisses d’une philosophie imaginaire » et « Essai pour une phénoménologie du jazz », ouvrage qui dépasse Coltrane, sans le contourner, pour construire une véritable esthétique musicale.
Alter Ego Editions
3, rue Elie Danflous
66400 Céret
http://leseditionsalterego.wordpress.com
17:15 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, jazz, francophone, alain gerber, michel arcens, jean-pierre moussaron, alter ego éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/01/2013
Un guide littéraire pour tous
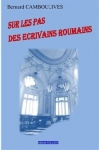 Bernard Camboulives, Sur les pas des écrivains roumains, éditions Vaillant, 2012
Bernard Camboulives, Sur les pas des écrivains roumains, éditions Vaillant, 2012
La Roumanie et la France entretiennent depuis longtemps des liens privilégiés, notamment dans le domaine culturel, et tout particulièrement littéraire. On le sait, mais il est bon que, périodiquement, quelques « passeurs » le rappellent et s’emploient à resserrer ces liens. Bernard Camboulives, fin connaisseur de la littérature roumaine, fait partie de ces « passeurs ».
Son dernier ouvrage, modestement sous-titré « Aperçu à l’usage des lecteurs francophones », dresse d’abord un tableau général de l’histoire littéraire de la Roumanie, depuis les textes médiévaux jusqu’à notre époque (en anticipant même sur les traductions à paraître d’ici au Salon du Livre de Paris, où en 2013 les écrivains roumains seront à l’honneur). La deuxième partie donne des précisions sur les œuvres en langue roumaine de certains auteurs représentant des points d’ancrage décisifs, tels que Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Eugène Ionesco, Gherasim Luca, Herta Müller, Florina Ilis (à noter qu’une liste très utile des « auteurs roumains traduits en France » figure à la fin de l’ouvrage).
Bernard Camboulives ne se contente pas de recenser et de décrire. Ses analyses sont circonstanciées et détaillées, les éclairages diversifiés (voir par exemple le chapitre sur la ballade Mioritsa et ses interprétations divergentes, ou celui qui porte sur le « cas » Eminescu). Il y a donc là matière à intéresser tous les lecteurs – ceux qui désirent s’initier à l’histoire de la littérature roumaine aussi bien que ceux qui veulent approfondir la connaissance qu’ils en ont déjà.
Jean-Pierre Longre
18:11 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roumanie, bernard camboulives, éditions vaillant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/11/2012
Le numéro trois est arrivé !
 The Black Herald – 3
The Black Herald – 3
Literary magazine – Revue de littérature
Issue #3 – September 2012 - Septembre 2012
190 pages – 15€ / £13 / $19 – ISBN 978-2-919582-04-4
Poetry, short fiction, prose, essays, translations.
Poésie, fiction courte, prose, essais, traductions.
With / avec W.S. Graham, Gregory Corso, Andrew Fentham, Louis Calaferte, Iain Britton, Jos Roy, Tristan Corbière, Michael Lee Rattigan, Clayton Eshleman, Denis Buican, John Taylor, César Vallejo, Anne-Sylvie Homassel, Cécile Lombard, Gary J. Shipley, Rosemary Lloyd, Bernard Bourrit, Mylène Catel, Nicolas Cavaillès, Ernest Delahaye, Sébastien Doubinsky, Gerburg Garmann, Michel Gerbal, Allan Graubard, Sadie Hoagland, James Joyce, João Melo, Andrew O’Donnell, Kirby Olson, Devin Horan, Dominique Quélen, Nathalie Riera, Paul B. Roth, Alexandra Sashe, Will Stone, Anthony Seidman, Ingrid Soren, August Stramm, Pierre Troullier, Romain Verger, Anthony Vivis, Elisabeth Willenz, Mark Wilson, Paul Stubbs, Blandine Longre et des essais sur / and essays about Charles Baudelaire, Francis Bacon. Images: Ágnes Cserháti, Olivier Longre, Will Stone, Devin Horan. Design: Sandrine Duvillier.
The Black Herald is edited by Paul Stubbs and Blandine Longre
Comité de Rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre
17:34 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, anglophone, francophone, poésie, nouvelle, essai, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/08/2012
De Moscou à Moulinsart
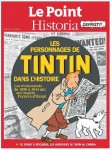 Collectif, Les personnages de Tintin dans l’histoire, Le Point, Historia, vol. 1 2011, vol. 2 2012
Collectif, Les personnages de Tintin dans l’histoire, Le Point, Historia, vol. 1 2011, vol. 2 2012
Points de vue sémiologiques, littéraires, artistiques, psychanalytiques, géographiques, référentiels, intertextuels, psychologiques… j’en passe : les analyses tintinologiques abondent. Une de plus, dira-t-on, avec celle que proposent Le Point et Historia, avec la complicité de périodiques suisse (Le Temps), belges (Le Soir, La Libre Belgique) et québécois (La Presse). Certes, mais le côté historique est le parti pris original de ces deux volumes consacrés aux « événements qui ont inspiré l’œuvre d’Hergé » et par ailleurs abondamment illustrés.
Depuis Tintin au pays des Soviets jusqu’au Trésor de Rackham le Rouge pour le premier tome, et de Tintin en Amérique à l’inachevé Tintin et Alph-Art pour le second, chacun des vingt albums fait l’objet d’un chapitre documenté où chaque personnage est présenté avec ses caractéristiques, ses origines, sa naissance (livresque) ; dans l’ordre : Tintin et Milou, Dupont et Dupond, Rastapopoulos, Tchang, Alcazar, le Dr Müller, Bianca Castafiore, le Capitaine Haddock, Nestor et Tournesol, puis Al Capone, Philippulus, Bergamotte, Abdallah, Wolff, Lampion, Da Figueira, Le Yéti, De la Batellerie, Carreidas et Peggy.
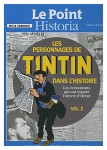 Chaque fois, aussi, sont proposés un profil visuel et textuel d’Hergé, quelques considérations culturelles et, surtout, un dossier historique fourni, qui ne cèle rien des circonstances et des influences ayant donné lieu aux scénarios construits par l’auteur, aux décors de chaque aventure, aux relations entre les personnages et leur environnement. La mémoire se rafraîchit et se nourrit à la lecture des pages sur l’URSS, la colonisation, l’égyptologie, les conflits entre la Chine et le Japon, entre la Bolivie et le Paraguay, sur les progrès techniques mis à profit par les faussaires, sur les prémisses de la Seconde Guerre mondiale, le trafic d’opium, les pirates et les corsaires, sur le château de Cheverny, modèle de Moulinsart maintenant dédié à la tintinophilie, sur la prohibition aux USA, la conquête du Pôle Nord, les Incas, l’exploitation du pétrole, les premiers pas sur la lune, la guerre froide, l’esclavagisme, la conquête des sommets himalayens, sur la mode des « people », les détournements d’avions, l’histoire de Cuba, l’affaire Legros... Nous avons droit aussi à un dossier sur Tintin et le cinéma (relations et tentatives souvent malheureuses), et à une bibliographie concernant les « arrière-plans historiques » et le « monde de Tintin ».
Chaque fois, aussi, sont proposés un profil visuel et textuel d’Hergé, quelques considérations culturelles et, surtout, un dossier historique fourni, qui ne cèle rien des circonstances et des influences ayant donné lieu aux scénarios construits par l’auteur, aux décors de chaque aventure, aux relations entre les personnages et leur environnement. La mémoire se rafraîchit et se nourrit à la lecture des pages sur l’URSS, la colonisation, l’égyptologie, les conflits entre la Chine et le Japon, entre la Bolivie et le Paraguay, sur les progrès techniques mis à profit par les faussaires, sur les prémisses de la Seconde Guerre mondiale, le trafic d’opium, les pirates et les corsaires, sur le château de Cheverny, modèle de Moulinsart maintenant dédié à la tintinophilie, sur la prohibition aux USA, la conquête du Pôle Nord, les Incas, l’exploitation du pétrole, les premiers pas sur la lune, la guerre froide, l’esclavagisme, la conquête des sommets himalayens, sur la mode des « people », les détournements d’avions, l’histoire de Cuba, l’affaire Legros... Nous avons droit aussi à un dossier sur Tintin et le cinéma (relations et tentatives souvent malheureuses), et à une bibliographie concernant les « arrière-plans historiques » et le « monde de Tintin ».
Dans ces beaux livres au format de BD, le grand public trouvera de quoi se remémorer des lectures lointaines ou proches, mais aussi de quoi se renseigner grâce à des contributions historiques toujours précises. De quoi, aussi, réfléchir aux rapports entretenus, dans un esprit tel que celui d’Hergé, entre la réalité documentaire et l’imaginaire.
Jean-Pierre Longre
http://www.historia.fr/web/evenement/tintin-le-retour-28-...
15:52 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : illustration, essai, francophone, tintin, hergé, le point, historia, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/07/2012
Gueux et nomades
 Jean Richepin, Truandailles, Le Vampire Actif, 2012
Jean Richepin, Truandailles, Le Vampire Actif, 2012
Jean Richepin ? C’est La Chanson des gueux qui vient à la mémoire, guère plus. Pourtant, l’œuvre de cet écrivain à la carrière atypique (ancien élève de l’École Normale Supérieure, professeur, poète, linguiste, académicien, sans compter les métiers de toutes sortes auxquels il a touché, et avec cela passionné par la langue populaire et l’argot, condamné par la censure pour certains de ses écrits…), son œuvre, donc, est abondante, truculente et variée.
Alors, quelle bonne idée d’avoir exhumé cet ensemble de récits dans lesquels les « gens du voyage », les saltimbanques, les brigands et les miséreux occupent les premières places, dans une succession de bons et mauvais coups, de malheurs, de générosités et de violences, avec leur langage direct et imagé ! « Être libre, et vivre, et créer, et sans savoir pourquoi ni comment, telle me semble devoir être la fonction du poète, et sa joie. ». Telle est la profession de foi de l’écrivain, qui la met en pratique dans ces textes où les mots, les phrases, les différents registres de langue s’épanouissent effectivement en toute liberté. Au fil de la lecture, on découvre un styliste hors pair, dont la prose s’adapte parfaitement à des situations et à des personnages aussi divers que pittoresques.
Bonne idée, aussi, d’avoir complété ce passionnant volume par un substantiel chapitre intitulé « De l’argot et des gueux… ». On y trouve des considérations circonstanciées sur « la multiplicité des formes que [l’argot] a pu prendre au cours des siècles », puis des pages illustratives de Victor Hugo (Les Misérables) et d’Eugène Sue (Les Mystères de Paris), enfin les « pièces supprimées » de La Chanson des gueux de Richepin. Un « glossaire argotique » bien utile clôt cet ensemble qui allie avec bonheur les plaisirs de la lecture et les satisfactions de la connaissance.
Jean-Pierre Longre
16:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nouvelles, poésie, essai, francophone, jean richepin, le vampire actif, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/06/2012
Roi de la satire
I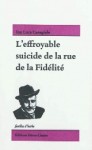 on Luca Caragiale, L’effroyable suicide de la rue de la Fidélité, éditions Héros-Limite, 2012
on Luca Caragiale, L’effroyable suicide de la rue de la Fidélité, éditions Héros-Limite, 2012
Ion Luca Caragiale (1852-1912), le plus fameux des dramaturges roumains, est souvent comparé à Gogol ou à Courteline. On pourrait dire aussi, en changeant d’époques, qu’il y a chez lui du Molière (pour la verve comique) et du Voltaire (pour l’ironie mordante). Tout compte fait, Caragiale est incomparable, car les rapprochements sont dépassés à la fois par l’écriture personnelle de l’auteur et par les particularités de l’âme roumaine.
Il est en général question de l’œuvre théâtrale, avec des pièces comme Monsieur Leonida aux prises avec la réaction ou Une lettre perdue*. On évoque moins souvent les textes narratifs – nouvelles, récits ou « moments » – dont ce volume exhume un choix judicieux. Caragiale y apparaît comme le roi de la satire qu’il est dans toute son œuvre : satire de la société, des relations familiales, amoureuses et amicales, de la bureaucratie administrative, des manœuvres politiques, de la corruption des élites, du nationalisme xénophobe, de la délation, de l’hypocrisie… Nul n’est épargné, si ce n’est le petit peuple des victimes et des paysans besogneux. D’ailleurs les prises de position de l’auteur (que développent et précisent bien les pages intitulées « 1907, du printemps à l’automne » reproduites en fin de volume) l’ont conduit à l’exil : il passa les huit dernières années de sa vie à Berlin.
Textes engagés, donc ; textes circonstanciels, certes, puisque l’esprit roumain (un mélange d’humour et d’humeur, de simplicité et d’ostentation) imprègne ces pages ; textes universels, aussi, écrits par un moraliste qui met en avant les défauts inhérents à la nature humaine et à la vie en groupe. Surtout, textes comiques, d’une drôlerie qui résulte de tout ce qui précède, de l’expérience et de l’imagination d’un homme qui invente à partir de la vie, et de la plume particulièrement acérée d’un écrivain qui a le génie de la mise en scène (théâtrale ou narrative, c’est tout un). « Le monde ne change jamais que de forme », écrit-il dans « Scribes et bouffons ». Il faut lire L’effroyable suicide de la rue de la Fidélité (titre emprunté à celui de l’une des nouvelles du recueil), pour rire de bon cœur, et pour méditer sur les vices d’une société humaine qui, effectivement, ne change qu’en apparence.
Jean-Pierre Longre
*Les Œuvres de Caragiale, traduites en français sous la direction de Simone Roland et Valentin Lipatti et comprenant les pièces, les récits et les articles, ont été publiées aux éditions Méridiens (Bucarest, 1962). Plus récemment, le Théâtre, traduit par Paola Benz-Fauci, est paru en 2002 aux éditions de l’UNESCO. Eugène Ionesco est aussi l’auteur d’adaptations françaises de plusieurs textes (L’Arche, 1994, Fata Morgana, 1998).
18:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, essai, roumanie, ion luca caragiale, éditions héros-limite, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/06/2012
Langage politique et comédie
 Les mots du spectacle en politique, Dictionnaire par le collectif Théâtocratie, Roms et Juliette, théâtre, par le groupe Petrol*, éditions Théâtrales, 2012
Les mots du spectacle en politique, Dictionnaire par le collectif Théâtocratie, Roms et Juliette, théâtre, par le groupe Petrol*, éditions Théâtrales, 2012
Dans La société du spectacle, Guy Debord montrait entre autres comment « une partie du monde se représente devant le monde », créant une séparation entre individu et pouvoir et transformant la vie politique en mise en scène. Partant de là, actualisant le propos, le collectif Théâtocratie (substantif on ne peut plus parlant), dirigé par Pierre Banos-Ruf, Johannes Landis-Fassler, Gaëlle Maidon et Christian Biet, analyse le fait politique en tant que représentation donnée non seulement par les gens de pouvoir, mais aussi par les médias, et compose un dictionnaire recensant « les mots du spectacle tels qu’ils sont aujourd’hui employés dans le discours politique médiatique ».
Ce dictionnaire est à la fois complet, précis et savoureux. Depuis « acteur/actrice » jusqu’à « tragique », en passant par « cinéma, cirque, guignolade, personnage, surjouer » – j’en passe beaucoup –, chaque terme est défini en fonction de son acception théâtrale, puis selon l’emploi qui en est fait dans le monde politique et dans la presse, illustrations textuelles à l’appui. Prenons un exemple : « Costume ». Le mot est examiné sous toutes les coutures (c’est le cas de le dire), dans tous ses emplois propres et figurés : « Vêtement présidentiel », qui permet de « faire président », et qui suscite des locutions particulières comme « garder son costume », « se débarrasser de son costume », « se retailler un costume », « froisser son costume » ; mais aussi « Vêtement d’un présidentiable », puis « Vêtement lié à l’interprétation de rôles sur la scène politique » (comme capitaine de navire ou « chantre des énergies carbonées »). On le voit, les références à l’actualité politique sont au cœur de l’ouvrage, mais n’occultent ni le caractère pérenne des notions, ni la profondeur historique du constat. De grand dramaturges du passé sont d’ailleurs sollicités : Shakespeare, Molière, Marivaux, Giraudoux ont eux aussi leur mot à dire.
Dramaturges du passé, et du présent : le volume se termine par Roms et Juliette, pièce écrite par le groupe Petrol* (Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philippe Malone et Michel Simonot). Elle met en scène « Monsieur le président » (que l’on n’a aucun mal à reconnaître sous ses masques), Juliette, qui l’accable d’un amour doucereux, son conseiller en communication, mais aussi, sous forme de monologues en alternance, la « France d’en bas » prise entre discours démagogiques et réalité misérable ; parfois, Apollinaire ou Baudelaire viennent rappeler, par le rêve tzigane, que la vie pourrait être autre… Pièce satirique, poétique, dont la composition, le rythme, le verbe (qui, comme chez Beckett et Ionesco, devient logorrhée burlesque et incontrôlée) proposent une belle illustration du dictionnaire qui précède.
À noter que l’ouvrage a été réalisé par « Expression livre », association d’étudiants des Métiers du Livre. Cet ouvrage est ainsi un bel exemple de travail collectif, dont la conception est aux antipodes du spectacle à sens unique qu’impose le discours politique.
Jean-Pierre Longre
15:50 Publié dans Essai, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, politique, théâtre, francophone, éditions théâtrales, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/03/2012
Les aboiements de la littérature
 Jean-François Louette, Chiens de plume. Du cynisme dans la littérature française du XXe siècle, La Baconnière, 2011
Jean-François Louette, Chiens de plume. Du cynisme dans la littérature française du XXe siècle, La Baconnière, 2011
Il y a le Cynisme, mouvement philosophique venu de l’antiquité et dont Diogène est la figure la plus fameuse, il y a le cynisme, attitude sociale de l’amertume, qualifié ici de « mondain », et il y a le « canisme », qui donne à l’expression littéraire le point de vue du chien (ou l’inverse ?) ; l’auteur rappelle à juste titre que le mot « cynisme » vient du grec « kuôn », chien.
Voilà ce que Jean-François Louette, professeur à la Sorbonne, entreprend d’étudier à travers cinq écrivains du XXe siècle, Michaux, Queneau, Bataille, Drieu la Rochelle, Nimier, plus quelques autres qui parcourent en zigzag les dix chapitres du livre (parmi lesquels se font repérer par leurs jappements réitérés Maupassant, Gide, Céline, Sartre, Genet, d’autres encore, en meutes ou solitaires).
Les soubassements philosophiques de l’analyse servent la cause littéraire, et c’est ce qu’on attend : il s’agit bien du « cynisme dans la littérature », et non du cynisme littéraire dans la philosophie, ni du cynisme des écrivains en tant qu’individus. Prenons l’exemple du chapitre consacré à Raymond Queneau, balayant les rapports du chien et du cynisme avec un écrivain qui ne s’est pas privé de faire remarquer que son nom même évoque à la fois le chêne et le chien (le haut et le bas) et qui cultive un « mythe personnel du chien » ; rapports avec l’écrivain, donc, mais aussi et surtout avec les personnages de certains de ses romans comme Le chiendent (titre en soi significatif), avec l’écriture même, cette écriture dont l’attitude distanciée par rapport à la langue et aux conventions romanesques relève aussi du cynisme.
Exemple probant, mais très partiel. Les autres chapitres font des « chiens de plume » cités plus haut des objets d’études fouillées, de découvertes judicieuses. En même temps, la portée de la réflexion se fait volontiers générale, par exemple sur le cynisme comme « révélateur de la modernité », sur les attitudes contradictoires et complémentaires du chien (l’écriture peut aboyer chaleureusement ou agressivement, l’animal littéraire peut être gai ou triste, nonchalant ou en colère…), et sur les va-et-vient entre cynisme et littérature : « La littérature aiguise notre connaissance du cynisme. En sens inverse, il se peut que la connaissance du cynisme aiguise notre savoir des mécanismes du champ littéraire ».
Jean-Pierre Longre
10:57 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, francophone, jan-françois louette, la baconnière., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/01/2012
« L’arôme des mots à l’infini »
 Étienne Klein, Jacques Perry-Salkow, Anagrammes renversantes ou Le sens caché du monde, Flammarion, 2011
Étienne Klein, Jacques Perry-Salkow, Anagrammes renversantes ou Le sens caché du monde, Flammarion, 2011
Quoi de commun entre « Le massif des Écrins » et « Les défis sans merci », entre « Le triangle des Bermudes » et « Le bruit des gens de la mer », entre « La gravitation universelle » et une « Loi vitale régnant sur la vie » ? Outre des recoupements thématiques et des correspondances de sens, on l’aura compris, chaque couple d’ensembles verbaux est anagrammatique.
On pourrait citer chacun d’entre eux, chaque page : tout est en ordre, tout est réjouissant, tout est judicieux. Car les auteurs – l’un physicien, l’autre musicien – ne se contentent pas de jouer avec les lettres et les mots, ni de rappeler l’histoire sacrée, sociale, satirique, spirituelle des anagrammes. Ils se sont débrouillés pour faire de chacune d’entre elles un prétexte à développement, dans des domaines aussi divers que la littérature, la science, l’art, l’histoire, l’actualité, la vie… Chaque texte est un concentré ludique d’érudition. Un exemple limite ? « En somme, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes : le marquis de Sade démasqua le désir, l’amiral Nelson sillonna la mer, Robert Schumann reconnut Brahms et Claude Lévi-Strauss a des avis culturels. »
Souvent, on ne se contente pas d’un ou deux mots. Voici par exemple ce que devient « Jean-François Champollion, conservateur du département d’égyptologie au musée du Louvre » : « À la lueur fauve d’un gros lampion dépoli, et gouvernant mon émoi, je décrypte des cartouches ». Et « le docteur Guillotin » ? Eh bien, « il en rougit du collet ». Et « Aurore Dupin, baronne Dudevant, alias George Sand » ? Il est vraisemblable qu’elle « valsera d’abord au son du piano d’un génie étranger ». Tout le monde sera par ailleurs d’accord pour dire que l’« entreprise Monsanto » produit un « poison très rémanent », ou qu’avec « le commandant Cousteau », « tout commença dans l’eau ». Le tout à l’avenant, assorti d’explications aussi solides que plaisantes, jusqu’à l’hommage à l’éditeur, « les éditions Flammarion », qui émettent « l’arôme des mots à l’infini »… en tout cas avec ce petit livre à savourer sans retenue, et à poursuivre soi-même. Car c’est bien connu, mais il vaut mieux le rappeler à chacun : si on savoure, on suivra ; ose !
Jean-Pierre Longre
19:13 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : essai, jeu verbal, francophone, Étienne klein, jacques perry-salkow, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/01/2012
Le « vouloir-vivre » et le « bien-vivre »
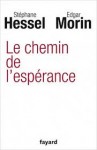 Stéphane Hessel, Edgar Morin, Le chemin de l’espérance, Fayard, 2011
Stéphane Hessel, Edgar Morin, Le chemin de l’espérance, Fayard, 2011
On sait le succès planétaire qu’a connu le petit livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous !. Un succès non seulement livresque, mais aussi, pour ainsi dire, existentiel et social, puisque les « Indignés » se manifestent un peu partout contre les aberrations du règne de la finance. On leur reproche parfois de ne pas aller au-delà de la contestation, de ne pas proposer de solutions concrètes aux impasses du capitalisme.
Le chemin de l’espérance est, délibérément ou non, une réponse à ces reproches. En moins de 60 pages, Stéphane Hessel et Edgar Morin (dont les essais politiques antérieurs représentent en l’occurrence une solide base de réflexion) proposent une « voie politique de salut public » contre ce « qui nous conduit au désastre » en Europe, dans le monde et, surtout, en France. Les transformations suggérées reposent sur un idéalisme qui n’est pas le contraire du réalisme. La Liberté, l’Égalité, la Fraternité sont à juste titre remises à l’ordre du jour comme soutiens de la nécessaire solidarité, qu’il faut « revitaliser » dans tous les domaines de la société. Cette revitalisation concerne la jeunesse, le travail et l’emploi, l’économie et la consommation, l’éducation, la culture, le fonctionnement de l’État, la démocratie.
Lutter pour un « vouloir-vivre » et un « bien-vivre », ensemble et individuellement, ne pourra se faire « si l’on n’entreprend pas de juguler la pieuvre du capitalisme financier et la barbarie de la purification nationale », ce qui n’ira pas sans des changements radicaux dans l’organisation sociale ni sans un apaisement des tensions et des divisions.
Il ne s’agit pas pour les deux auteurs de « fonder un parti nouveau », mais de régénérer la vie collective et de renouveler la politique. Ce n’est pas une utopie.
Jean-Pierre Longre
11:51 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, stéphane hessel, edgar morin, éditions fayard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/12/2011
De Valentin à Raymond
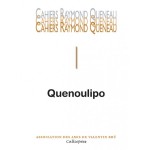 Cahiers Raymond Queneau n°1, "Quenoulipo", Éditions Calliopées, 2011
Cahiers Raymond Queneau n°1, "Quenoulipo", Éditions Calliopées, 2011
Il y a eu, jusqu’en 1986, la première série des Amis de Valentin Brû ; puis les Cahiers Raymond Queneau, et une nouvelle série des Amis de Valentin Brû ; dorénavant, l’écrivain a repris la place du personnage et la nouvelle série des Cahiers Raymond Queneau, toujours sous l’égide de l’association des Amis de Valentin Brû, est publiée par les éditions Calliopées, maison qui a l’expérience des ouvrages sur Queneau et des revues diverses (Apollinaire, Cahiers Jean Tardieu, Études greeniennes).
Tout cela, Daniel Delbreil, directeur des publications, le rappelle à bon escient dans son éditorial, avant de laisser la place à Astrid Bouygues, responsable de ce numéro 1 consacré aux rapports entre Queneau et l’Oulipo (bien normal, puisque, comme chacun le sait, l’auteur de Cent mille milliards de poèmes fur cofondateur de l’Ouvroir, qui a fêté récemment ses 50 ans). Alors on a invité du beau monde, de belles plumes qui représentent différentes générations, différentes manières, différents types de relation au père (ou grand-père)… Paul Fournel, qui affirme justement : « Il n’est pas étonnant que chaque oulipien ait « son » Queneau et en fasse le meilleur usage » ; puis Frédéric Forte, Ian Monk, Jacques Jouet, Michèle Audin, Michelle Grangaud, Harry Mathews, Daniel Levin Becker, qui se sont tous soumis aux contraintes de l’écriture oulipienne et/ou mémorielle ; sans oublier, exhumés et présentés par Bertrand Tassou, des textes inédits de Jacques Bens, oulipien historique.
La vocation première des Cahiers Raymond Queneau est, comme on s’en doute, l’étude de l’œuvre quenienne. Après la création, donc, priorité aux universitaires : Camille Bloomfield mesure et analyse avec une précision scientifique les rapports Queneau–Oulipo, Virginie Tahar examine de près les rapports intertextuels entre les mêmes, et Astrid Bouygues fait part des relations oulipiennes entre les écrits de François Caradec et Raymond Queneau. Comptes rendus et échos divers closent, comme il se doit, un volume qui ne manquera pas de ravir un public déjà conquis, mais aussi de conquérir un public potentiel.
Jean-Pierre Longre
Pour commander ou s’abonner :
15:43 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, essai, francophone, raymond queneau, oulipo, éditions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2011
Le sacre du métèque
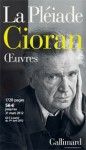 Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Venu des Carpates et des « cimes du désespoir », exilé à Paris, prisonnier volontaire d’une langue nouvelle et d’un pessimisme provocateur, Cioran est l’un des grands écrivains français du XXe siècle. Lui consacrer un volume de la Pléiade était justice, et la publication de ses Œuvres est un modèle du genre.
Les éditeurs ont choisi à bon escient de se limiter (si l’on peut dire) aux textes rédigés en langue française. Ce choix est dû à des raisons non seulement linguistiques et chronologiques, mais aussi philosophiques et littéraires. Les dix œuvres « françaises » publiées, présentées et annotées ici, même si elles n’échappent pas – et c’est heureux – à l’héritage roumain, forment un ensemble cohérent dans sa succession interne, tant du point de vue de la pensée que de celui du style.
On lira (ou relira) donc avec un bonheur non dénué d’une angoisse communicative Précis de décomposition, Syllogismes de l’amertume, La tentation d’exister, Histoire et utopie, La chute dans le temps, Le mauvais démiurge, De l’inconvénient d’être né, Écartèlement, Aveux et anathèmes, Exercices d’admiration, le tout complété, comme il se doit dans la Pléiade, par une préface, une biographie, une bibliographie, des notices, des notes, des appendices… Comme il se doit, et plus qu’il ne se doit : la préface, entre autres, offre, certes, une synthèse impeccable de l’œuvre de Cioran, une analyse limpide de son écriture, des ouvertures séduisantes sur les origines et les enjeux des textes, mais elle est aussi en elle-même un morceau de littérature ; à la fois enthousiaste et distanciée, construite et foisonnante, elle offre un bel exemple de « style comme aventure ».
Avec ce volume, le plaisir d’entendre une « voix [qui] accède à une pluralité de formes et de tons – de l’essai lyrique au lambeau delphique, de l’aphorisme ravageur à l’épître complice, de l’effigie destructrice à l’oraison non-violente… » est relevé par celui d’en apprendre beaucoup sur cette « voix », sur ce qui l’a construite et sapée, nourrie et affamée, encouragée et découragée, composée et décomposée. Au-delà de l’amertume ou des anathèmes, ce sont bien des « exercices d’admiration » que nous sommes amenés à pratiquer en l’écoutant, et en écoutant celles qui l’accompagnent.
Jean-Pierre Longre
19:56 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, francophone, roumanie, cioran, nicolas cavaillès, aurélien demars, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/12/2011
Une culture en mouvement
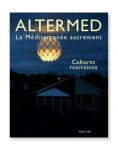 Revue Altermed n° 4, « Cultures roumaines », éditions Non Lieu, 2011
Revue Altermed n° 4, « Cultures roumaines », éditions Non Lieu, 2011
La revue Altermed a consacré trois numéros à la culture de différents pays méditerranéens, en mettant l’accent sur la création contemporaine et ce qui fait ses spécificités. La Roumanie est-elle un pays méditerranéen ? Michel Carassou, dans sa présentation, justifie le choix du numéro 4 en rappelant l’histoire et la tradition latines du pays, ainsi que l’influence ottomane à laquelle s’est heurtée « l’hégémonie slave ».
Quoi qu’il en soit, un volume consacré aux « cultures roumaines », qui ont tant de liens avec celles de divers pays d’Europe, notamment la France, autre pays méditerranéen, se justifie pleinement. Les bouleversements intervenus depuis la fin des années 1980 ne sont pas seulement politiques ou économiques. Le champ culturel a lui aussi connu des changements radicaux, ne serait-ce que par la liberté retrouvée, avec les tentatives, les tâtonnements, les expériences, les échecs et les réussites qu’elle a suscités.
La littérature occupe ici une place importante : la prose narrative, dont Andreia Roman rappelle l’histoire récente, depuis les contraintes du totalitarisme jusqu’à la « mise en question du monde » par les romanciers de la dernière génération comme Florina Ilis ; la poésie, elle aussi florissante, dont l’anthologie contenue dans ces pages complète celle qui a été publiée en 2008 dans Confluences poétiques ; le théâtre, lieu expérimental par excellence, qui oscille entre fidélité aux « racines » et « désir violent de réel ». Deux chapitres sont en outre consacrés aux arts visuels : le cinéma, dont les films d’auteurs internationalement reconnus manient à l’envi l’absurde, la satire et le « minimalisme » ; les arts plastiques – photographie, graphisme – qui tendent eux aussi vers un renouvellement complet et un engagement socio-politique marqué.
Malgré sa relative jeunesse, la Roumanie est riche d’un patrimoine culturel exceptionnel, qui a souvent nourri les avant-gardes européennes. Les artistes d’aujourd’hui ne dérogent pas à cette tradition, et on est heureux de lire ici des textes d’auteurs notoires ou encore peu connus, ainsi que des analyses précises et engageantes de certaines formes d’art contemporain.
Jean-Pierre Longre
 Les éditions Non Lieu viennent de publier une très intéressants correspondance de la poétesse et philosophe Catherine Pozzi (1882-1934) avec Raïssa et Jacques Maritain, Hélène Kiener et Audrey Deacon. Ces lettres inédites sont longuement présentées, précisément annotées par Nicolas Cavaillès, qui les a pour la plupart retrouvées à la Bibliothèque Nationale de France.
Les éditions Non Lieu viennent de publier une très intéressants correspondance de la poétesse et philosophe Catherine Pozzi (1882-1934) avec Raïssa et Jacques Maritain, Hélène Kiener et Audrey Deacon. Ces lettres inédites sont longuement présentées, précisément annotées par Nicolas Cavaillès, qui les a pour la plupart retrouvées à la Bibliothèque Nationale de France.
Nicolas Cavaillès, L’élégance et le chaos, éditions Non Lieu, 2011
17:36 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, essai, francophone, roumanie, altermed, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/09/2011
Poète du mouvement
 Christophe Dauphin, Ilarie Voronca, le poète intégral, Rafael de Surtis / Éditinter, 2011
Christophe Dauphin, Ilarie Voronca, le poète intégral, Rafael de Surtis / Éditinter, 2011
De tous les écrivains venus de Roumanie qui, au cours du XXe siècle, ont enrichi la littérature de langue française, Ilarie Voronca est l’un des plus importants et des plus méconnus. Tristan Tzara, Benjamin Fondane, Eugène Ionesco, Cioran et quelques autres font l’objet de nombreuses études ; pour les compléter, la parution de l’ouvrage de Christophe Dauphin est salutaire.
« Poète intégral », Voronca l’est à des titres divers. Théoricien de l’« intégralisme », il fut l’un des rédacteurs de la revue Integral, ainsi que d’autres revues de de cette avant-garde qui caractérisa la vie intellectuelle roumaine de l’entre-deux-guerres. En outre, toute son œuvre, en vers et en prose, relève d’une volonté d’unification « intégrale » des éléments naturels et humains. La biographie d’Eduard Marcus, alias Ilarie Voronca (1903-1946), très précisément rapportée, s’insère ici dans un environnement lui aussi parfaitement détaillé. Les années roumaines, l’installation en France, l’exil et ses difficultés, les brouilles littéraires momentanées, les amitiés, les amours, les rencontres (avec la plupart de ceux qui forment le monde artistique), les ruptures, la période de l’occupation et de la résistance, la quête désespérée du bonheur, jusqu’au suicide au domicile parisien – tout cela est solidement inscrit dans le contexte historique, social, politique, culturel, roumain, français, européen dont la destinée individuelle est indissociable.
Cette biographie est aussi un portrait moral (« Combattre les prisons, la haine, l’angoisse et l’oppression ») et surtout poétique, dans cet espace franco-roumain qu’Ilarie Voronca incarne totalement : symbolisme, avant-garde, intégralisme, lyrisme personnel… il est le poète du « mouvement », de l’« inquiétude », de l’« insatisfaction », de ces états qui ne laissent jamais en repos et d’où émane une incessante évolution.
Voilà un livre indispensable à la connaissance d’un poète majeur, qui plus est écrit par quelqu’un pour qui l’écriture est une matière vivante, puisque Christophe Dauphin, outre ses essais, a publié nombre de recueils poétiques. Son étude, qui s’appuie beaucoup sur les textes, forme un ensemble très documenté (citations, anthologie significative, riche iconographie…) : Ilarie Voronca, le poète intégral est un ouvrage nourri d’authenticité.
Jean-Pierre Longre
18:04 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, roumanie, ilarie voronca, christophe dauphin, rafael de surtis, Éditinter, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/09/2011
Des trouvailles au Pont du Change
Roland Tixier, Chaque fois l’éternité, préface de Geneviève Metge, Le Pont du Change, 2011
Alphonse Allais, L’agonie du papier et autres textes d’une parfaite actualité, introduction de Jean-Jacques Nuel, Le Pont du Change, 2011
Le Pont du Change, maison d’édition lyonnaise, enrichit sa production de deux livres à déguster lentement, avec délectation.
 L’un (Chaque fois l’éternité de Roland Tixier) est un recueil de brefs poèmes qui, à la manière des haïkus, campent en quelques syllabes tel personnage, tel objet, tel paysage, telle scène, suivant les souvenirs d’un été de vacances en Limousin. Se succèdent les images que l’adulte garde de cette période enfantine, dans un univers limité à une parcelle d’espace et de temps, mais aussi élargi à tout un « monde à portée de main », où les « brosses et savons » deviennent « navires et sous-marins », où s’ouvrent de nouvelles routes – sans parler de l’évocation fugitive d’une Algérie lointaine où se déroulent des événements qui échappent à l’enfant de 10 ans… Par la « magie du verbe », choses banales deviennent « mots cueillis », « mots copeaux / qui s’entortillent », objets poétiques à peine esquissés mais harmonieusement glissés dans le silence de la page.
L’un (Chaque fois l’éternité de Roland Tixier) est un recueil de brefs poèmes qui, à la manière des haïkus, campent en quelques syllabes tel personnage, tel objet, tel paysage, telle scène, suivant les souvenirs d’un été de vacances en Limousin. Se succèdent les images que l’adulte garde de cette période enfantine, dans un univers limité à une parcelle d’espace et de temps, mais aussi élargi à tout un « monde à portée de main », où les « brosses et savons » deviennent « navires et sous-marins », où s’ouvrent de nouvelles routes – sans parler de l’évocation fugitive d’une Algérie lointaine où se déroulent des événements qui échappent à l’enfant de 10 ans… Par la « magie du verbe », choses banales deviennent « mots cueillis », « mots copeaux / qui s’entortillent », objets poétiques à peine esquissés mais harmonieusement glissés dans le silence de la page.
 L’autre (L’agonie du papier) est d’une tonalité radicalement différente – variété des plaisirs, merci Monsieur l’éditeur. On savait Alphonse Allais humoriste hors pair ; on le sait, maintenant, savant et précurseur. Sous le rire et la fantaisie, sous la virtuosité parodique et la fausse grandiloquence, que d’inventions utiles, que de soins pour la survie de l’humanité ! Voilà un auteur qui, dès le tout début du XXe siècle, préconise (avant Queneau et bien avant les « textos ») une réforme profonde, phonétique de l’orthographe, et s’insurge devant la domination grammaticale du masculin sur le féminin, ou qui, devant les désastres de la déforestation et « l’agonie du papier », invente le microfilm, ancêtre de l’e-book… Dans un souci écologique et économique, il promet un bel avenir aussi bien aux énergies éolienne et marémotrice qu’aux téléconférences pour l’Assemblée Nationale, fondées sur le principe du « théâtrophone », ou qu’à un « Paris-Plage » entourant carrément la capitale pour le plus grand plaisir des vacanciers et des consommateurs de poisson. Si l’on veut plus de détails, que l’on se reporte à ce recueil de textes où l’humour, pas aussi absurde qu’on pourrait le croire, est soluble dans le progrès humain (et vice-versa).
L’autre (L’agonie du papier) est d’une tonalité radicalement différente – variété des plaisirs, merci Monsieur l’éditeur. On savait Alphonse Allais humoriste hors pair ; on le sait, maintenant, savant et précurseur. Sous le rire et la fantaisie, sous la virtuosité parodique et la fausse grandiloquence, que d’inventions utiles, que de soins pour la survie de l’humanité ! Voilà un auteur qui, dès le tout début du XXe siècle, préconise (avant Queneau et bien avant les « textos ») une réforme profonde, phonétique de l’orthographe, et s’insurge devant la domination grammaticale du masculin sur le féminin, ou qui, devant les désastres de la déforestation et « l’agonie du papier », invente le microfilm, ancêtre de l’e-book… Dans un souci écologique et économique, il promet un bel avenir aussi bien aux énergies éolienne et marémotrice qu’aux téléconférences pour l’Assemblée Nationale, fondées sur le principe du « théâtrophone », ou qu’à un « Paris-Plage » entourant carrément la capitale pour le plus grand plaisir des vacanciers et des consommateurs de poisson. Si l’on veut plus de détails, que l’on se reporte à ce recueil de textes où l’humour, pas aussi absurde qu’on pourrait le croire, est soluble dans le progrès humain (et vice-versa).
Le Pont du Change passe par-dessus les années en deux démarches différentes. Empruntez-le sans hésiter, le trajet ne vous décevra pas.
Jean-Pierre Longre
18:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, essai, humour, francophone, roland tixier, alphonse allais, geneviève metge, jean-jacques nuel, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/08/2011
The Black Herald n°2 arrive
 Literary magazine –Revue de littérature
Literary magazine –Revue de littérature
The Black Herald issue #2 – September 2011 - Septembre 2011
162 pages - 13.90 € – ISBN 978-2-919582-03-7
Poetry, short fiction, prose, essays, translations.
Poésie, fiction courte, prose, essais, traductions.
With / avec W.S Graham, Danielle Winterton, Dumitru Tsepeneag, Clayton Eshleman, Pierre Cendors, Onno Kosters, Alistair Noon, Anne-Sylvie Salzman, Róbert Gál, Andrew Fentham, Hart Crane, Delphine Grass, Jacques Sicard, Iain Britton, Jos Roy, Michael Lee Rattigan, Georges Perros, Laurence Werner David, John Taylor, Sudeep Sen, César Vallejo, Cécile Lombard, Michaela Freeman, Gary J. Shipley, Lisa Thatcher, Dimíter Ánguelov, Robert McGowan, Jean-Baptiste Monat, Khun San, André Rougier, Rosemary Lloyd, Hugh Rayment-Pickard, Sherry Macdonald, Will Stone, Patrick Camiller, Paul Stubbs, Blandine Longre. and essays about / et des essais sur Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, Jacques Derrida. Images : Romain Verger, Jean-François Mariotti. Design: Sandrine Duvillier.
The Black Herald is edited by Paul Stubbs and Blandine Longre
Comité de rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre
http://blackheraldpress.wordpress.com/magazine/the-black-herald-issue-2/
Where to find the magazine and our books / Où trouver la revue et nos publications :
http://blackheraldpressbookshop.blogspot.com/p/add-to-cart-ajouter-au-panier.html
And soon in bookshops listed here / et bientôt dans les librairies suivantes:http://blackheraldpress.wordpress.com/buy-our-titles/
Black Herald Press : http://blackheraldpress.wordpress.com/
Blog : http://blackheraldpress.tumblr.com
To follow us on Facebook / nous suivre sur Facebook : http://www.facebook.com/BlackHeraldPress
& Twitter : http://twitter.com/Blackheraldpres
Co-edited by Blandine Longre and Paul Stubbs, the magazine’s only aim is to publish original world writers, not necessarily linked in any way by ‘theme’ or ‘style’. Writing that we deem can withstand the test of time and might resist popularization – the dangers of instant literature for instant consumption. Writing that seems capable of escaping the vacuum of the epoch. Where the rupture of alternative mindscapes and nationalities exists, so too will The Black Herald.
L’objectif premier de la revue, coéditée par Blandine Longre et Paul Stubbs, est de publier des textes originaux d’auteurs du monde entier, sans qu’un « thème » ou un « style » les unissent nécessairement. Des textes et des écritures capables, selon nous, de résister à l’épreuve du temps, à la vulgarisation et aux dangers d’une littérature écrite et lue comme un produit de consommation immédiate. Des textes et des écritures refusant de composer avec la vacuité de l’époque, quelle qu’elle soit. Éclatement des codes, des frontières nationales et textuelles, exploration de paysages mentaux en rupture avec le temps : c’est sur ces failles que l’on trouvera le Black Herald.
“Black Herald Press is an outstanding new imprint – physically and stylistically their books are a delight.” — Paul Sutton, Stride magazine, 10/2010.
« La ligne éditoriale de la revue s’attache avant tout à établir un horizon élargi et diversifié de genres, de langues et de styles. Aucun thème ni mouvement commun, simplement (et c’est là que se trouve tout le sel de ces pages) l’articulation d’hémisphères, quelques terres inconnues reliées les unes aux autres pour que le style, justement, de la revue, ce soit ce point de convergence des textes entre eux. » – Guillaume Vissac, 04/2011
“Its publication feels like an event, in terms of quality and scope (it’s bi-lingual and has its sights, like Blast long before it, on the more visionary and European aspects of poetry).” – Darran Anderson, 02/2011
« Aux commandes de ce navire de pirates, Paul Stubbs et Blandine Longre, dont on avait déjà loué ici la sauvage poésie d’expression anglaise. Tous deux ont eu l’audace d’offrir à leurs contributeurs cette étrange arène où la langue, par le système d’échos qu’ils ont construit, ne peut être que remise en cause. Lecture jamais confortable, jamais contentée, donc, que celle du Black Herald, où chaque page, chaque texte, dans sa version originale et / ou dans sa traduction est source d’inquiétude. On attend avec une impatience certaine la deuxième livraison (automne 2011, nous dit-on) de ce super-héraut. » – Le Visage Vert, 01/2011
15:31 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, anglophone, francophone, poésie, nouvelle, essai, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/07/2011
Les colères d’un modéré
 Jean Prévost, Ni peur ni haine, articles réunis et présentés par Emmanuel Bluteau, Joseph K., « métamorphoses », 2011
Jean Prévost, Ni peur ni haine, articles réunis et présentés par Emmanuel Bluteau, Joseph K., « métamorphoses », 2011
Jean Prévost n’était pas un idéologue, loin de là. Les circonstances, sa lucidité, son patriotisme, son sens politique, son humanité, son volontarisme l’ont poussé à s’engager dans la Résistance ; son assassinat par l’ennemi nazi, le 1er août 1944 dans le Vercors, a privé ses lecteurs de son œuvre à venir.
Essayiste et romancier, Jean Prévost était aussi journaliste, et en tant que tel il ne mâchait pas ses mots. En 1933, il crée avec Alfred Fabre-Luce et Pierre Dominique l’hebdomadaire Pamphlets, qui paraîtra jusqu’en mars 1934 ; des trois, il sera le seul à garder sa dignité (les deux autres deviendront pendant l’occupation des collaborateurs notoires) ; mais sept ans avant la guerre, ils unissent leurs divergences dans la rédaction de ce périodique « engagé », au sens large du terme, c’est-à-dire prenant des positions indépendantes dans les troubles de l’époque.
La publication de Ni peur ni haine est une heureuse initiative. Les articles ici réunis selon le vœu de l’auteur dévoilent son éclectisme, son intelligence et sa modernité. S’il touche à des sujets très divers, c’est en pleine connaissance de cause : politiques, économiques, sociaux, culturels, internationaux, pédagogiques, tous les problèmes sont traités en quelques pages, mais toujours à fond, sans ménagements mais sans excès, avec l’entrain d’une personnalité hors du commun, à l’écart des partis pris et des idées reçues. Qu’il défende les quarante heures ou l’enseignement de l’éducation physique, qu’il réfléchisse à la montée de l’hitlérisme ou aux événements de février 1934, qu’il enquête sur la survie matérielle des écrivains ou qu’il disserte sur les différents moyens d’information, Jean Prévost s’exprime en toute liberté, sans « peur » ni « haine », avec la logique et la clarté d’un style vigoureusement adapté au propos. Chaque texte se lit non comme un roman, non comme un simple commentaire circonstanciel, mais comme un essai dont la pérennité, la constante actualité sautent aux yeux.
À l’auteur le dernier mot, on le lui doit bien : « Dans Pamphlets, au cours d’une année particulièrement riche, j’ai tenté de mettre au point ce que je devais à mon éducation socialiste, à ma formation intellectuelle d’élève d’Alain, toutes deux modifiées par une enquête contemporaine, qui a été l’objet principal de ma vie depuis 1930. Je n’ai à dissimuler ici ni ce que je dois à ma formation, ni ce que mon expérience y a changé ; dans ces domaines où la pensée n’a jamais qu’une valeur approchée, il faut se servir hardiment de ses idées comme de ses outils ».
Jean-Pierre Longre
En savoir un peu plus sur Jean Prévost :
http://www.gallimard.fr/Folio/livre.action?codeProd=A41017
http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/jean-prevost-aux-avant-postes
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/05/20/aux-jeu...
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/04/23/la-noblesse-des-parvenus.html
À noter que l’association « Les amis de Jean Prévost » (www.jeanprevost.org) publie la revue Aujourd’hui Jean Prévost, dont le dernier numéro propose, entre autres, un « Carnet de voyages » de l’auteur, ainsi que son texte Les sports en France. Un volume qui devrait susciter l’intérêt de tous les lecteurs de Jean Prévost, passés, présents et à venir.
Contacts : « Les amis de Jean Prévost », Maison du Patrimoine, 38250 Villard-de-Lans. Correspondance : Marie-Aline Prévost, maprevost@hfp.fr ou Emmanuel Bluteau, emmanuel.bluteau@jeanprevost.org .
16:13 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, revue, francophone, jean prévost, emmanuel bluteau, éditions joseph k., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/07/2011
« Machine mentale »
 Mark Twain, L’homme, c’est quoi ?, traduit de l’américain par Freddy Michalski, L’œil d’or, 2011
Mark Twain, L’homme, c’est quoi ?, traduit de l’américain par Freddy Michalski, L’œil d’or, 2011
L’auteur des Aventures de Tom Sawyer et de celles de Huckleberry Finn (entre autres) publia aussi, à partir de 1896, des textes philosophiques à forte teneur pessimiste, voire nihiliste, au nombre de trois : Lettres de la terre, L’étranger mystérieux et L’homme, c’est quoi ? (tous trois réédités récemment aux éditions de L’œil d'or).
L’homme, c’est quoi ? est un dialogue philosophique empruntant sa forme à la tradition platonicienne : comme Socrate avec ses disciples, un Vieil Homme soumet un Jeune Homme à sa maïeutique ; le va-et-vient des questions-réponses, parsemé non seulement de sentences et d’exemples persuasifs, mais aussi de rappels historiques, de paraboles, de fables, donne à l’enseignement une allure vive et théâtrale.
Comme l’indique le titre, c’est la question fondamentale de l’homme, de sa nature et de ses actions qui est au cœur du débat, et surtout celle de son libre-arbitre (ou plutôt de l’absence de celui-ci). Les six parties du livre orientent le Jeune Homme (et le lecteur) vers l’idée que l’homme, comme une machine, est mû de l’extérieur, que tout ce qu’il pense, émet, fait est de « seconde main » et n’a « pour autre finalité que de lui assurer ponctuellement, d’abord et avant tout, paix de l’esprit et confort spirituel » en lui donnant bonne conscience. À ce compte, l’homme est-il supérieur à la fourmi et aux autres animaux réputés intelligents ? Écoutons encore le vieux philosophe : « Le fait que l’homme sache distinguer le bien du mal prouve sa supériorité INTELLECTUELLE sur les autres créatures mais le fait qu’il soit capable de FAIRE le mal est la preuve même de son infériorité MORALE à toute créature qui ne le peut pas. »
La leçon est rude et ce texte, pour le moins, donne à penser. La réflexion, fortement sollicitée, voire poussée dans ses retranchements (c’est évidemment le but du dialogue), est égayée avec bonheur par les plaisants dessins de Sarah d’Haeyer ponctuant chaque chapitre. Un peu de sourire au milieu de ces déprimants constats.
Jean-Pierre Longre
22:19 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, usa, mark twain, freddy michalski, sarah d’haeyer, éditions l’œil d'or, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/07/2011
Drôle ou morbide ?
 Patrick Rambaud, Comment se tuer sans en avoir l’air, La Table Ronde, 1986, rééd. Folio, 2011
Patrick Rambaud, Comment se tuer sans en avoir l’air, La Table Ronde, 1986, rééd. Folio, 2011
L’un des propres de l’homme est « le suicide individuel » : les animaux, à part quelques exceptions circonstancielles et généralement collectives, ne prennent pas ce genre d’initiative. C’est en tout cas ce qu’explique Patrick Rambaud en introduisant son « Manuel d’élégance à l’usage des mal partis avec des ruses, des méthodes et des principes expliqués par l’exemple ». Comme un autre propre de l’homme est, selon Rabelais, le rire, il semble que Rambaud ait décidé de développer l’un en s’aidant de l’autre (et inversement).
Cela nous vaut quatorze moyens d’en finir sans honte et en préservant son amour-propre. Il n’est pas question de les énumérer ici, mais on saura que les quatorze chapitres qui les abordent ne sont ni vulgairement pédagogiques ni abstraitement théoriques. Tout passe par des anecdotes aussi tragi-comiques que convaincantes. Les personnages dont l’auteur nous narre le trépas volontaire, nous les connaissons, nous les côtoyons, c’est nous, en plus malheureux, en plus désespérés, en plus obstinés. Les circonstances de la vie les ont poussés à interrompre celle-ci « sans en avoir l’air » : il leur faut trouver un moyen de maquiller leur suicide en accident, en meurtre, en geste héroïque (et « con »), en infarctus, en maladie mortelle… et ils le trouvent.
Tout cela est fort drôle, même s’il nous arrive de rire jaune, tant le genre humain dans son entier est mis à rude épreuve et tend à la morbidité. Le style allant, allusif, expéditif parfois, imagé souvent n’est pas pour rien dans le plaisir que l’on prend à lire dans les pensées des personnages, à les accompagner dans leur cheminement souvent complexe, toujours fatal. Et il faut aller jusqu’au bout : dans sa conclusion, Patrick Rambaud rappelle que le suicide ne date pas d’aujourd’hui, loin s’en faut, et termine tout de même par un bel hymne à la vie.
Jean-Pierre Longre
18:07 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, récits, humour, francophone, patrick rambaud, la table ronde, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/05/2011
Odyssées urbaines
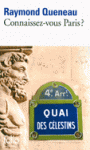 Raymond Queneau, Connaissez-vous Paris ?, Gallimard / Folio, 2011. Choix des textes, notice et notes d’Odile Cortinovis. Postface d’Emmanuël Souchier.
Raymond Queneau, Connaissez-vous Paris ?, Gallimard / Folio, 2011. Choix des textes, notice et notes d’Odile Cortinovis. Postface d’Emmanuël Souchier.
« Ma chronique eut, je dois le dire en toute modestie, un certain succès. Elle dura plus de deux ans ; à raison de trois questions pas jour, cela en fit plus de deux mille que je posai au lecteur bénévole », écrit Queneau dans un article daté de 1955 et reproduit en tête de volume. Cette chronique, donc, parut quotidiennement dans L’Intransigeant du 23 novembre 1936 au 26 octobre 1938. Le livre publié par Odile Cortinovis et Emmanuël Souchier ne reproduit pas les 2102 questions–réponses, mais 456, selon un choix raisonné (c’est-à-dire en fonction des réponses qu’on peut leur apporter encore actuellement).
Quelques exemples ? « Qui était le Père Lachaise ? » ; « Quel est le plus ancien square de Paris ? » ; « Combien y a-t-il d’arcs de triomphe à Paris ? » ; « Quelle est la première voie parisienne qui fut pourvue de trottoirs ? » ; « Quel rapport existe-t-il entre l’église Saint-Séverin et la république d’Haïti ? » ; « Depuis quelle époque les bouquinistes sont-ils établis sur les quais ? » ; « De quand datent les premiers tramways à Paris ? » ; « Combien y avait-il d’édifices religieux à Paris en 1789 ? »… On trouvera les 448 autres questions et toutes les réponses en lisant Connaissez-vous Paris ?
Au-delà de l’encyclopédisme, il y a une vraie philosophie de la promenade urbaine (des « antiopées, ou déambulations citadines », comme le rappelle et l’explique Emmanuël Souchier) et un sens aigu de l’histoire, marques indélébiles de la vie et de la pensée de Queneau. Et, sans en avoir l’air, le goût des voyages : « Je me disais : comme c’est curieux, il me semble que j’ai fait un long… très long… voyage. J’avais visité Paris ». Nous aussi.
Jean-Pierre Longre
18:41 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, francophone, raymond queneau, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2011
Aux jeunes écrivains, définitivement
 Jean Prévost, Traité du débutant, préface de Jérôme Garcin, Joseph K., « métamorphoses », 2011
Jean Prévost, Traité du débutant, préface de Jérôme Garcin, Joseph K., « métamorphoses », 2011
En douze brefs chapitres, Jean Prévost développe, à l’intention des jeunes gens qui s’apprêtent à écrire, tout, absolument tout ce qui leur est nécessaire, méthodiquement, vigoureusement. En 1929, à 28 ans, il se pose en maître qui, s’appuyant sur une expérience déjà riche (Jérôme Garcin, qui le connaît parfaitement, le rappelle dans sa préface), parle de la « vocation », de la « carrière », des « milieux » et du « travail » littéraires, de la parution du premier livre avec ce qui s’ensuit, du public et du succès éventuel, des attentes matérielles (« avancement », droits d’auteur)… De toutes les préoccupations, donc, de l’écrivain débutant.
Ces conseils, d’ordre pratique au moins autant qu’intellectuel, s’assortissent de jugements bien sentis, sans concessions, sur le monde littéraire – ce qui, de la part de Jean Prévost, n’est pas pour étonner. Les critiques (dont il était) : « À part deux ou trois exceptions dont vous connaissez les noms aussi bien que moi, les critiques n’ont aucune espèce d’influence : on les soupçonne toujours de camaraderie quand ils sont favorables ou défavorables, car le reste du temps, de peur de se tromper, ils n’ont même pas d’avis » ; le public (dont nous sommes tous) : « Je fixe donc le public des vrais lettrés à cinq ou six cents, […] et à cinq ou six mille le nombre des êtres falots et utiles qui agissent comme s’ils étaient lettrés, et acceptent le bon goût en confection » ; les auteurs (dont il reconnaissait volontiers, en connaissance de cause, qu’ils ne peuvent vivre de leurs droits) : « La plus vive des passions des littérateurs n’est ni la jalousie ni même la vanité : c’est la paresse » ; mais aussi : « La plupart des gens de lettres, en dehors de leurs œuvres, sont assez apathiques – ou bien bons critiques d’eux-mêmes – oui bien assez sages pour rire de qui les déteste » ; le travail d’écriture : « [Notre écrivain] ajoutera ce qui se peut ajouter : de la concision, et c’est bien ; des épithètes, et c’est mal. Le plus souvent des métaphores, où l’on semble croire, depuis cinquante ans, que consiste l’essentiel du style. Cela donne des Salammbô » (impitoyablement, Jean Prévost, c’est Stendhal contre Flaubert).
Jugements bien sentis, disais-je, jamais gratuits cependant. En un style impeccable (en guise de travaux pratiques), ils servent la cause de la littérature, sans vanité, sans illusions. Le « portrait imaginaire » qui clôt l’ouvrage met en avant la modestie du métier d’écrivain, son côté artisanal, se développant au cours d’une vie ordinaire où se cultive le plaisir plutôt que l’ambition. Ce traité, vieux de plus de quatre-vingts ans, est d’une étonnante modernité, d’un didactisme toujours actuel, d’une jeunesse définitive.
Jean-Pierre Longre
En savoir un peu plus sur Jean Prévost :
http://www.gallimard.fr/Folio/livre.action?codeProd=A41017
http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/jean-prevost-aux-avant-postes
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/04/23/la-noblesse-des-parvenus.html
09:54 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, jean prévost, jérôme garcin, éditions joseph k., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |