16/02/2026
« Traquer l’énigme »
 Pierre Péju, Échappées, Gallimard, 2025
Pierre Péju, Échappées, Gallimard, 2025
« Il y a des choses qui se passent pendant les guerres qu’on ne peut plus comprendre ensuite. » Voilà ce qu’un jour la mère de l’auteur lui dit alors qu’il était petit garçon. Devenu adulte et écrivain, Pierre Péju ne va pas vouloir « en rester là. » Il va « traquer l’énigme », tenter de retracer, en mêlant souvenirs, témoignages et fiction, ce que l’époque de l’occupation a recelé dans sa famille lyonnaise et autour d’elle, « parce que la voix humaine qui désire encore et toujours raconter n’est jamais morte. »
Le récit tourne autour du destin mystérieux et tourmenté d’une fillette, Stella Wirst, découverte dans une malle en osier en octobre 1942, en pleine occupation : le patron de l’entreprise « Le Déménagement moderne », où Aimée, la mère de l’auteur, est secrétaire, est un responsable de la Résistance locale, et ses employés, secrétaire comprise, apportent leur contribution, chacun à sa mesure, à la lutte clandestine, notamment pour entreposer et cacher du mobilier appartenant à des Juifs arrêtés et emmenés par les Allemands et leurs complices français. Visiblement, la petite Stella a échappé à la rafle subie par sa famille en se recroquevillant dans la malle découverte par les déménageurs. « Une enfant momentanément échappée du grand troupeau des petits êtres qu’on ramasse, qu’on embarque et déporte. Un signe ? Quel signe ? L’étoile du réconfort qui brille très faiblement dans beaucoup de noir ? » Aimée va la recueillir, la loger dans le petit appartement qu’elle occupe avec sa sœur, et n’aura de cesse que de mettre la petite Juive à l’abri des atrocités. Elle l’emmènera, avec la complicité d’un certain « Merlichte », chef résistant, dans une famille de la région grenobloise, des fermiers qui vont quelque temps après subir une rafle à laquelle Stella échappera, une fois encore recroquevillée dans un coin invisible. De cachette en cachette, elle sera recueillie en Suisse, et on n’aura plus de nouvelles jusqu’après la guerre, en 1948. Entretemps, Aimée a épousé Raymond, fils du patron, et en 1946 a donné naissance à Pierre, qui évidemment n’avait jamais vu Stella ; lorsqu’elle réapparaît dans la maison de campagne familiale, c’est pour disparaître à nouveau…
« Les histoires non dites rôdent sans fin. Elles hantent qui elles peuvent, qui elles trouvent sur leur chemin de nuit et de brouillard. » L’histoire de Stella Wirst, Pierre Péju ne la connaîtra que plus tard, et il découvrira certains secrets petit à petit, par exemple comment son père a perdu une jambe. Son récit est aussi un saisissant tableau de la vie lyonnaise dans les années noires de l’occupation, vues du côté de la Résistance, à laquelle la famille Péju participa largement. Jusqu’au surprenant épisode final, la figure de Stella court mystérieusement, ouvertement ou en filigrane, en « échappées » et en retours furtifs, tout au long d’un roman captivant, qui mêle habilement, sans artifices ni faux-semblants, les existences individuelles et l’Histoire collective, la narration objective et l’authentique émotion.
Jean-Pierre Longre
16:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, pierre péju, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/02/2026
« Chemin brisé »
Lire, relire... Martin Šmaus, Petite, allume un feu… Traduit du tchèque par Christine Laferrière. Éditions des Syrtes, 2009, Syrtes Poche, 2026
Le clan Dunka représente, en quelque sorte, la synthèse des familles tziganes, de leurs conceptions (ou non conceptions) de l’existence. « Les Dunka ne voulaient faire de mal à personne : ils voulaient vivre. Et ils vivaient comme ils en avaient l’habitude depuis des siècles, oubliant la veille et ne voulant pas savoir ce que leur apporterait le lendemain. Ils vivaient des milliers de vies, naissaient et mouraient sans cesse chaque jour ». C’est dans ce contexte que naît et grandit Andrejko, voleur hors pair, et pour cela choyé par les petits qui profitent de ses cadeaux, jalousé par les grands qui, ne pouvant l’égaler, se dressent violemment contre lui.
conceptions (ou non conceptions) de l’existence. « Les Dunka ne voulaient faire de mal à personne : ils voulaient vivre. Et ils vivaient comme ils en avaient l’habitude depuis des siècles, oubliant la veille et ne voulant pas savoir ce que leur apporterait le lendemain. Ils vivaient des milliers de vies, naissaient et mouraient sans cesse chaque jour ». C’est dans ce contexte que naît et grandit Andrejko, voleur hors pair, et pour cela choyé par les petits qui profitent de ses cadeaux, jalousé par les grands qui, ne pouvant l’égaler, se dressent violemment contre lui.
Dans la Tchécoslovaquie contemporaine, des dernières années du communisme à la partition du pays, en passant par l’ouverture et la démocratisation, avec les enthousiasmes et les angoisses qu’elles suscitent, Andrejko est ballotté, avec une famille fluctuante et se délitant peu à peu, d’un lieu à un autre : du hameau campagnard, proche de l’Ukraine, où la tribu vivait selon les traditions, aux villes grises, froides, inhospitalières (Ostrava, Prague, Plzen), d’un appartement délabré à la maison de correction… De gare en gare, de rue en rue, le petit garçon va devenir un jeune homme marqué par la marginalité dans la société des « blancs », mais aussi dans celle des Tziganes devenus des « Roms » citadins, victimes et coupables de trafics en tous genres, oublieux de la liberté originelle.
 Un jour Andrejko retourne au lieu rêvé de son enfance, le reconstruit, y aime sa belle cousine Anetka qui lui donne une petite fille, travaille même avec les bûcherons pour gagner la vie de sa nouvelle famille. Ansi se tisse son destin marqué par le besoin d’indépendance sans faille et d’amour absolu, puis par la tragédie. « C’est ainsi qu’Andrejko voyait son existence : un souffle saccadé et rauque, un chemin à travers des racines égarées, un chemin cahotant, un chemin brisé sur lequel restaient des cicatrices en forme de croix et des rides profondes, telle l’écorce éclatée d’un vieil arbre… ».
Un jour Andrejko retourne au lieu rêvé de son enfance, le reconstruit, y aime sa belle cousine Anetka qui lui donne une petite fille, travaille même avec les bûcherons pour gagner la vie de sa nouvelle famille. Ansi se tisse son destin marqué par le besoin d’indépendance sans faille et d’amour absolu, puis par la tragédie. « C’est ainsi qu’Andrejko voyait son existence : un souffle saccadé et rauque, un chemin à travers des racines égarées, un chemin cahotant, un chemin brisé sur lequel restaient des cicatrices en forme de croix et des rides profondes, telle l’écorce éclatée d’un vieil arbre… ».
Livre sans concessions, ni pour les uns ni pour les autres, Petite, allume un feu… est à la fois un chant désespéré face aux cruautés de l’Histoire et de la société et une ode à l’amour et à la liberté. La musique, languissante ou endiablée, y tient la place qu’elle doit tenir ; et aussi la nature, forêts, montagnes, clairières, en toutes saisons accueillantes au Tzigane errant. Tragédie au vaste souffle poétique, le roman de Martin Šmaus jette un regard aussi tendre que lucide sur les hommes, ni tout à fait bons ni tout à fait mauvais.
Jean-Pierre Longre
08:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roman, tchéquie, martin smaus, éditions des syrtes, jean-pierre longre, christine laferrière | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/02/2026
Force de vie et de mort
 Jacques Brochard, Nuits de feux, Le Vampire Actif, 2025
Jacques Brochard, Nuits de feux, Le Vampire Actif, 2025
« Avez-vous déjà vécu un incendie ? je veux dire un violent incendie, celui qui détruit non seulement un bâtiment, une maison, mais par la dimension spirituelle de ce qu’il détruit, s’attaque aussi à votre âme, à vos souvenirs, à votre amour, à tout votre être ? » Telles sont les questions que Jacques Soulié, un inconnu rencontré sur un promontoire dominant la mer, pose au narrateur. Et le récit qui s’ensuit se déroule, en quelque sorte, à la lumière étrange, terrible et fascinante des feux qui le ponctuent.
Jacques Soulié, le protagoniste, fait ses confidences à son interlocuteur, qui nous les rapporte indirectement ou directement. Instituteur nommé sur une côte peu accueillante, il fait la connaissance de Marine, qui, arrivée de la mer, vient périodiquement se sécher et se chauffer devant sa cheminée, moments de bonheur au cours desquels il profite des « senteurs boisées de son corps. » Mais à la suite d’un feu dangereux qu’il a allumé pour guider la jeune femme sur son bateau, l’Autorité anonyme et implacable qui gouverne le pays le déplace sur une petite île qui fait face à la côte. « Monsieur le Professeur » va travailler et loger dans une école de sept élèves disciplinés et apathiques, et vivre au milieu d’habitants peu loquaces. Alexandre le cantonnier, personnage bizarre, lui explique : « C’est une île […] dans laquelle on arrive, mais dont on ne repart plus, on vit ici parce que des parents vous y ont fait naître, ou l’on vient parce que l’A vous y a reclus en exil pour un temps indéfini. » Et ceux qui sont éventuellement autorisés à partir ne le font pas « car presque tous ceux qui ont vécu ici de nombreuses années ne souhaitent plus retourner à ce qui leur apparaît comme un nouvel exil. »
Ce qui fascine Jacques Soulié, dans cette île apparemment sans grand intérêt, ce sont les feux : grand feu de la Saint-Jean rassemblant la population, feux épars, mais aussi incendies de maisons, allumés par qui ? Et il y a le feu de la cheminée d’Alaine, jeune femme sauvage et séduisante qui, étrangement, lui rappelle Marine, presque jusqu’à la confusion. Alaine et Jacques s’éprennent l’un de l’autre, passant des soirées tendres, puis empreintes de passion, devant la cheminée éclatante. Cela jusqu’à un épisode exaltant et tragique : « Je vous dirai ce que fut cette journée pour moi, ce qu’elle représente encore comme le moment le plus précieux de ma vie, celui de mes souvenirs dans lequel j’aime à m’immerger. Je vis de ce souvenir, il enchante, mais désole encore mon existence. »
Le récit de Jacques Soulié, donc le roman de Jacques Brochard, relève d’une sorte de réalisme fantastique, rythmé par ce que le feu peut avoir de chaleureux et d’effrayant, force de vie et de mort. De ce récit, narrateur/confident et lecteurs garderont en mémoire l’intensité dramatique et la plénitude poétique.
Jean-Pierre Longre
16:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jacques brochard, le vampire actif, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/01/2026
Les voix du corps, de l’âme et de l’esprit
 Alta Ifland, Voix de Glace / Voice of Ice, recueil bilingue français-anglais, préface de John Taylor, Les Figues / Puctumbooks, 2025
Alta Ifland, Voix de Glace / Voice of Ice, recueil bilingue français-anglais, préface de John Taylor, Les Figues / Puctumbooks, 2025
Le parcours biographique et linguistique d’Alta Ifland est singulier : de la Roumanie aux États-Unis, des États-Unis à la France, du roumain à l’anglais, de l’anglais au français. Les textes de cette « Voix de Glace » qu’elle fait entendre ici sont, en l’occurrence, présentés en français et en anglais, les deux langues de l’exil. Et, comme s’ils voulaient recouvrir une vie entière, ils commencent avec « Naissance » et finissent avec « Mort », en une sorte de lutte commune : « Nous luttons contre la mort et nous luttons contre la vie. »
Cette double lutte existentielle est d’ailleurs au cœur de certains textes invoquant un dédoublement de la personnalité, à la fois présence et reflet (comme dans la « glace », polysémie suggérée par le titre), corps et ombre, mère et enfant, « femme vêtue de blanc » et « homme en noir ». « Je sais que moi n’est que l’ombre douteuse et invraisemblable de mon double. » La référence à Rimbaud proposée par John Taylor dans sa préface est judicieuse – et l’on pourrait aussi penser à d’autres poètes comme Hector de Saint-Denys Garneau. Cela peut induire, clairement ou non, des tableaux fantastiques telle la mise à nu des corps devenus squelettes (« la chair épluchée »), les visions de la mort et de la destruction des êtres (« Les yeux crevés », « Les lépreux ») ou des choses (« Ses murs s’écroulent avec un bruit de neige blessée à vif »), et la quête désespérée de soi : « Quelque part derrière une porte dans une ville il y a un corps qui est le mien. Mais je ne saurai jamais lequel. » Ce qui n’exclut pas les images à caractère surréaliste, mettant en regard, par exemple, la « noblesse » et un « spectacle digestif », ou présentant des scènes où se côtoient « une bûche de Noël mangée par un chien inexistant », une « dentelle », le « bureau de Tourgueniev » et « un tournesol dont je n’ai rien à dire ». Le jeu sur les mots, parfois, forme une image étrangement cubiste : « Le nez de mon dos se reflète bizarrement dans l’œil de ma cheville. »
Voilà, dira-t-on, que l’humour n’est pas loin, et on aura raison. Il est là, parfois avec « la douceur des choses », parfois dans des scènes tournant au burlesque, parfois encore dans des portraits sarcastiques, comme ceux des « professeurs au nez pédant et hoquets ataviques » ou d’une voisine « le visage tendu par les nombreuses chirurgies esthétiques, la peau translucide à cause du sérum, la bouche ouverte dans la grimace permanente d’un sourire avorté… » Au-delà du sourire sans concessions, il y a le temps qui passe et les souvenirs qui nous rappellent qui est l’autrice, semblable à « cette émigrée dont je connais l’histoire, une jeune fille qui débarqua – pardon, atterrit – à New York un jour de septembre au début des années quatre-vingt-dix », elle qui se rappelle « la cuisine d’été » dans son pays natal : « Et le feu ne se lassait pas de se réfléchir dans ses yeux, y laissant les souvenirs à venir, et dans ses yeux le temps s’arrêtait et le présent coulait dans le passé et le passé dans l’avenir, riche de silence et de mots. »
Ensemble aux tonalités et aux genres divers, tenant tantôt (ou en même temps) du poème en prose et du récit, de l’évocation onirique et du réalisme morbide, du conte et du mythe, de la réflexion et de la parodie, cette Voix de Glace en appelle à l’esprit, à l’âme, au corps, et offre un concert très dense, quasiment inépuisable, auquel, une fois que l’on a commencé à l’écouter, on a du mal à se soustraire.
Jean-Pierre Longre
19:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, francophone, alta ifland, john taylor, les figues puctumbooks, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/01/2026
Après Le disparu du Caire, une publication à venir le 18 février 2026…
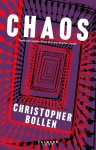 Christopher Bollen, Chaos, traduit de l’anglais par Blandine Longre, Calmann-Lévy, 2026
Christopher Bollen, Chaos, traduit de l’anglais par Blandine Longre, Calmann-Lévy, 2026
Présentation :
Maggie Burkhardt, 81 ans, veuve cosmopolite au tempérament bien trempé, arrive à l’hôtel Royal Karnak au Caire pour fuir un incident survenu en Suisse. Dans ce palace défraîchi au bord du Nil, elle trouve un semblant de paix : une suite confortable et quelques amis discrets. Tous les ingrédients nécessaires pour un nouveau départ, en incarnant le rôle de la gentille mamie de la chambre 309.
Mais un jour, une jeune mère fragile et son brillant fils de huit ans débarquent à l’hôtel et Maggie ne peut s’empêcher de s’immiscer dans l’intimité de cette famille. Peu à peu, Maggie va découvrir des éléments troublants sur ses nouveaux voisins et ce qui avait commencé comme un lien affectif deviendra vite une spirale infernale et violente.
Dans la chaleur écrasante de l’Égypte, une guerre psychologique s’engage, feutrée mais implacable. Qui en sortira vainqueur ?
19:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, christopher bollen, blandine longre, calmann-lévy | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/01/2026
Les mots de la terre
 Lire, relire... Jean-Loup Trassard, Conversation avec le taupier, Le temps qu’il fait, 2007
Lire, relire... Jean-Loup Trassard, Conversation avec le taupier, Le temps qu’il fait, 2007
"Défenseur de la mémoire rurale, de ses traditions, de sa langue et de ses métiers, Jean-Loup Trassard est décédé le 13 janvier à l’âge de 92 ans. Auteur d’une œuvre pour le moins originale dans le paysage littéraire contemporain – elle marie formes verbales et formes visuelles : récits, romans, relevés de témoignage, photographies, livres illustrés –, il a fait du bocage mayennais le centre matriciel de son écriture." ("La Lettre des anges", Le Matricule des anges, 21/12/2026)
Qui se soucie encore des taupes ? Quelques jardiniers, quelques vacanciers retraités soucieux de leur pelouse, quelques rares paysans ? En tout cas, foi de taupier, il y en a de moins en moins, de ces petites bêtes qu’on ne voit pas, qui marchent sous terre, creusant les galeries où elles trouvent leur pitance, laissant derrière elles ces petits monticules qui empêchent de faucher.
Autrefois, il n’y a tout compte fait pas si longtemps que ça, pour s’en débarrasser, les fermiers pouvaient engager un « taupier », sorte de « journalier » assez miséreux mais libre, vagabond mais quotidiennement attaché au même travail, aux mêmes champs, aux mêmes maisons, aux mêmes familles chez qui il se rendait régulièrement. C’est l’un d’entre eux, Joseph Heulot, que Jean-Loup Trassard a su faire parler et dont il a su restituer la vie, avec ses propres mots d’écrivain, avec ceux de son interlocuteur, avec ceux de la campagne – mots du terroir traduits en marge pour éclairer le citadin.
Par la grâce de cette « conversation » entre deux hommes qui s’entendent pour de bon, on apprend beaucoup. D’abord, comment chasser les taupes le plus efficacement possible, alors que certains ont tout essayé : le poison (dangereux pour le bétail et les poules), les boules de gaz (qui ne font que les repousser ailleurs), le fusil (qui en laisse trop)… Non. Il faut être méthodique, prendre son temps, ne pas regarder aux heures de marche et à la fatigue, ne pas hésiter à se salir, repérer les passages, et avoir de l’expérience. Poser les pinces et les « pièges américains » qui claquent juste quand il le faut, ce n’est pas donné à tout le monde ; chasser « à la houette », c’est plus rapide, mais il faut être là au bon moment. On apprend aussi beaucoup sur les taupes – c’est bien normal : sur leur vie, leur survie, leur mort – et leurs peaux que Joseph Heulot peut revendre pour se faire trois sous de plus, et qui servent à faire des manteaux aux dames. On apprend encore sur la vie dans les fermes – l’essentiel, mais juste ce qu’il faut ; car le taupier n’est pas bavard là-dessus, par nature sans doute, par nécessité surtout : ne pas s’immiscer dans la vie des gens, ne pas parler aux autres de ce qui se passe chez les uns, et vice-versa, c’est le seul moyen de rester en bons termes avec tous et de continuer à travailler chez tout le monde. On apprend enfin sur le taupier lui-même, homme pauvre, dont le logis « ressemble à un terrier », qui se nourrit de peu, mais qui garde en lui « chaque champ de son territoire », et qui nous permet, grâce à ses mots, de mieux comprendre les hommes et leur attachement à la terre.
Jean-Pierre Longre
10:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, jean-loup trassard, le temps qu’il fait | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/01/2026
Au-delà de la mort, l’amour
 Nikos Kokàntzis, Gioconda, traduit du grec par Michel Volkovitch, illustré par Anne Defréville, éditions de l’Aube, 2025
Nikos Kokàntzis, Gioconda, traduit du grec par Michel Volkovitch, illustré par Anne Defréville, éditions de l’Aube, 2025
« Ceci est une histoire vraie. » Telle est la première phrase du livre, et l’on peut croire son auteur, tant son récit respire la sincérité, et s’ancre dans l’Histoire de son pays. Nous sommes en Grèce, à Thessalonique, pendant l’occupation allemande. Deux familles voisines vivent en bonne entente, les enfants et les adolescents se retrouvent et s’amusent sur le terrain en friche qui sépare leurs deux maisons. C’est là que Nikos s’éprend de Gioconda, et que se manifeste un amour réciproque et irrépressible. Plaisir des jeux partagés, première crise de jalousie, premier baiser. « Je me souviens encore de ses lèvres contre les miennes, de ce frisson de bonheur. L’amour débordait par mes yeux, mes oreilles, ma bouche, le bout de mes doigts. Ma peau était amoureuse, mon cœur, ma gorge, tout mon corps. Et son amour à elle venait vers moi, j’étais traversé par cette vague chaude, lisse, affolante. Nous ne dîmes pas un mot. Nous étions si proches l’un de l’autre qu’il n’y avait pas de place pour des mots. »
« Amour des âmes, amour des corps », écrit le traducteur Michel Volkovitch dans sa postface. C’est exactement cela, et cet amour aurait pu durer, s’il n’y avait eu le contexte terribe : la présence de l’occupant (contre lequel Nikos s’engage en participant, à la mesure de son âge (15 ans), à la Résistance) ; et l’antisémitisme galopant. Car Gioconda est juive. Une fin d’après-midi, toute la famille est emmenée dans un camion militaire ; Nikos et Gioconda se disent un adieu déchirant : « Elle se mit à trembler tout entière, elle n’en pouvait plus, des sanglots silencieux montèrent à sa gorge, ses larmes débordèrent et s’unirent aux miennes sur nos visages collés l’un à l’autre – ultime contact, promesse, adieu ».
Pour Nikos Kokàntzis, qui rédige ce récit plus de trente ans après la disparition de Gioconda à Auschwitz, celle-ci « n’est plus qu’un rêve. » Mais un rêve qui reprend réalité dans son écriture, en des scènes à la fois réalistes et poétiques, à la saveur érotique et sentimentale, des scènes parfois même fantastiques, telle l’évocation des splendides incendies provoqués par les bombardements alliés sur les entrepôts investis par les Allemands. Les belles illustrations d’Anne Defréville, colorées ou sombres, évocatrices et suggestives, soulignent esthétiquement les épisodes importants d’une narration émouvante, pleine de sensibilité et d’intensité.
Jean-Pierre Longre
19:11 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, grèce, nikos kokàntzis, michel volkovitch, anne defréville, éditions de l’aube, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/01/2026
Un retour à Salé
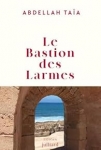 Lire, relire... Abdellah Taïa, Le Bastion des Larmes, Julliard, 2024, Folio, 2026
Lire, relire... Abdellah Taïa, Le Bastion des Larmes, Julliard, 2024, Folio, 2026
Dans Vivre à ta lumière, Abdellah Taïa relatait la vie de Malika, mère lumineuse et obstinée, qui avait économisé « encore et encore » pour construire une maison où faire vivre les onze personnes qui composaient la famille. Dans Le Bastion des Larmes, Youssef, devenu professeur en France, revient momentanément à Salé après le décès de cette mère volontaire (les changements de personnes, de noms et d’activités laissent transparaître, quoi qu’il en soit, le caractère autobiographique du roman) pour vendre le dernier appartement de la maison, dont ses sœurs ont déjà liquidé leurs parts, ces sœurs qui ne se privent d’ailleurs pas de faire des reproches aux fils exilés : « C’est nous qui faisons des efforts pour garder vivante cette mémoire. Pas vous, les garçons. Ni le grand frère Slimane qui nous a oubliées depuis longtemps. Ni toi, Youssef, là-bas, à Paris, en train de vivre je ne sais quoi de soi-disant libre et dont tu ne dis jamais rien. Ni Karim, parti du Maroc comme un voleur. Ce n’est pas vous, les garçons, mais nous, les sœurs, qui faisons tout pour que ce qui a été construit ne s’effondre pas d’un coup. »
 Mais le peu de temps que Youssef reste au Maroc fait ressurgir cette mémoire. Celle de Najib, son amant des années 1980 qui l’a trahi, qui est passé du côté de ceux qui les opprimaient parce qu’ils ne vivaient pas selon les normes, « ceux qui nous tuent tous, chaque jour et chaque nuit. » Najib qui a lui-même été trahi et qui, pour se venger de tous les supplices subis, de toutes les humiliations imposées, est devenu à Salé un trafiquant tout puissant, le roi de la drogue, mais un « Chérif », un saint, « le saint pédé de Salé », « la générosité même avec les habitants », emmenant tout le monde dans sa corruption, et dont les funérailles vont être suivies par une foule considérable. C’est par lui, par son fantôme, que Youssef va découvrir le « Bastion des Larmes », « le cœur même de la ville », là où il peut pleurer Najib, un « endroit magique » au pied de la muraille qui longe l’océan, et dont l’histoire remonte au XIIe siècle, lorsque les Castillans massacrèrent la population de Salé.
Mais le peu de temps que Youssef reste au Maroc fait ressurgir cette mémoire. Celle de Najib, son amant des années 1980 qui l’a trahi, qui est passé du côté de ceux qui les opprimaient parce qu’ils ne vivaient pas selon les normes, « ceux qui nous tuent tous, chaque jour et chaque nuit. » Najib qui a lui-même été trahi et qui, pour se venger de tous les supplices subis, de toutes les humiliations imposées, est devenu à Salé un trafiquant tout puissant, le roi de la drogue, mais un « Chérif », un saint, « le saint pédé de Salé », « la générosité même avec les habitants », emmenant tout le monde dans sa corruption, et dont les funérailles vont être suivies par une foule considérable. C’est par lui, par son fantôme, que Youssef va découvrir le « Bastion des Larmes », « le cœur même de la ville », là où il peut pleurer Najib, un « endroit magique » au pied de la muraille qui longe l’océan, et dont l’histoire remonte au XIIe siècle, lorsque les Castillans massacrèrent la population de Salé.
Livre d’une grande nostalgie et parfois d’une grande cruauté, où des scènes de tendresse voisinent avec quelques scènes difficilement soutenables, comme celles qui décrivent les viols collectifs de jeunes garçons connus comme homosexuels, Le Bastion des Larmes se termine par une lettre de Youssef à sa sœur Kamla, demeurant à Agadir, une lettre sans concessions pour le passé, ses beautés et ses turpitudes, les amours et les haines, mais une lettre magnifique qui veut le rêver, ce passé. « Depuis mon retour à Paris, je passe mes jours et mes nuits à me souvenir de nous autrefois, à revenir à notre lien. Notre pauvreté. Notre beauté. Notre paradis. Notre grande fiction. Je sais que je réécris et que je réinvente sans cesse ce passé. Malgré le noir et le désespoir en moi, malgré les traumatismes et les crises de panique, j’éprouve cette nostalgie étrange d’un espace qui n’a sans doute jamais existé comme aujourd’hui. Une force obscure me pousse à retrouver ce passé, à l’embellir. À ne voir que le printemps, les fleurs, les lilas, les mimosas, les marguerites. » La magie de la fiction, et de la plume d’Abdellah Taïa.
Jean-Pierre Longre
16:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, maroc, abdellah taïa, julliard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/12/2025
Les oubliés du Bărăgan
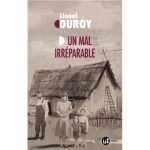 Lionel Duroy, Un mal irréparable, Mialet-Barrault, 2025
Lionel Duroy, Un mal irréparable, Mialet-Barrault, 2025
Depuis quelques années, Lionel Duroy, de son propre aveu, n’en finit pas avec la Roumanie. Dans Eugenia (2018), à travers une relation sentimentale entre l’écrivain Mihai Sebastian et une jeune héroïne de fiction, il retrace l’histoire de la montée du fascisme, du nazisme et de l’antisémitisme dans le pays, insistant notamment sur le pogrom de Iaşi ; dans Mes pas dans leurs ombres (2023), Adèle, jeune Française d’origine roumaine, part enquêter sur les lieux des massacres des Juifs dans les années 1940, entre Roumanie, Moldavie et Ukraine.
Un mal irréparable est aussi, toujours dans le registre romanesque, un retour sur le passé meurtrier de la Roumanie. Frédéric (Friedrich) Riegerl, écrivain français dont le père était né à Czernowitz (ville austro-hongroise, puis russe, roumaine, et maintenant ukrainienne), et dont la mère était originaire de Chişinau, en Moldavie, part sur les traces de son enfance, dont il a oublié des pans entiers. C’est en faisant le voyage à Czernowitz, puis à Brăila (ville natale de Panaït Istrati, ce qui fera souvent revenir au fil des pages l’évocation des œuvres de l’écrivain), que Frédéric va éplucher les archives de ses parents qu’il n’a jusque-là pas consultées alors qu’elles étaient à portée de main dans leur domicile français, va lire des courriers et des témoignages et va rencontrer des personnes susceptibles de le renseigner sur les tribulations de sa famille. C’est alors qu’il découvre le témoignage d’une certaine Elena, qui s’avère être sa mère ; un récit pathétique, qui occupe une partie entière du roman, et qui donne des détails sur le sort effrayant que les communistes roumains alors au pouvoir ont fait subir à sa famille (ses parents, sa petite sœur Angelica, et lui-même, Friedrich), entre 1951 et 1957.
Un sort effrayant, oui : la déportation de la famille, comme d’autres, depuis Orşova, dans le Banat, où elle s’était installée après avoir fui les Russes, vers le Bărăgan, où chacun doit s’efforcer de survivre dans un dénuement complet, soumis aux intempéries, à la faim, à la rudesse insensible des soldats. La petite Angelica, née sur place dans les conditions que l’on devine, y mourra et y sera enterrée, et Friedrich, confié un temps à une famille d’accueil, gardera un traumatisme indélébile de cette période, qu’il aura presque complètement occultée jusqu’à ses découvertes faites à un âge fort avancé, croyant jusque là que pour sa famille la masure du Bărăgan était une maison de campagne. Il comprend alors pourquoi sa mère, férue de Panaït Istrati, ne lui avait jamais lu Les chardons du Bărăgan, et pourquoi les lieux de son enfance se superposaient dans sa mémoire : « Jamais aucune mention du Bărăgan dans mon histoire […], pour la bonne raison que jusqu’à aujourd’hui ces lieux se confondaient dans mon esprit. Nous les avions fuis, et dans notre hâte d’être bientôt français nous avions sûrement voulu les effacer. Mais comment est-ce possible puisque nous avions laissé là-bas Angelica ? Enfin, mes parents, car moi, je l’avais pour ainsi dire… oubliée. » L’oubli, au cœur de ce récit pluriel et terrible, de cette quête poignante de la vérité.
Jean-Pierre Longre
18:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, lionel duroy, mialet-barrault, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/12/2025
L’épopée des « petites gens »
 Lionel-Édouard Martin, Ferpent, soleil par terre, Le Vampire Actif, 2025
Lionel-Édouard Martin, Ferpent, soleil par terre, Le Vampire Actif, 2025
Du haut de sa terrasse, le vieil Albert regarde et écoute le monde. Celui de maintenant, avec les voitures qui passent sur la route et les bruits suggestifs qui montent de l’intérieur de la maison ; celui d’autrefois, de l’amour et de la mort, des existences simples et compliquées.
« Alors, faut bien qu’ils existent, Blaise et Orlande, Jean-Claude et la Dédée, même s’ils parlent dans ma tête, faut bien qu’ils existent.
Et tous les morts avec, les fondeurs, Mone, Pierre, Giselle.
Câlin.
Tout ça d’existence, présente comme passée.
On ne peut pas douter de toute cette existence. Faut bien que ça existe…
Je les entends, sont emplis, tous, d’une grosse existence… »
On le voit, on l’entend, Lionel-Édouard Martin coule son style (comme coule le ferpent fondu des forgerons, comme coule la semence de l’homme sur la terre ainsi fertilisée) dans le langage de ses personnages : celui d’Albert, donc, mais aussi, en monologues distincts, ceux de son fils Jean-Claude, de Rolande (ou Orlande) sa bru, D’Andrée (ou Dédée) qu’il a aimée, de Blaise le petit-fils de celle-ci, et en « narrations » qui éclairent la vie locale et familiale, les plaisirs et les douleurs, les gestes et les habitudes. « On est sans doute de petites gens, mais on aime les choses bien faites, belles, inscrites dans une lignée de gestes qui imprègnent, façonnent. On vit comme ça, dans une continuité : rituels immuables, matières riches, guère nombreuses mais que l’on respecte. »
Et il y a la manière de rapporter tout cela, de faire connaître peu à peu ce qui se passe de grand dans ce petit monde ; et c’est vrai, on comprend peu à peu, au fil des mots, des phrases, ce qui sort du plus profond, du plus brûlant de ces « petites gens », de leur esprit, de leur cœur et de leur corps. Au plus fort de ces « histoires minuscules », la mort du petit-fils Colin (« Câlin ») et l’énorme vengeance sur ce qui a causé cette mort : un vrai morceau d’épopée familiale ! Le reste à l’avenant. Voilà un beau roman, une belle partition à plusieurs voix et à plusieurs mouvements, violence et apaisement, lenteur et rapidité, qu’il faut déchiffrer patiemment pour en goûter la saveur musicale et poétique.
Jean-Pierre Longre
19:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, lionel-Édouard martin, le vampire actif, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/12/2025
Une émouvante enquête
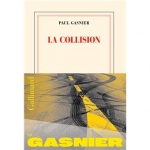 Paul Gasnier, La collision, Gallimard, 2025
Paul Gasnier, La collision, Gallimard, 2025
À une époque où le fait divers prend le pas, dans les informations servies par les médias, sur les autres événements, le livre de Paul Gasnier donne à réfléchir d’une manière sereine, sérieuse et touchante. Il écrit à ce propos : « Ces événements, quand on les prend un à un et qu’on les décortique, peuvent raconter leur époque et l’absurdité tragique qui pend au nez de chacun, mais leur prolifération, accompagnée à chaque fois de conclusions et de solutions clé en main, est devenue si abondante qu’elle a presque l’effet inverse, celui d’annihiler leur possible signification. […] La passion du fait divers permet à l’opinion de trouver dans l’indignation sporadique une forme de divertissement infini, et une inépuisable source d’ostentatoire vertu. »
Car la « collision » dont il est ici question est bien un « fait divers », qui toutefois touche l’auteur de si près qu’il aurait pu se réfugier dans la colère ou le désespoir. « Le 6 juin 2012, à 17h13 précisément […], Saïd, dix-huit ans, qui est alors délinquant récidiviste, remontait une rue étroite des pentes du quartier de la Croix-Rousse, en roue arrière sur une moto cross lancée à 80 km/h. Après quelques mètres, il en perdait le contrôle. La roue avant percuta en pleine tête une femme de cinquante-quatre ans, qui pédalait devant lui à vélo. Cette femme, c’était ma mère. L’hôpital Lyon Sud de Pierre-Bénite la déclara décédée une semaine plus tard. » Pierre Gasnier a alors vingt et un ans. Dix ans plus tard, il décide de faire le récit de ce drame, en se préservant des simplifications manichéennes.
Faisant alterner les faits à l’état brut (reproductions textuelles de documents, dialogues, courriers, narrations objectives d’événements), l’enquête auprès de la famille de Saïd, l’histoire de ses propres parents et les réflexions sur la confrontation des différents microcosmes qui composent et divisent notre société, l’auteur tente d’analyser les tenants et les aboutissants du drame, se demandant si et comment il aurait pu être évité. Ce faisant, il n’occulte ni l’émotion qui le ronge toujours, ni la responsabilité d’un jeune homme qui, façonné par l’argent facile de la drogue et la fréquentation d’individus peu recommandables (alors que les autres membres de sa famille sont tout à fait respectables), reproduit durablement le schéma de la délinquance, ni les méfaits d’une organisation sociale dont les « filets […] n’accrochent plus, ne rattrapent plus, et où l’obsession de soi permet tout. » Le récit de Paul Gasnier se lit à la fois comme une enquête objective et comme un témoignage émouvant, d'une grande humanité ; c’est cette complémentarité qui, outre ses qualités narratives, en fait l’un des intérêts majeurs.
Jean-Pierre Longre
19:52 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, essai, francophone paul gasnier, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2025
La valse des personnages
 Mireille Hilsum, La fille au manteau jaune, Pont 9, 2025
Mireille Hilsum, La fille au manteau jaune, Pont 9, 2025
Longtemps Mireille Hilsum a travaillé dans les marges de la création littéraire, dévoilant autant que possible à ses étudiants les mystères des œuvres d’Aragon, de Modiano, de Perec et alii, et publiant des études, des essais, des articles sur ses auteurs de prédilection. Elle aurait pu se contenter de ce brillant bilan. Mais non ! Elle a voulu sortir des marges, franchir la frontière qui la séparait de la création même – comme ses semblables le font parfois –, et s’est aventurée en terrain à la fois connu et accidenté, traçant ses propres chemins aux subtiles et complexes sinuosités.
Imaginons. Passant la frontière avec armes et bagages, l’autrice (l’ôtrice, comme elle s’orthographie elle-même, on comprendra pourquoi) pourrait avoir ouvert malencontreusement la valise où elle avait enfermé ses personnages favoris, et voilà que ceux-ci en auraient profité pour s’échapper, s’envoler comme Icare et d’autres le firent dans le dernier roman de Raymond Queneau… Mézalor (comme aurait écrit celui-ci), que faire ? Pleine de ressources, M. H. prend ses personnages au bond, et imagine une agence spécialisée créée par sa narratrice : « Cela faisait bientôt douze ans que je travaillais à l’enlèvement des personnages romanesques. […] C’est ainsi que j’étais devenue une ôtrice indépendante. Habituellement je travaillais au repeuplement du roman contemporain. » Tout naturellement, on aura commencé avec une séduisante allusion métropolitaine, annoncée par le titre, à La petite Bijou de Patrick Modiano. Mais ce n’est qu’un début. Et alors… Nous nous surprenons à fréquenter Balzac, Stendhal, Flaubert, Louise Colet (au passage salutairement réhabilitée), Maupassant, Zola – avec le « prélèvement » de leurs protagonistes destinés à être « recyclés » dans la littérature contemporaine.
C’est ainsi que nous fréquentons aussi Aragon, Emmanuel Bove, Georges Perec, Patrick Modiano (bien sûr), Léo Malet (surprenant peut-être, mais Nestor Burma est un si bon détective) et beaucoup d’autres. Et alors… C’est un joyeux défilé, une folle valse de personnages qui se croisent, s’entrecroisent, se décroisent, s’interpellent pourquoi pas, d’un siècle à l’autre, d’un roman à l’autre, d’un quartier parisien à l’autre, sous la houlette d’une « ôtrice » qui ne fait pas qu’« ôter », mais qui prend des initiatives bienfaisantes (comme le projet de fondation d’un « ouvroir de littérature potentiellement féminine ») et nous fait suivre avec une émotion inédite les méandres secrets de ses ouvrages favoris.
Inédite aussi, la présentation de l’ensemble. La prose romanesque s’assortit d’une mise en page pleine de surprises. Des illustrations, des tableaux récapitulatifs, des pavés didactiques (exemples : définitions d’ « éponyme » ou de « mise en abyme », ou question du genre : « Flaubert a-t-il vraiment prononcé cette célèbre formule : « Madame Bovary, c’est moi ! » ? »), des passages en prose quasiment versifiée, des notes malicieuses etc. La patte de la pédagogue, l’imagination et le style de l’écrivaine : voilà un roman qui nous laisse toute liberté : celle de s’y promener nonchalamment, de s’y perdre sans vergogne, de s’y plonger audacieusement, avec l’espoir de refaire surface un jour… Quoi qu’il en soit, prenez le risque ! Cela vaut largement la peine de le courir.
Jean-Pierre Longre
18:45 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, mireille hilsum, pont 9, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/12/2025
Une histoire d’ours, d’amitié et d’amour
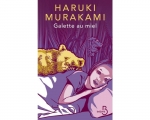 Lire, relire... Haruki Murakami, Galette au miel, traduit du japonais par Corinne Atlan, illustrations de Kat Menschik, Belfond, 2024, 10/18, 2025
Lire, relire... Haruki Murakami, Galette au miel, traduit du japonais par Corinne Atlan, illustrations de Kat Menschik, Belfond, 2024, 10/18, 2025
Cela commence comme un conte pour enfants : l’ours Masakichi récolte beaucoup de miel et va le vendre à la ville, mais il est rejeté à la fois par ses compères et par les humains. Cette histoire, c’est Junpei qui la raconte à Sara, petite fille traumatisée par les images du séisme de Kobe et réveillée souvent par un « vilain monsieur » qu’elle appelle le « Bonhomme Tremblement de Terre ». « Junpei inventait souvent des histoires qu’il racontait à Sara au moment où elle allait se coucher. La fillette lui posait des questions chaque fois qu’un élément lui échappait, et Junpei interrompait chaque fois son récit pour lui expliquer les choses en détail. Les questions étaient généralement pointues et intéressantes et, le temps que Junpei réfléchisse à la façon d’y répondre, de nouvelles idées pour poursuivre son histoire naissaient dans son esprit. »
 Il faut dire que Junpei, auteur de nombreuses nouvelles, est un écrivain reconnu, et est un grand ami de Sayoko, la mère de Sara. C’est lorsque nous apprenons cela que nous pénétrons dans le monde des adultes et de leur passé. Lorsqu’ils étaient étudiants, Sayoko et Junpei formaient, avec leur condisciple Takatsuki, un trio d’amis inséparables. Les deux garçons étaient amoureux de Junpei, et il s’ensuivit une série d’épisodes dans lesquels l’amour et l’amitié s’entremêlaient, et au cours desquels Junpei eut du mal à se décider.
Il faut dire que Junpei, auteur de nombreuses nouvelles, est un écrivain reconnu, et est un grand ami de Sayoko, la mère de Sara. C’est lorsque nous apprenons cela que nous pénétrons dans le monde des adultes et de leur passé. Lorsqu’ils étaient étudiants, Sayoko et Junpei formaient, avec leur condisciple Takatsuki, un trio d’amis inséparables. Les deux garçons étaient amoureux de Junpei, et il s’ensuivit une série d’épisodes dans lesquels l’amour et l’amitié s’entremêlaient, et au cours desquels Junpei eut du mal à se décider.
Plus tard, après un certain nombre de péripéties, le jour, ou plutôt la nuit où Junpei et Sayoko se manifestent enfin leur amour mutuel, la petite Sara se réveille et vient les voir de la part du « Bonhomme Tremblement de Terre ». « Va dire à ta maman que j’ai soulevé les boîtes pour tout le monde, et que j’attends. » À partir de ce moment, Junpei imagine une belle suite aux aventures de l’ours et décide d’écrire « des nouvelles d’un autre genre » où il sera question de l’amour et de la protection des êtres chers. Ce beau conte aux diverses facettes est ponctué par les illustrations de Kat Menschik qui, en gros plans à la fois fixes et mouvementés, met l’accent sur certains détails du texte, lui donnant ainsi un supplément d’intensité esthétique.
Jean-Pierre Longre
www.lisez.com/editeurs/10-x-18
12:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, japon, haruki murakami, corinne atlan, kat menschik, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/11/2025
Sulina, vie et mort
 Jean Bart, Europolis, traduit du roumain par Gabrielle Danoux, Les Argonautes, 2025
Jean Bart, Europolis, traduit du roumain par Gabrielle Danoux, Les Argonautes, 2025
Eugeniu Botez (1874-1933), commandant de marine et écrivain, rendit un bel hommage à l’un des plus fameux corsaires français en signant ses livres du pseudonyme de Jean Bart. Donc ne nous y trompons pas. Europolis est bien un roman roumain, dont l’action se déroule dans une ville cosmopolite, entre Orient et Occident, aux limites de la terre et de l’eau, entre fleuve et mer : à l’embouchure du Danube, dans un port qui, entre XIXe et XXe siècle, (le livre fut publié en 1933), ne vivait que du trafic maritime. Avant d’être envahie par les bancs de sable, Sulina était une porte grand ouverte : « Après la guerre de Crimée, c’est l’Europe qui est entrée en possession de cette clef qu’elle tient d’une main ferme et ne compte plus lâcher : elle ne la confie même pas au portier, qui est en droit d’en être le gardien. ». Tenue par la « Commission européenne du Danube » (d’où le titre du livre), la ville roumaine est une « tour de Babel » où se côtoient Roumains, Grecs, Turcs, Russes, Lipovènes, occidentaux divers, « marins, commerçants, artisans, portefaix, escrocs, vauriens, femmes de toutes sortes. ».
 Là, entre bistrots et quais, entre maisons bourgeoises et taudis, tous, notables comme prolétaires, attendent l’arrivée du frère de Stamati, « l’Américain », qui en tant que tel doit forcément être riche et est accueilli en héros. Las ! Nicula Marulis, sur qui étaient fondés tous les espoirs de richesse et de développement, s’avère être un ancien bagnard de Cayenne qui pour tout bien ramène sa fille Evantia, jeune et magnifique métisse, qui va faire tourner la tête des hommes et crever de jalousie les dames. Vont s’ensuivre diverses aventures accompagnées de rumeurs, de secrets plus ou moins dévoilés, de coups de théâtre, d’idylles et de tragédies amoureuses, dans la tradition du drame populaire – d'où l’humour toutefois n’est pas absent, ne serait-ce que par le burlesque de certaines scènes, par la satire sociale ou par quelques plaisanteries teintées d’une misogynie à prendre au second degré.
Là, entre bistrots et quais, entre maisons bourgeoises et taudis, tous, notables comme prolétaires, attendent l’arrivée du frère de Stamati, « l’Américain », qui en tant que tel doit forcément être riche et est accueilli en héros. Las ! Nicula Marulis, sur qui étaient fondés tous les espoirs de richesse et de développement, s’avère être un ancien bagnard de Cayenne qui pour tout bien ramène sa fille Evantia, jeune et magnifique métisse, qui va faire tourner la tête des hommes et crever de jalousie les dames. Vont s’ensuivre diverses aventures accompagnées de rumeurs, de secrets plus ou moins dévoilés, de coups de théâtre, d’idylles et de tragédies amoureuses, dans la tradition du drame populaire – d'où l’humour toutefois n’est pas absent, ne serait-ce que par le burlesque de certaines scènes, par la satire sociale ou par quelques plaisanteries teintées d’une misogynie à prendre au second degré.
Europolis est une fresque qui, à partir du petit point qu’est Sulina, transporte le lecteur entre Mer Noire et continent américain, aller et retour, et décrit en profondeur la vie locale. Les scènes de foule, les portraits hauts en couleur, la vie et les loisirs des travailleurs, la description des manœuvres navales et portuaires, l’évocation du Delta du Danube, tout fait l’objet d’une verve tantôt réaliste, tantôt épique, voire héroï-comique. On ne peut s’empêcher de penser à la tradition homérique (l’une des héroïnes ne s’appelle-t-elle pas Penelopa ? Nicula Marulis, de retour de pays lointains, n’est-il pas un Ulysse décevant ? La navigation n’est-elle pas une composante primordiale du roman ?). Mais, plus contemporain de l’auteur, on pense aussi à Panaït Istrati : art du portrait vivant, vie grouillante d’une société aux origines et aux conditions mêlées, présence centrale du Danube, verve satirique, poésie du voyage : « Ce n’est que sur un navire aux voiles gonflées par le vent du large qu’on appréhende la beauté et la poésie de la mer. ». Et pour finir, cette profession de foi de l’un des protagonistes, le sous-lieutenant Neagu, qui « s’était créé une doctrine personnelle qu’il avait baptisée “humanitarisme positiviste″. » : « À force de trop aimer l’humanité j’ai fini misanthrope, à force de trop croire en la vérité et en la droiture, je suis devenu sceptique. ».
Lire Europolis, dans cette nouvelle et belle traduction (après celle de Constantin Botez, publiée en 1958), c’est, en suivant la destinée d’une foule de personnages pittoresques, retrouver merveilleusement et tragiquement un monde disparu. « La porte de Sulina se referme à jamais. ».
Jean-Pierre Longre
10:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, jean bart, eugeniu botez, les argonautes, gabrielle danoux, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/11/2025
Une double fuite
 Cécile Tlili, Celle qui fugue, Calmann-Lévy, 2025
Cécile Tlili, Celle qui fugue, Calmann-Lévy, 2025
Son mari veut la quitter, lui faisant comprendre « la béance qui s’était formée » entre eux, l’ennui ayant pris la place de l’amour. À cette annonce, Alice est partie, abandonnant sa maison, son époux et sa fille adolescente. Une brève errance en Corse, puis un retour dans la ville méridionale où elle vivait, partageant son temps entre un petit appartement, son travail dans un laboratoire d’analyses, sa solitude, ses regrets d’avoir laissé Romane, sa fille tant aimée, et des insomnies qui la mènent au bord du danger.
Un soir où ce danger est imminent, elle est accueillie par une toute jeune voisine, Siham, qui va être pour elle un vrai réconfort, jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive que sa bienfaitrice est elle-même confrontée à des difficultés familiales qui vont la pousser à une fuite inquiétante. « Je compte les heures qui me séparent du matin, sept heures, une éternité, je ne vais pas arriver à tenir, sans Siham me voici de nouveau livrée en pâture à mes angoisses, j’ai peur pour elle que j’imagine accidentée, blessée, enlevée, violée, j’ai absurdement peur pour Romane, j’entends hurler la terreur que j’ai tenté de bâillonner depuis que ma fille est née, parce que si on la laisse s’exprimer on ne vit plus, et puis, même si je n’ose pas me l’avouer, j’ai peur pour moi, pour moi qui ne sais pas ce que je vais devenir sans Siham. »
Celle qui fugue est le roman, poétique et sensible, d’une double destinée, d’une double fuite : celle d’Alice, celle de Siham. Nous pénétrons dans l’intimité de la première, par les yeux et la parole de laquelle nous percevons le désarroi de ces deux femmes, mais aussi leur soif de vivre autre chose que ce qu’elles ont à subir. Leur « incorrigible tentation de fuir » débouchera peut-être sur une vie plus sereine, faite d’espoir et d’une douceur que laisse entrevoir le dernier chapitre.
Jean-Pierre Longre
19:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, cécile tlili, calmann-lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/11/2025
L’art du bref
 Jean-Jacques Nuel, Contresens, Éditions du Petit Pavé, 2025
Jean-Jacques Nuel, Contresens, Éditions du Petit Pavé, 2025
Il y a plus de dix ans, j’écrivais ceci à propos des Courts métrages de Jean-Jacques Nuel : « Le texte bref, malgré les apparences, n’est pas un genre facile. Il n’est pas donné à tout le monde de réussir à dire (ou, le plus souvent, à suggérer) en quelques lignes ce que d’autres développent en plusieurs centaines de pages. Il faut pour cela non seulement le sens de la concision, la maîtrise du mot et de l’expression justes, l’art de la chute, mais aussi de l’imagination, beaucoup d’esprit et beaucoup de travail. »
Voilà qui se vérifie pleinement avec Contresens. Pleinement, et même au quintuple, puisque cet ouvrage reprend une bonne partie de cinq recueils précédemment publiés : Courts métrages, Lettres de cachet, Modèles réduits, Le mouton noir et Billets d’absence – le tout augmenté de quelques inédits et parsemé d’illustrations de Dominique Laronde donnant une belle touche théâtrale à la prose.
La brièveté textuelle favorise la diversité des tonalités et des sujets. Impossible de tout passer en revue, bien sûr. Si Jean-Jacques Nuel ne néglige pas, pour le plaisir de ses compatriotes, d’évoquer de-ci de-là la bonne ville de Lyon ou de faire quelques (vraies-fausses ?) confidences à caractère autobiographique et auto-ironique (sur son prénom par exemple), ses textes touchent à l’universalité de la vie et de la condition humaine. Il y a l’humour souvent noir, voire désespéré, des dystopies que l’on peut surmonter grâce à des solutions radicales ou douces (parfois) ; il y a, bien sûr, l’absurde kafkaïen de certaines situations, et pas mal de nostalgie bercée par de jolis souvenirs et un sens pénétrant de la poésie, mais aussi le sentiment du temps qui passe et de la vieillesse annonçant la fin ; n’oublions pas la verve satirique d’un auteur qui, entre autres, ne ménage pas l’administration, les petits chefs et les mauvais littérateurs.
On aurait envie de composer un florilège, mais que choisir ? Simplement, pour donner un avant-goût, reprenons ce qu’affiche la quatrième de couverture :
PHOTOMATON
La photo d’identité en noir et blanc, de mauvaise qualité, s’était estompée avec le temps : on ne distinguait plus que l’ovale du visage aux cheveux ras se détachant sur le gris plus sombre du rideau, et des traces de la bouche, du nez, des yeux, des sourcils aussi indistinctes que les taches des reliefs à la surface de la pleine lune. L’homme sur la photo était devenu méconnaissable, et cependant, de tous mes portraits, c’était celui qui me ressemblait le plus.
FAUSSAIRES
J’avais été invité dans un festival de poésie qui se tenait en été dans le midi de la France ; mon nom figurait au programme, au milieu d’une liste de poètes de diverses nationalités. Mais, tout en étant heureux de cette occasion de monter sur une scène, j’éprouvais une certaine gêne : n’ayant plus écrit de poésie depuis plus de vingt ans, je n’avais aucun poème à lire. Je me résolus donc à livrer au public un choix de mes textes en prose. Ils rencontrèrent un vif succès, et les organisateurs tentèrent de me persuader qu’il s’agissait là d’une forme de poésie. Je les laissai dire, par politesse, mais au fond de moi je savais bien que non. Mes textes n’étaient pas de la poésie, pas davantage que tous les prétendus poèmes de tous les prétendus poètes qu’il me fallut subir, avant et après mon intervention.
Et pour varier les attentes de lecture, ajoutons :
LE BUREAU DES ADMISSIONS
Les candidats attendaient toute la nuit dans la rue, sous la pluie ou dans le froid, devant les grilles de la préfecture, pour être certains d’obtenir dès l’ouverture du bureau ce précieux ticket, délivré en nombre limité, qui leur donnait le droit d’attendre, la nuit suivante, dans la rue, sous la pluie ou dans le froid, devant les grilles de la préfecture.
VOL AVEC TRANSFERT
[…] Si la traversée de la moitié du globe n’avait présenté aucune difficulté, le passage du terminal 1 au terminal 2 de cet aéroport s’avérait une épreuve interminable et peut-être insurmontable.
ÉCHEC DE LA POLITIQUE DE PROHIBITION
À plusieurs reprises, le gouvernement de ce pays, animé des meilleures intentions du monde et d’un idéal progressiste, a voulu interdire la mort. Peine perdue. Les gens continuaient de mourir, en cachette, et dans de très mauvaises conditions sanitaires.
À chacun de poursuivre…
Jean-Pierre Longre
17:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : textes brefs, jean-jacques nuel, Éditions du petit pavé, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/11/2025
À la recherche d’une figure perdue
 Laurent Mauvignier, La Maison vide, Les éditions de Minuit, 2025
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Les éditions de Minuit, 2025
Prix Goncourt 2025
Marie-Ernestine, l’arrière-grand-mère de l’auteur, était née Proust en 1885. Aucun lien de parenté avec Marcel, mais le vaste roman familial de Laurent Mauvignier est construit sur une recherche, celle de la figure perdue de Marguerite, sa grand-mère, une figure qui a été soigneusement ôtée de toutes les photos familiales, une figure sans doute maudite – on va savoir peu à peu pourquoi, grâce à des investigations qui tiennent à la fois de l’enquête minutieuse et de l’imagination. « Je ne fais que du roman –, mais je crois que si ce que j’écris ici est un monde que je découvre en partie en le rêvant, je ne l’invente pas tout à fait : je le reconstruis pièce à pièce, comme une machine d’un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour et qu’il suffit de le remonter pour qu’il puisse redémarrer. Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer, peut-être à l’aveugle, en prenant trop de libertés, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens. »
On fait ainsi la connaissance de l’arrière-arrière-grand-père Firmin, propriétaire terrien autoritaire déçu par ses deux fils et mettant tous ses espoirs en sa « petite Boule d’Or », sa fille Marie-Ernestine qui, malgré des dons exceptionnels pour la musique et ses sentiments plus ou moins voilés pour son professeur de piano, devra se résigner à épouser en 1905 Jules, un employé zélé de son père ; le couple héritera ainsi des exploitations agricoles, de la scierie et d’une domination incontestée sur l’ensemble des possessions et du personnel. Après une longue attente, ce sera en 1913 la naissance de Marguerite, qui n’aura pas le temps de connaître son père tué en Argonne en 1916. Marguerite qui, de victime de la concupiscence masculine deviendra celle sur qui tombe le déshonneur familial, Marguerite qui, auparavant, aura découvert des secrets soigneusement celés par sa mère, cette mère qui refusera toujours de jouer du piano pour sa fille – qui l’écoutera en cachette, l’oreille collée contre le plancher…
Car la musique est au cœur de la relation secrète, presque inconsciente, entre la mère et la fille : « La musique lui parle même lorsque sa mère croit s’enfermer et éloigner sa fille, et c’est peut-être même en l’éloignant que sa mère s’approche au plus près de l’intimité de sa fille ; oui, dans l’esprit de l’enfant, la musique vient pour lui dire une parole que sa mère ne peut pas porter par les mots ni par les gestes ; la musique vient jusqu’à elle pour la bercer, la cajoler, la consoler, l’aimer, lui parler, lui murmurer un langage en-deçà des mots ; la douceur et la tendresse maternelle dont sa mère la prive viennent à elle à travers les poutres du grand salon, ils lui traversent le corps lorsqu’elle écoute, allongée sur le parquet, les doigts qui courent sur le clavier et la musique qui monte et imbibe l’air de la maison, et la maison elle-même, dans le corps même de ses murs et de ses fondations. »
Allons plus loin : l’histoire ici évoquée, « dont, écrit l’auteur, je capte seulement l’écho, la vibration dans l’image tremblante d’une fiction et d’un roman possible », est comparable à une symphonie. L’ampleur de la prose, les suspensions et reprises de son rythme, les mystérieuses résonances et harmonies que portent les phrases, tout cela suscite à la lecture l’émotion que provoque une musique profonde. La maison familiale, que la nouvelle génération a redécouverte après une longue période inoccupée, donne certes une impression de vide. Pourtant, au cœur de ce vide, outre les meubles, un « grand corps sombre trône dans la pièce du bas » : le piano, qui est comme un fil conducteur depuis la passion de Marie-Ernestine jusqu’à l’enfance de l’auteur. Pour celui-ci, la quête de la figure perdue de Marguerite… Oui, et pour les lecteurs la découverte d’un grand roman symphonique.
Jean-Pierre Longre
Pour lire des chroniques sur quelques autres livres de Laurent Mauvignier: http://jplongre.hautetfort.com/tag/laurent+mauvignier
11:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/11/2025
Sortir de l’impasse
 Lire, relire... Gaël Faye, Petit pays, Grasset, 2016, Le livre de poche, 2017, réédition 2020, édition collector, 2025
Lire, relire... Gaël Faye, Petit pays, Grasset, 2016, Le livre de poche, 2017, réédition 2020, édition collector, 2025
Gabriel, dit Gaby, père français et mère rwandaise, vit à Bujumbura, dans la région de l’Afrique des Grands Lacs, à une époque tourmentée (les années 1990) qui aurait pu faire son malheur, d’autant plus qu’à la guerre et aux massacres s’ajoute la séparation des parents. Pourtant, même si certaines scènes de violence et certains récits (celui de sa mère, par exemple, revenant du Rwanda où elle a découvert l’horreur) le marquent profondément, il n’est pas malheureux. La petite bande de copains qui occupent « l’impasse » où il vit – les jumeaux, Armand, Gino et lui – s’amuse aux chapardages, aux petites expéditions aventureuses, aux bagarres et autres exploits virils de jeunes garçons.
 « Chez moi ? C’était ici. Certes, j’étais le fils d’une Rwandaise, mais ma réalité était le Burundi, l’école française, Kinarina, l’impasse. Le reste n’existait pas. ». Peu à peu, Gabriel va sortir de la bulle enfantine pour prendre conscience de sa place sociale et familiale, de ses propres hontes, des réalités de son pays et du monde, des soubresauts politiques (l’euphorie des premières élections libres, le coup d’État qui a suivi, les rivalités sanglantes entre Hutu et Tutsi), de la guerre qui, malgré ses réticences et son naturel pacifique, vient toucher son petit monde relativement privilégié : « Gaby, c’est la guerre. On protège notre impasse. Si on ne le fait pas, ils nous tueront. Quand est-ce que tu vas comprendre ? Dans quel monde vis-tu ? […] Nos ennemis sont déjà là. Ce sont les Hutu et eux n’hésitent pas à tuer des enfants, cette bande de sauvages. Regarde ce qu’ils ont fait à tes cousins, au Rwanda. Nous ne sommes pas en sécurité. Il faut apprendre à nous défendre et à riposter. Que feras-tu quand ils rentreront dans l’impasse ? Tu leur offriras des mangues ? », lui lance son ami Gino. Mais il y a aussi les lettres qu’il échange avec Laure, sa correspondante d’Orléans, ouverture épistolaire heureuse qui lui offre les prémices d’une vocation littéraire ; il y a l’école, qu’il est bien content de reprendre après des grandes vacances inoccupées (« c’est pire que le chômage ») ; et il y a les livres que Madame Economopoulos, une voisine, lui fait découvrir : « Grâce à mes lectures, j’avais aboli les limites de l’impasse, je respirais à nouveau, le monde s’étendait plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs. ».
« Chez moi ? C’était ici. Certes, j’étais le fils d’une Rwandaise, mais ma réalité était le Burundi, l’école française, Kinarina, l’impasse. Le reste n’existait pas. ». Peu à peu, Gabriel va sortir de la bulle enfantine pour prendre conscience de sa place sociale et familiale, de ses propres hontes, des réalités de son pays et du monde, des soubresauts politiques (l’euphorie des premières élections libres, le coup d’État qui a suivi, les rivalités sanglantes entre Hutu et Tutsi), de la guerre qui, malgré ses réticences et son naturel pacifique, vient toucher son petit monde relativement privilégié : « Gaby, c’est la guerre. On protège notre impasse. Si on ne le fait pas, ils nous tueront. Quand est-ce que tu vas comprendre ? Dans quel monde vis-tu ? […] Nos ennemis sont déjà là. Ce sont les Hutu et eux n’hésitent pas à tuer des enfants, cette bande de sauvages. Regarde ce qu’ils ont fait à tes cousins, au Rwanda. Nous ne sommes pas en sécurité. Il faut apprendre à nous défendre et à riposter. Que feras-tu quand ils rentreront dans l’impasse ? Tu leur offriras des mangues ? », lui lance son ami Gino. Mais il y a aussi les lettres qu’il échange avec Laure, sa correspondante d’Orléans, ouverture épistolaire heureuse qui lui offre les prémices d’une vocation littéraire ; il y a l’école, qu’il est bien content de reprendre après des grandes vacances inoccupées (« c’est pire que le chômage ») ; et il y a les livres que Madame Economopoulos, une voisine, lui fait découvrir : « Grâce à mes lectures, j’avais aboli les limites de l’impasse, je respirais à nouveau, le monde s’étendait plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs. ».
 Gabriel, sans aucun doute, ressemble à Gaël, et ce qui est raconté dans le roman est visiblement le fruit de l’expérience. Avec l’exil, il a trouvé la paix, mais il reste « entre deux rives » géographiques et temporelles : exilé « de [son] enfance » plus que « de [son] pays », l’adulte, revenant vers le pays d’origine, n’y retrouvera que les livres, et des traces funestes. Petit pays est écrit au rythme de la vie, des petits et grands événements qui ont marqué le passé. Chaque chapitre déroule un épisode particulier, bonheur ou malheur, et aboutit à une évocation du paysage intérieur ou extérieur, cadence musicale ponctuant la narration. Un roman dont la force réside dans ce qu’il raconte, et dont la densité réside dans ses prolongements poétiques.
Gabriel, sans aucun doute, ressemble à Gaël, et ce qui est raconté dans le roman est visiblement le fruit de l’expérience. Avec l’exil, il a trouvé la paix, mais il reste « entre deux rives » géographiques et temporelles : exilé « de [son] enfance » plus que « de [son] pays », l’adulte, revenant vers le pays d’origine, n’y retrouvera que les livres, et des traces funestes. Petit pays est écrit au rythme de la vie, des petits et grands événements qui ont marqué le passé. Chaque chapitre déroule un épisode particulier, bonheur ou malheur, et aboutit à une évocation du paysage intérieur ou extérieur, cadence musicale ponctuant la narration. Un roman dont la force réside dans ce qu’il raconte, et dont la densité réside dans ses prolongements poétiques.
Jean-Pierre Longre
11:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, burundi, gaël faye, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/10/2025
Du sang et des livres
 Maxime Benoît-Jeannin, Meurtres chez les Goncourt, Asmodée Edern, 2025
Maxime Benoît-Jeannin, Meurtres chez les Goncourt, Asmodée Edern, 2025
Il se passe des choses bizarres et dramatiques dans l’immeuble où habitent Edmond et Jules de Goncourt. Certes, la soirée promet d’être passionnante, réjouissante et fournie : dans l’appartement des fameux duettistes littéraires, vont se réunir quelques personnalités de l’époque : l’imposant Gustave Flaubert, Théophile Gautier avec femme et enfants, une comédienne à succès (pas seulement théâtral), quelques autres invités appartenant au monde du théâtre et du spectacle, et Léonce Jacquelain, un jeune auteur venu de Gand présenter son premier roman, La Passagère de la Méduse, dont Flaubert va faire une lecture « gueulée ». Cette lecture occupe tout ce monde, et aussi une part non négligeable du livre : une mise en abyme, un roman dans le roman, doublant l’intrigue.
Car de l’intrigue, il y en a… Le meurtre sanglant de la voisine de palier des Goncourt, une « très belle jeune femme exerçant le très antique métier qui console les hommes solitaires ou mariés, et parfois les hommes de lettres » – ce qui multiplie les suspects aux yeux du commissaire de quartier, un certain Fenouil, venu enquêter et soupçonner un peu tout le monde. On n’en restera pas là : le comte Dusseuil (on reste dans les éléments immobiliers…), qui habite au-dessus des Goncourt et dont l’épouse, comme par hasard, est la maîtresse de Jules, trouve la mort dans des circonstances compromettantes, qui pourront être cachées grâce à l’arrivée inopinée d’un peintre bohème et de son singe…
Autant dire que se multiplient des péripéties dans lesquelles mort violente et littérature, sans parler de quelques scènes dans lesquelles la sensualité se déploie sans vergogne, s’emboîtent avec beaucoup de vivacité, et souvent d'humour. Meurtres chez les Goncourt est un roman multiple, à lire comme un vrai « thriller littéraire ».
Jean-Pierre Longre
23:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, maxime benoît-jeannin, asmodée edern, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/10/2025
Enquête sur un échec à répétition
 Bernard Cerquiglini, À qui la faute ?, « L’impossible (mais nécessaire) réforme de l’orthographe », Folio, 2025
Bernard Cerquiglini, À qui la faute ?, « L’impossible (mais nécessaire) réforme de l’orthographe », Folio, 2025
Chacun s’est un jour posé des questions sur certaines anomalies de l’orthographe française : pourquoi écrire au pluriel des bijoux et des filous, des chevaux et des landaus, pourquoi dangereux fait-il dangereuse au féminin, ou pourquoi chanceler donne-t-il « il chancelle », mais modeler « il modèle » ? On pourrait multiplier les exemples dans lesquels interviennent non le souci étymologique, mais le hasard des graphies médiévales, voire plus tardives. Et qu’en est-il de la transcription de l’oral ? Eh bien, on constate que par exemple « la consonne /s/ s’écrit s, ss, t, c, ç » ; que « la voyelle nasale /in/ se rend par in, im, ain, aim, ein, yn, ym, etc. » Ne faudrait-il pas réformer tout cela ?
Oui, depuis le XVIe siècle jusqu’à notre époque, on ne compte pas les grammairiens, linguistes, enseignants, écrivains qui se sont lancés « à l’assaut de la forteresse orthographique », et qui ont subi un échec tantôt discret, tantôt retentissant. Bernard Cerquiglini, qui fut officiellement de la partie, mais qui, en bon oulipien, sait combiner le sérieux (universitaire) et le détachement (humoristique), sans négliger la discrète provocation, s’adonne dans ce bref mais dense volume à une enquête minutieuse sur cet échec maintes fois répété.
« À qui la faute ? » Le substantif du titre rappelle en filigrane que l’erreur orthographique connote « une idée de péché », tant les conventions d’écriture semblent revêtues d’un caractère sacré. Qui sont donc les responsables de l’impossibilité de réformer l’orthographe ? L’auteur les répartit en cinq catégories, sous la forme interrogative. Les « cuistres » ? Ce sont les pédants, « latinisants besogneux et souvent responsables d’un étymologisme inopportun », mais qui ne sont pas complètement étrangers aux progrès linguistiques. L’Académie française ? Chargée de « dire le droit en matière graphique », elle aménage la norme au long des siècles et des livraisons du dictionnaire. Jules Ferry ? « Lire, écrire, compter », telle est la mission de l’école, et les deux premières injonctions mettent en avant une graphie figée, donnant le pouvoir à ceux qui maîtrisent l’orthographe, mais aussi faisant surgir, aux alentours de 1900, un « camp de la réforme » qui se manifestera jusqu’aux « Rectifications orthographiques » de 1990, que pratiquement personne n’applique… Les réformateurs ? Depuis Louis Meigret et son « Traité » publié en 1550, les tentatives de simplification tendant à harmoniser l’écriture et la prononciation et à supprimer les anomalies évoquées au début de cette chronique ont été nombreuses, et parfois si excessives qu’elles ont suscité au pire de violentes réactions, au mieux l’indifférence. Charlemagne ? Nous remontons alors aux sources d’une langue française marquée par la « créolité », un mélange complexe d’idiomes qui font sa richesse et sa singularité, une complexité qui, selon l’auteur, demanderait malgré tout une rénovation bien comprise. Sera-t-elle possible ? En tout cas, Bernard Cerquiglini nous incite, sans pédantisme mais avec la science du spécialiste et le savoir-faire du pédagogue, à réfléchir sur le passé et le présent d’une langue qui doit assurer son avenir.
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, bernard cerquiglini, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/10/2025
« Mourir à vingt ans pour la liberté »
 Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le nom sur le mur, Gallimard, 2024, Folio, 2025
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le nom sur le mur, Gallimard, 2024, Folio, 2025
Comme souvent, c’est le hasard qui fut le déclencheur. La suite est le fait de l’auteur et de son héros. Celui-ci, dont le nom fut découvert sur le mur de la maison qu’Hervé Le Tellier venait d’acheter dans la Drôme, est au nombre des jeunes gens qui décidèrent de combattre l’envahisseur nazi, et qui en moururent. André Chaix, né en 1924, a été tué en août 1944 à Grignan avec plusieurs de ses camarades par des mitrailleurs allemands, et enterré à Montmeyran, où il est né, après avoir vécu à La Paillette, près de Dieulefit.
Les quelques éléments recueillis – photos, témoignages, documents – permettent à Hervé Le Tellier de reconstituer par bribes (des « poussières », écrit-il) l’histoire du jeune homme, son enfance, sa jeunesse d’apprenti aux « Céramiques de Dieulefit », son amour pour Simone, son engagement dans les FTP. Même si, parfois, l’imagination se permet quelques libertés, ce livre n’est pas un roman, et les éléments biographiques sont assortis de retours sur le passé collectif : « L’Histoire est forcément là, puisqu’André en fut à la fois acteur, héros et victime. » Nous pouvons alors apprendre ou réapprendre, par exemple, la signification des abréviations désignant les mouvements de résistance (FTP, FFI et maints autres), avoir des précisions sur le rôle majeur joué par Dieulefit, comme par le Chambon-sur-Lignon, pendant l’occupation, sur le Maquis Morvan, sur certains épisodes de la guerre et sur les blindés de la IIe Panzerdivision (ceux qui ont tué André), ou sur ces anciens nazis français qui participèrent à la fondation du FN (devenu Rassemblement National)… Les rappels factuels fondent aussi des réflexions sur le nazisme, sur le phénomène de la « soumission à l’autorité, la pression des pairs » qui « fabriquent à la chaîne des tueurs sans états d’âme. »
 Face à cela, l’humain : l’amour d’André pour Simone, avec les photos et les mots, émouvants et parfois quasiment prémonitoires, qui le confirment (« Première photo avec toi ma chérie qui seras toujours pour moi la douce et pure Simone de mes amours. Avec toi nous parcourrons la vie dure parfois mais rien ne nous séparera à part la mort. Mes doux baisers. Ton Dédé de toujours. »), un amour qui entraîne quelques confidences de l’auteur lui-même ; l’évocation du fameux livre Le Tour de France de deux enfants, dont André gardait précieusement une page qui « raconte comment le savoir peut dompter la peur » ; une autre évocation, celle d’amis anciens de l’OULIPO (dont Hervé Le Tellier est le président), Italo Calvino, qui fut lui aussi maquisard de son côté, François Le Lionnais, qui fut déporté au camp de Dora, auquel je (l’auteur de cette chronique) ne peux penser sans une forte émotion, puisque mon oncle maternel Pierre Penel, résistant sous le nom de Marceau, y fut déporté après avoir été arrêté et torturé à Lyon, et y mourut à 22 ans, en janvier 1945 ; une rue de Saint-Genis Laval porte son nom, qui est aussi gravé sur une stèle du cimetière de Peyrus, village de la Drôme d’où la famille de Pierre (la mienne, donc) est originaire et où il allait souvent voir ses grands-parents, non loin du Montmeyran d’André… Deux destinées dont la proximité est trop flagrante pour ne pas être signalée…
Face à cela, l’humain : l’amour d’André pour Simone, avec les photos et les mots, émouvants et parfois quasiment prémonitoires, qui le confirment (« Première photo avec toi ma chérie qui seras toujours pour moi la douce et pure Simone de mes amours. Avec toi nous parcourrons la vie dure parfois mais rien ne nous séparera à part la mort. Mes doux baisers. Ton Dédé de toujours. »), un amour qui entraîne quelques confidences de l’auteur lui-même ; l’évocation du fameux livre Le Tour de France de deux enfants, dont André gardait précieusement une page qui « raconte comment le savoir peut dompter la peur » ; une autre évocation, celle d’amis anciens de l’OULIPO (dont Hervé Le Tellier est le président), Italo Calvino, qui fut lui aussi maquisard de son côté, François Le Lionnais, qui fut déporté au camp de Dora, auquel je (l’auteur de cette chronique) ne peux penser sans une forte émotion, puisque mon oncle maternel Pierre Penel, résistant sous le nom de Marceau, y fut déporté après avoir été arrêté et torturé à Lyon, et y mourut à 22 ans, en janvier 1945 ; une rue de Saint-Genis Laval porte son nom, qui est aussi gravé sur une stèle du cimetière de Peyrus, village de la Drôme d’où la famille de Pierre (la mienne, donc) est originaire et où il allait souvent voir ses grands-parents, non loin du Montmeyran d’André… Deux destinées dont la proximité est trop flagrante pour ne pas être signalée…
Trêve de confidences familiales… Je finirai, sans autre commentaire, par un paragraphe essentiel du livre : « L’année 2024 est celle du centenaire de la naissance d’André Chaix, et quatre-vingts années ont passé depuis sa mort. Mais à regarder le monde tel qu’il va, je ne doute pas qu’il faille toujours parler de l’Occupation, de la collaboration et du fascisme, du racisme et du rejet de l’autre jusqu’à sa destruction. Alors, je n’ai pas voulu que ce livre évite le monstre contre lequel André Chaix s’est battu, ne donne pas la parole aux idéaux pour lesquels il est mort et ne questionne pas notre nature profonde, notre désir d’appartenir à plus grand que nous, qui conduit au meilleur et au pire. »
Jean-Pierre Longre
11:38 Publié dans Essai, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, biographie, hervé le tellier, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Pâtes italiennes
 Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005, Folio, 2025
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005, Folio, 2025
Roman épistolaire, roman culinaire, roman oulipien, roman à tiroirs, roman d’investigation… Maintes caractéristiques génériques pourraient qualifier le dernier livre d’Hervé Le Tellier, qui se situe ici dans la droite (mais complexe) lignée des initiateurs de l’OuLiPo. Il y aurait à ajouter, aux limites du romanesque : la fiction autobiographique, l’érudition historique et artistique, la poésie italienne (et anglaise ou irlandaise), les jeux de l’amour (où le hasard, finalement, n’aura pas voix au chapitre), les malices intertextuelles, de Dante à Calvino et Roubaud.
 On aurait pu commencer par résumer, en disant par exemple : un chroniqueur gastronomique publie régulièrement dans un hebdomadaire français des recettes de pâtes italiennes sur fond d’anecdotes pittoresques, en usant du beau pseudonyme de Giovanni d’Arezzo ; un (vrai ?) Giovanni d’Arezzo, ayant découvert l’un de ces articles, lui écrit sans dévoiler son adresse, ce qui pousse le (faux) Giovanni à envoyer une réponse en trois exemplaires aux adresses de trois Giovanni d’Arezzo florentins trouvées grâce aux renseignements internationaux ; commence alors une abondante correspondance entre le narrateur et ses trois « homonymes », dont un retraité de l’enseignement et un jeune prisonnier.
On aurait pu commencer par résumer, en disant par exemple : un chroniqueur gastronomique publie régulièrement dans un hebdomadaire français des recettes de pâtes italiennes sur fond d’anecdotes pittoresques, en usant du beau pseudonyme de Giovanni d’Arezzo ; un (vrai ?) Giovanni d’Arezzo, ayant découvert l’un de ces articles, lui écrit sans dévoiler son adresse, ce qui pousse le (faux) Giovanni à envoyer une réponse en trois exemplaires aux adresses de trois Giovanni d’Arezzo florentins trouvées grâce aux renseignements internationaux ; commence alors une abondante correspondance entre le narrateur et ses trois « homonymes », dont un retraité de l’enseignement et un jeune prisonnier.
Voilà le début, et on ne poursuivra pas le résumé ; car à partir de là, l’entrecroisement épistolaire, ponctué d’extraits du « Carnet de l’auteur » et de narrations culinaires, mène le lecteur, comme le narrateur, dans un labyrinthe de faux-semblants (vraisemblables au demeurant), de chemins de traverse, de jeux de piste, d’embûches intellectuelles et sentimentales. Qui dit vrai, qui ment ? Qui est le voleur, qui le volé ? Les « Caro Giovanni », « Cher Monsieur d’Arezzo », « Cher Giovanni », « Giovanni mio », « Carissimo Giovanni », les congratulations et remerciements mutuels sont des formules qui occultent à peine une guerre à pointes de moins en moins mouchetées où l’on n’hésite pas à se dérober des histoires personnelles, des souvenirs, des amours anciennes, des confidences, la « nostalgie » qu’évoque le titre.
Tout cela est un jeu ? En quelque sorte : jeu de l’arroseur arrosé, du piégeur piégé, du bourreau victime… Mais jeu qui, comme dans tout bon roman forgé à l’aune d’une construction rigoureusement préméditée (on ne peut manquer de penser, du côté épistolaire, aux Liaisons dangereuses, et du côté oulipien, à La vie mode d’emploi), engage une ou des existences à part entière ; celles des personnages, et celle du lecteur qui se laisse lui-même prendre au piège et ne peut s’empêcher de deviner que, sous ce qu’il a cursivement saisi, bien d’autres choses se tapissent dans les profondeurs dantesques de l’humaine comédie.
Jean-Pierre Longre
11:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hervé le tellier, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/10/2025
La poésie des insomnies
 Lire, relire... Gaëlle Josse, À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?, Les éditions Noir sur blanc / Notabilia, 2024, J'ai lu, 2025
Lire, relire... Gaëlle Josse, À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?, Les éditions Noir sur blanc / Notabilia, 2024, J'ai lu, 2025
Chacun a son histoire, ses histoires, et la nuit est propice à faire surgir ces « quelques éclats [qui] demeurent au milieu des heures profondes, en veille. » Oui, « c’est l’heure des aveux, des regrets, des impatiences, des souvenirs, de l’attente. Ce sont les heures où le cœur tremble, où les corps se souviennent, peau à peau avec la nuit. On ne triche plus. Ce sont les heures sentinelles de nos histoires, de nos petites victoires, de nos défaites. » Alors Gaëlle Josse, qui sait si bien s’y prendre avec les mots intimes, évoque ces heures de veille qui sont des heures de manques, de chagrins, de pleurs parfois, mais aussi de joies discrètes et d’espoir serein.
 Ils sont là, ces hommes et ces femmes qui attendent une arrivée, un retour, qui pleurent un être cher, qui guettent des silhouettes entrevues, qui savent que la mort va arriver, ou qui ne savent pas ce qu’il va se passer, qui ont décidé d’aller chercher le bonheur ailleurs, ou de rompre, ou de renouer, ou tout simplement de vivre en se disant « que, parfois, tout est bien. »
Ils sont là, ces hommes et ces femmes qui attendent une arrivée, un retour, qui pleurent un être cher, qui guettent des silhouettes entrevues, qui savent que la mort va arriver, ou qui ne savent pas ce qu’il va se passer, qui ont décidé d’aller chercher le bonheur ailleurs, ou de rompre, ou de renouer, ou tout simplement de vivre en se disant « que, parfois, tout est bien. »
Ces brèves séquences, ces instantanés nocturnes se succèdent au rythme lent des émotions, comme des élégies, comme de délicates mélodies. On connaît la prédilection de Gaëlle Josse pour l’art, en particulier pour la musique, évoquée ici à plusieurs reprises : le « monde infini et clos » de l’aria des Variations Goldberg, le « dernier concert » d’un pianiste qui sent la virtuosité lui échapper… Mais la musique s’épanouit surtout dans la prose poétique d’une autrice qui cultive la nuance et l’harmonie, une harmonie dont la continuité est assurée par les brèves transitions entre les différentes séquences ; une ligne, deux lignes à peine comme des portées musicales, « la nuit amère, la nuit comme un gouffre, la nuit consolation », « la nuit colère, la nuit repos, la nuit ouverte, la nuit refuge », « la nuit où tombent les masques »… La tonique et son complément ici multiple, la dominante…
Et puis, parmi toutes ces « microfictions », il y en a une qui penche vers l’aveu autobiographique, qui se nourrit de l’expérience de l’écriture nocturne, qui en dit tout en quelques lignes, et par lequel on terminera cette chronique : « Parfois l’écriture l’emmène au bord du vide et la retient là, sur cette frontière, puis au dernier moment elle la sauve de l’effroi, de la tiédeur, du demi-jour et des colères tristes. Elle poursuit son travail obscur de sourcière. »
Jean-Pierre Longre
www.leseditionsnoirsurblanc.fr/catalogue-collection/notab...
08:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, poésie, francophone, gaëlle josse, les éditions noir sur blanc notabilia, jean-pierre longre, j'ai lu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/09/2025
De la guerre à l’amour
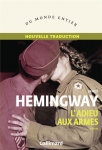 Ernest Hemingway, L’adieu aux armes, nouvelle traduction de l’anglais (États-Unis) et avant-propos par Philippe Jaworski, préface de l’auteur, Gallimard / Du monde entier, décembre 2024.
Ernest Hemingway, L’adieu aux armes, nouvelle traduction de l’anglais (États-Unis) et avant-propos par Philippe Jaworski, préface de l’auteur, Gallimard / Du monde entier, décembre 2024.
Le narrateur, Frederic Henry, est un officier américain engagé comme ambulancier dans l’armée italienne pendant la guerre de 14-18. Au cours de ses missions où, la boisson aidant, il se fait quelques bons compagnons et même quelques fidèles amis, comme le médecin Rinaldi, il rencontre une jeune et belle infirmière anglaise, Catherine Barkley, dont il s’éprend. Amour partagé de plus en plus intensément, surtout lorsque, après avoir été sérieusement blessé au cours d’une bataille sur le front autrichien, il est hospitalisé dans un établissement de Milan où Catherine assure le service de nuit. « Cet été-là, nous passâmes des moments merveilleux. Dès que je pus sortir, nous nous promenions dans le parc. Je me rappelle la voiture, le cheval qui allait au pas, et devant nous le dos du cocher avec son haut-de-forme verni, et Catherine Barkley assise à côté de moi. Il suffisait que nos mains se touchent, un simple effleurement de ma main sur la sienne, pour que nous soyons excités. »
Mais il faut retourner au front et redécouvrir les brutales réalités de la guerre. « Les blessés affluaient au poste, certains portés sur des brancards, d’autres marchaient, d’autres sur le dos de soldats qui arrivaient à travers champs. Ils étaient trempés jusqu’aux os, et tous étaient terrifiés. » À la faveur d’une difficile retraite des Italiens face aux Autrichiens, Frederic déserte avec d’autres et, après maintes péripéties, frôlant plusieurs fois la mort, il va rejoindre Catherine enceinte et mener avec elle « une vie délicieuse. »
D’où vient que ce roman dramatique, achevé aux dires de l’auteur à Paris en 1929 et nouvellement traduit, compte à juste titre au nombre des chefs-d’œuvre de la littérature américaine ? Écrit en une prose sans aucune concession au « beau style » et sans aucun pathos, le récit rapporte les faits tels que les vivent les personnages, en l’absence de tout commentaire ; Philippe Jaworski, le traducteur, l’explique très bien dans son avant-propos : « Des gestes, des sensations, des choses vues, sans nul obstacle entre le lecteur et la créature de fiction. L’écrivain demande au langage un outil sûr pour faire vivre ses personnages avec intensité en dehors de lui, comme s’il ne les connaissait pas, les laissant révéler d’eux-mêmes ce qu’ils veulent, se trahir dans un dialogue, par exemple, ou un monologue intérieur. » On pourrait alors croire à une sécheresse narrative qui émousse l’intérêt. C’est le contraire : le lecteur se laisse entraîner par la prose et n’a de cesse que de passer d’un événement à l’autre, d’un épisode à l’autre, sans s’attarder à autre chose qu’aux personnages et à ce qu’ils vivent, à les accompagner dans leur bonheur et leur malheur, à vivre avec eux dans le roman. C’est ainsi que l’on comprend en quoi Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature 1954, est l’un des grands écrivains du XXe siècle.
Jean-Pierre Longre
19:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, ernest hemingway, philippe jaworski, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/09/2025
L’épopée du vulgaire

Ian Monk, né en 1960, décédé le 19 septembre 2025...
Ian Monk, Plouk Town, introduction de Jacques Roubaud, Éditions Cambourakis, 2007, rééd. 2011
Au commencement était la contrainte et la contrainte s’est faite verbe et le verbe s’est fait avalanche. Ainsi : Plouk Town est un long texte poétique en onze parties : la première contient un poème (x) d’un vers (x2) d’un mot (x), la seconde deux parties (x) de quatre vers (x2) de deux mots (x), la troisième trois poèmes (x) de neuf vers (x2) de trois mots (x) et ainsi de suite, jusqu’à la dernière partie contenant 11 poèmes de 121 vers de 11 mots… L’avalanche, extension du principe oulipien de « boule de neige », sert donc à l’auteur de contrainte rythmique, et au texte de cadre poétique, à l’intérieur duquel d’autres contraintes (anaphores, rimes et antérimes, recherche de toutes les combinaisons possibles d’un ensemble de 9 mots aboutissant à la composition de 81 vers (99)…) guident le texte.
Soit. Mais l’exercice n’est jamais gratuit. Plouk Town est un ouvrage abouti, qui ne relève pas que de l’expérimental formel, mais aussi et surtout de l’expérience fondamentale du quotidien. Dans la ville en question, les Plouks en question, c’est nous, c’est Monk, c’est tous ceux qui traînent leur cafard quotidien dans un paysage sans horizon. Sans précautions oratoires, en toute lucidité mentale et en toute verdeur lexicale, l’auteur chante en mineur la connerie des gens, les mômes pénibles, les parkings de supermarché, le Quick, l’alcoolisme, la Star Academy, la promiscuité, les appartements crasseux, la clochardisation… Ces scènes de la vie vulgaire sont certes localisées pour la circonstance, mais elles sont de partout : comme partout (à Bombay, Tombouctou, Londres ou New York), « la pauvreté te cogne la gueule à Plouk Town » ; comme partout, on embauche (des vigiles, des surveillants, des tortionnaires, des connards), on a peur, on aime, on se souvient, on pense, on déteste, on tâche de vivre, on est sûr de mourir.
Il y a tout à Plouk Town, et on y ressent tout ce que peuvent ressentir les humains. Il y a tout dans le livre de Ian Monk (après une fort plaisante et fort charpentée préface de Jacques Roubaud), en vers, en morceaux de dialogues, en bribes de monologues, en fragments réalistes, poétiques, comiques, tragiques, épiques. Il y a même des tentatives de réponse à l’angoisse collective et individuelle :
« moi qui vous le dis je m’entraîne
à l’écriture justement mais justement pour sortir
de cette idée de pourriture de ma vie ».
Jean-Pierre Longre
20:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, francophone, ian monk, jacques roubaud, oulipo, Éditions cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/09/2025
Une élégante venue de Rio
 Alain Gerber, Naissance de la bossa nova, note de Patrick Frémeaux, postface d’Alain Lesage, Frémeaux & Associés, 2025
Alain Gerber, Naissance de la bossa nova, note de Patrick Frémeaux, postface d’Alain Lesage, Frémeaux & Associés, 2025
Une fois n’est pas coutume, l’auteur de cette chronique avoue n’avoir pratiquement rien connu de la bossa nova avant d’avoir lu le livre d’Alain Gerber. Ou alors ce n’est qu’une impression, tant ce livre lui a ouvert les yeux et les oreilles sur des rythmes et des harmonies qu’il avait en tête sans les identifier formellement. Tout cela pour dire que Naissance de la bossa nova est un titre bien modeste pour un ouvrage d’une érudition qui, certes, ne surprend pas de la part de l’auteur, mais se déploie d’un air si naturel qu’on ne se doute pas de la somme de travail qu’a sûrement nécessité la quantité de références précises qu’il propose.
Il y a la « genèse à Rio de Janeiro », avec les « pères fondateurs » (Vinicius de Moraes, Antônio Carlos « Tom » Jobim, Joấo Gilbert), un certain nombre de chanteurs et chanteuses comme Chico Buarque ou Nara Leấo, et il y a la « jeunesse à New York et ailleurs dans le monde », dont Dizzy Gillespie et Stan Getz sont des figures dominantes, mais non uniques. La première phrase de l’histoire résume un état des lieux implacable : « Grâce à Dizzy Gillespie surtout, le jazz s’est afrocubanisé dans les années 40. Grâce à Stan Getz entre autres, le jazz s’est brésilianisé au début des années 60. » On s’attend donc à apprendre beaucoup de choses au fil des pages, et cette attente n’est pas déçue ! On apprend, par exemple, que l’expression bossa-nova a été utilisée pour la première fois dans une chanson de Mendonça, et d’ailleurs qu’à l’origine les bossas-novas sont essentiellement des chansons avec des paroles qui « leur collent à la peau » ; que la « nonchalance » apparente du genre est loin d’être un « relâchement rythmique », que « des sanitaires ont servi de maternité à la bossa-nova », que la chanson Tu verras chantée par Nicole Croisille et Claude Nougaro est de Chico Buarque (O Que Sera), que Stan Getz a inventé le « Brésil universel », « un pays de nulle part, plein d’ombres et de reflets, de mirages et de réminiscences. »
On le voit, ce n’est pas parce qu’Alain Gerber nous fait partager ses connaissances qu’il abandonne son costume d’écrivain. Même dans un livre historique abondamment documenté, il s’adonne à des considérations bien pensées sur les mystères de « l’invention mélodique », sur la musique codifiée, sur « la science harmonique » qui n’explique pourtant pas « ce qui fait qu’un certain agencement de notes trouvera un écho sur la sensibilité universelle. » Et il ne se prive pas, pour notre plus grand plaisir, de laisser se développer son style ô combien séduisant. Au hasard, un exemple à propos du « L.A. Four » : « Prolifique, professionnel en diable, prodigue en performances instrumentales, délicieux sans conteste, mais aussi, comment dire ?... facultatif, essentiellement distractif. Sans faiblesses et sans reproche. Sans folie et sans nécessité non plus. […] La démagogie n’a pas cours chez les Quatre de Los Angeles. Et la mièvrerie ne pouvait compter sur eux pour s’épanouir : montrer leurs muscles ne fut pas leur préoccupation majeure ; en revanche leur musique en quête de raffinement restait en toute circonstance remarquablement articulée. » Ce ne sont là que quelques lignes parmi de nombreuses non moins prenantes, à la manière de la bossa nova elle-même que, pour changer un peu de plume, Patrick Frémeaux définit en quelques mots dans sa note liminaire : « La bossa nova incarne cette élégance nonchalante qui nous charme immédiatement et qui a vite su conquérir bien au-delà des frontières brésiliennes. » Laissons-nous prendre par cette musique comme par la prose élégante d’Alain Gerber.
Jean-Pierre Longre
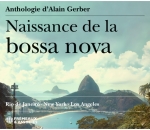 « La bossa nova est l’une des plus emblématiques des musiques populaires du XXe siècle. En plus d’avoir offert au grand répertoire quelques-uns de ses plus beaux fleurons elle a placé la musique brésilienne sur le devant de la scène internationale. En parallèle à son ouvrage, Alain Gerber sélectionne 45 des œuvres les plus emblématiques des débuts de la bossa nova entre Brésil et États-Unis. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Johnny Alf, Luiz Bonfá, Carlos Lyra et Baden Powell font échos à Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck et Sonny Rollins. »
« La bossa nova est l’une des plus emblématiques des musiques populaires du XXe siècle. En plus d’avoir offert au grand répertoire quelques-uns de ses plus beaux fleurons elle a placé la musique brésilienne sur le devant de la scène internationale. En parallèle à son ouvrage, Alain Gerber sélectionne 45 des œuvres les plus emblématiques des débuts de la bossa nova entre Brésil et États-Unis. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Johnny Alf, Luiz Bonfá, Carlos Lyra et Baden Powell font échos à Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck et Sonny Rollins. »
Patrick Frémeaux
- CD 1 - RIO DE JANEIRO : HEITOR VILLA-LOBOS : BACHIANA BRASILEIRA N° 5 • DICK FARNEY & LUCIO ALVES : TEREZA DA PRAIA • JOHNNY ALF : RAPAZ DE BEM • ANTÔNIO CARLOS JOBIM & VINÍCIUS DE MORAES : SE TÔDOS FÔSSEM IGUAIS A VOCÊ • LUIZ BONFA : LUZES DO RIO • JOÃO GILBERTO : UM ABRAÇO NO BONFÁ • ELIZETE CARDOSO : OUTRA VEZ • JOÃO GILBERTO : CHEGA DE SAUDADE • DORIVAL CAYMMI : SAMBA DA MINHA TERRA • JOÃO GILBERTO : SAMBA DA MINHA TERRA • TRIO CAMARA : MUITO A VONTADE • JOÃO GILBERTO : HO-BÁ-LÁ-LÁ • ELIZETE CARDOSO : SERENATA DE ADEUS • BADEN POWELL : SAMBA NOVO, PT. 2 • BADEN POWELL : PARA NÂO SOFRER • MAYSA (MATTARAZZO) : O BARQUINHO • SYLVIA TELLES : SE É TARDE ME PERDOA • JOÃO GILBERTO : LOBO BOBO • SYLVIA TELLES : DISCUSSÃO • JOÃO GILBERTO : SAMBA DE UMA NOTA SO • JOÃO GILBERTO : DESAFINADO • SYLVIA TELLES : CORCOVADO • CARLOS LYRA : COISA MAIS LINDA • CARLOS LYRA : MARIA NINGUÉM • OS CARIOCAS : TUDO É BOSSA • SÉRGIO RICARDO : MAXIMA CULPA • ANIBAL SARDINHA “GAROTO” : ALMA BRASILEIRA • OSCAR CASTRO-NEVES : AULA DE MATEMATICA.
CD 2 - (QUELQUE CHOSE SUR L’AMÉRIQUE DU NORD) : CURTIS FULLER : ONE NOTE SAMBA • DAVE BRUBECK : VENTO FRESCO • STAN GETZ & CHARLIE BYRD : É LUXO SÓ • CAL TJADER : SE É TARDE ME PERDOA • SONNY ROLLINS : THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES • DIZZY GILLESPIE : DESAFINADO • BOB BROOKMEYER : CHORA TUA TRISTEZA • STAN GETZ : BIM BOM • ZOOT SIMS : MARIA NINGUEM • QUINCY JONES : BLACK ORPHEUS • DAVE PIKE : PHILUMBA • COLEMAN HAWKINS : UM ABRAÇO NO BONFÁ • IKE QUEBEC : FAVELA • LALO SCHIFRIN : RAPAZ DE BEM • CHARLIE ROUSE : VELHOS TEMPOS • GEORGE SHEARING : MANHA DE CARNAVAL • BUD SHANK : PENSATIVA.
DIRECTION ARTISTIQUE : ALAIN GERBER
09:53 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, alain gerber, patrick frémeaux, alain lesage, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2025
Une entrée en littérature
 Philippe Vilain, Mauvais élève, Robert Lafont, 2025
Philippe Vilain, Mauvais élève, Robert Lafont, 2025
« Mauvais élève », Philippe Vilain le fut toute son enfance, jusqu’à ce que, décidant d’échapper aux horizons limités offerts par le BEP, il découvre la littérature et la philosophie, passe le baccalauréat, puis entame des études de Lettres qui le mèneront jusqu’au doctorat.
Voilà qui est vite résumé, et qui ne ferait pas la matière d’un livre s’il n’y avait pas tout le reste, notamment la rencontre avec Annie Ernaux qui, après un échange de correspondance, s’éprit de lui et le fit entrer dans sa vie. C’est ainsi que, lui-même séduit, il fit avec elle de beaux voyages, côtoya l’aristocratie des Lettres, ne se privant pas d’observer d’un œil acéré ce monde tout nouveau pour lui : « Je savais, grâce à un discernement exercé, saisir la personnalité de chacun, identifier leur appartenance sociale, à leur diction, façon de s’exprimer, posture, manière de se coiffer, de se vêtir, de s’approprier certaines marques ; je pouvais rapidement distinguer les aristocrates, les nobles, les bourgeois, les petits-bourgeois, démasquer les imposteurs, remarquer ceux qui n’appartenaient pas à ces cercles, les opportunistes qui n’y avaient pas grandi mais qui y étaient tolérés, les parvenus qui l’avaient conquis par des relations, mais qu’une assurance surjouée trahissait, tous ceux-là jusqu’aux belles provinciales séductrices mais désargentées qui me souriaient. »
Si sa compagne, bien plus expérimentée que lui, lui fait découvrir ce nouveau monde, elle devient aussi sa maîtresse en écriture ; sous sa houlette, il découvre la « dimension stakhanoviste » d’une tâche « semblable à un travail musical de gammes ou de répétitions », et apprend que « l’écriture demande un investissement sans faille, un apprentissage de l’humilité, une obéissance à une méthode, offrant finalement peu de jubilation, peu de plaisir. » En filigrane, on devine une relation de dominante à dominé, d’aristocrate des Lettres à jeune « plouc » (le mot a été dit) qui, en y réfléchissant, s’aperçoit que celle qui se désigne comme une « transfuge de classe » l’est beaucoup moins que lui : « C’était une erreur de croire que nous avions vécu la même enfance, puisque, en réalité, et heureusement pour elle, elle n’avait pas subi directement la violence et la pauvreté des classes inférieures, des déshérités, elle n’avait pas affronté le licenciement économique de ses parents, les dettes et la saisie immobilière, l’alcoolisme d’un père, l’échec scolaire. »
L’objet principal de Mauvais élève n’est pas tant le récit d’une relation amoureuse initiatrice et hors normes que celui d’une accession à la littérature et à ses dimensions, en même temps qu’une réflexion sur l’écriture elle-même, en particulier sur l’écriture autobiographique, ses « stratégies », ses « distorsions », « la façon dont un écrivain peut transformer son histoire, l’infléchir dans un sens plutôt que dans un autre, instrumentaliser ses expériences par les ruses du genre. » Au-delà des aspects anecdotiques, l’important est là : l’exploration d’une entrée en littérature et la découverte de ses mystères.
Jean-Pierre Longre
21:56 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, francophone, philippe vilain, robert lafont, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/09/2025
Hurlement de la vie, épuisement du langage

La publication du Cri du barbeau est l'occasion, pour les éditions Corti, de rééditer La Symphonie du loup, dont la chronique ci-dessous avait été publiée en septembre 2010.
Marius Daniel Popescu, La Symphonie du loup, José Corti, 2007
Prix Robert Walser 2008, réédition éditions Corti, 2025
Marius Daniel Popescu est né en Roumanie et vit actuellement à Lausanne. Il s’est fait connaître il y a quelques années par ses Arrêts déplacés, recueil de poèmes où la vie quotidienne se décline en miniatures ciselées avec une amoureuse précision. Il rédige et publie en outre avec régularité Le Persil, journal atypique, inimitable, où fleurissent les mots du quotidien. Marius Daniel Popescu est un poète, et l’important roman qu’il vient de faire paraître en est une preuve supplémentaire.
 Car les 146 sections des 399 pages (soyons précis !) de La Symphonie du loup sont autant de poèmes en prose. Juxtaposition de tableaux, d’instantanés, de scènes représentant les petits et grands faits d’une existence, le texte est un puzzle à la Perec, une tentative d’épuisement du langage par la vie elle-même, qui devrait triompher des mots, les effacer purement et simplement, ces mots ressassés, réitérés, s’étalant sans vergogne sur la page, et qui « ne devraient pas exister » (leitmotiv tout aussi ressassant). Car ils sont de vrais pièges, des pièges à loup : « Tu as appris tôt la duplicité du monde, la duplicité des gens, la duplicité des mots. Tu as appris depuis petit que le même mot peut provoquer ou arrêter une bagarre. Même le mot cerisier, tu savais qu’il est à la fois donneur de vie et meurtrier ». Et encore : « Quand je lis des mots inscrits quelque part, dans des livres de toutes sortes, sur des murs, dans les journaux ou sur les affiches publicitaires, je ne m’approche pas de leur sens avec une envie de recevoir du plaisir. Je ne cherche pas le plaisir dans les mots ». Et plus on approche de la fin, plus les séquences deviennent brèves, réduites au minimum verbal, au squelette narratif, et le puzzle devient multiple, livré au hasard comme une partie de cartes.
Car les 146 sections des 399 pages (soyons précis !) de La Symphonie du loup sont autant de poèmes en prose. Juxtaposition de tableaux, d’instantanés, de scènes représentant les petits et grands faits d’une existence, le texte est un puzzle à la Perec, une tentative d’épuisement du langage par la vie elle-même, qui devrait triompher des mots, les effacer purement et simplement, ces mots ressassés, réitérés, s’étalant sans vergogne sur la page, et qui « ne devraient pas exister » (leitmotiv tout aussi ressassant). Car ils sont de vrais pièges, des pièges à loup : « Tu as appris tôt la duplicité du monde, la duplicité des gens, la duplicité des mots. Tu as appris depuis petit que le même mot peut provoquer ou arrêter une bagarre. Même le mot cerisier, tu savais qu’il est à la fois donneur de vie et meurtrier ». Et encore : « Quand je lis des mots inscrits quelque part, dans des livres de toutes sortes, sur des murs, dans les journaux ou sur les affiches publicitaires, je ne m’approche pas de leur sens avec une envie de recevoir du plaisir. Je ne cherche pas le plaisir dans les mots ». Et plus on approche de la fin, plus les séquences deviennent brèves, réduites au minimum verbal, au squelette narratif, et le puzzle devient multiple, livré au hasard comme une partie de cartes.
En même temps, La Symphonie du loup est un roman au souffle inépuisable, un souffle qui vous transporte entre passé et présent. L’enfant, le jeune homme qui, comme sa famille et ses compagnons, évoluait sous et malgré l’omniprésence de la dictature, est simultanément ce père de famille qui voit agir et fait grandir ses enfants, la « petite » et la « grande », dans son pays d’adoption. « L’école de la vie », qui signifie « tout ce qu’un être humain peut vivre et comprendre et apprendre sur la terre », est ici et là, en un constant va-et-vient entre là et ici. C’est une école qui enseigne tout, y compris la mort : celle du père, qui est au départ de la narration, celle de l’enfant à naître, relatée en des pages hallucinantes d’émotion contenue : « ce monde est fou, nous sommes des fous parmi les fous, je ne veux pas d’un enfant de fou dans un monde de fous ! », dit en pleurant la fiancée qui « souffrait beaucoup à cause de la vie que le parti unique avait instaurée au pays »… Ce « parti unique » est partout, transformant les hommes en « figurants » obligés de répondre « présent ! » alors que pour survivre ils ne peuvent qu’être mentalement ailleurs.
Le souffle du roman, c’est aussi le style, un style qui prend à la gorge. Le style c’est l’homme, a dit quelqu’un il y a quelques siècles ; mais l’homme est un loup pour l’homme, avait dit un autre un peu auparavant ; résultat de l’équation (qu’aurait donné le héros, féru de mathématiques) : le style, c’est le loup, dont le chant, murmuré ou hurlé, ne peut pas laisser indifférent. Roman à la deuxième personne, parole adressée par le grand-père à son petit-fils, La Symphonie du loup utilise le « tu » général, universel, mais le « je » et le « il » sont là, tout près, en embuscade dans le train du récit : « Tu es resté dans ce compartiment un peu plus d’une heure, presque endormi tu avais pensé à toi à la première personne, tu t’es vu à la deuxième personne, tu t’es regardé et tu t’es écouté à la troisième personne comme quelqu’un qui se regarde dans une glace et s’appelle soi-même, alternativement, par « je », par « tu » et par « il » ».
Transparente simplicité des faits, absurde complexité de la vie. Le loup dévore les mots, et cependant il les métamorphose en un chant aux insondables harmoniques et aux interminables échos.
Jean-Pierre Longre
17:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, suisse, marius daniel popescu, josé corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/08/2025
La danse des mots, la vie des humains
 Marius Daniel Popescu, Le cri du barbeau, éditions Corti, 2025.
Marius Daniel Popescu, Le cri du barbeau, éditions Corti, 2025.
Sortie le 4 septembre 2025
Il y a chez Marius Daniel Popescu une générosité à la fois naturelle et illimitée. Pas seulement lorsque le « tu » qui le représente offre, dans son « pays d’ici », un repas au restaurant à un clochard puis l’invite à dormir chez lui, ou lorsque, dans son « pays de là-bas », il nourrit de friandises une dizaine d’enfants des rues puis les emmène en taxi au restaurant de la gare ; la générosité, c’est aussi celle de sa prose, qui se nourrit des moindres détails de la vie et en fait, par la magie des mots, tout un roman ; en plus, il nous dit comment il fait : « Tu frappes les touches de cette machine à écrire, tu ne regardes pas les lettres qui s’impriment sur le papier, tu te racontes à toi-même des histoires de ta vie, tu tapes vite des mots qui n’appartiennent pas à la pensée. Il est trois heures du matin, la nuit te regarde et elle te sourit, ses yeux réveillent en toi la vie sous le règne du parti unique, tu continues à raconter la mort de ton père, tu as choisi qu’un vieil homme sera le narrateur. Tu ne laisses pas de marges sur la feuille, les mots remplissent le blanc du papier jusqu’à la barrière du rouleau noir, tu passes à la ligne suivante, la nuit te suit. »
Si l’on apprend sur le tard que le « vieil homme » omniscient qui raconte est le grand-père de « tu », celui-ci reconnaît aussi la grande autonomie des mots imprimés sur la page : « Les mots s’organisent, ils se donnent rendez-vous pour discuter de leur passé et de leur avenir, les mots se mettent ensemble, ils forment de petits groupes et des hordes de mots traversent les villages et les villes du monde, les mots parcourent nos foyers, les écoles et les entreprises, les mots marchent et ils s’envolent et ils naviguent, les mots sursautent et ils virevoltent, les mots sont en branle. » C’est ainsi que les faits se révèlent, par le pouvoir magique du verbe. Des faits qui peuvent être amusants, comme le refus d’un étalon à honorer la belle jument qu’on lui présente, et qui ne se décide que lorsqu’on a couvert celle-ci de boue ; conclusion d’un spécialiste : « La jument, elle lui paraissait trop belle pour lui ; c’est tout. »
C’est parfois franchement drôle, mais c’est plus souvent souriant, avec une grande tendresse pour les individus croisés au fil des pages, avec lesquels les verres partagés sont autant de signes d’attachement, famille, amis ou inconnus, qui le rendent bien au narrateur – exception faite pour ceux qui se sont accaparé le pouvoir : les dirigeants et les sbires du « parti unique » dans « le pays de là-bas », auxquels ont succédé des personnages qui, sous une apparence démocratique, sont restés identiques à ceux de l’ancien régime, profitant de la corruption ambiante : « Dans ton pays de là-bas la vie est très dure à la campagne, la région de ton enfance est administrée par le parti le plus corrompu, beaucoup de gens sont partis travailler à l’étranger, ceux qui restent se débrouillent dans la vie de chaque jour, ils se disent qu’ils n’ont qu’à suivre leur sort. » Et la satire n’épargne pas non plus d’autres catégories : « Les prêtres bénissent à tour de bras des maisons, des appartements, des voitures, des écoles, des ponts, des hôpitaux, des bureaux, ils bénissent tout et n’importe quoi et ils se font payer pour cela, les prêtres gagnent beaucoup d’argent en bénissant. »
Le cri du barbeau (le barbeau, ce poisson que tout jeune notre héros s’efforçait de pêcher avec ses copains, et qui criait véritablement lorsqu’il se faisait prendre) fait suite à La Symphonie du loup (2007) et aux Couleurs de l’hirondelle (2012), publiés aussi aux éditions Corti. Outre le style, le surgissement des souvenirs, les méandres de la vie, avec ses plaisirs et ses vicissitudes, le point commun entre les trois romans est ce que cette vie n’épargne jamais, la mort : au début du premier, la mort du père ; au début du second, celle de la mère ; au début du troisième, celle d’un grand ami resté dans le « pays de là-bas », une mort qui déclenche le va-et-vient entre là-bas (la Roumanie) et ici (la Suisse), le passé et le présent, et qui révèle les multiples facettes d’une existence pleine d’attention pour tous les humains croisés. Un beau roman qui transforme le quotidien en épopée, et dont nous avions déjà eu quelques aperçus dans le fameux journal Le Persil (voir par exemple les numéros 187 et 222-223), un beau roman qu’il convient de lire dans un même et long souffle.
Jean-Pierre Longre
19:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, suisse, roumanie, marius daniel popescu, éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/08/2025
La détresse et la beauté
 Pascal Quignard, Trésor caché, Albin Michel, 2025
Pascal Quignard, Trésor caché, Albin Michel, 2025
Le titre et le début laissent envisager un roman d’aventures, et c’est le cas. Mais lire un roman de Pascal Quignard, c’est suivre les méandres infiniment poétiques de la mémoire et de la vie intérieure, et c’est aussi le cas. Le premier épisode, qui relate la découverte par Louise d’un réel trésor enfoui – pièces d’or et bijoux –, alors qu’elle enterre son chat au fond du jardin, est à la fois nécessaire et vite oublié : si cette découverte lui permet de voyager à sa guise, ce sont d’autres trésors qu’elle va trouver.
À commencer par la rencontre à Capri de Luigi, ou Ludwick, ou Ludovico, comme elle-même est peut-être Ludovica… Rapprochements intimes et variations musicales sur des prénoms qui passent les frontières, comme il y a des variations sur les états de l’eau, mer au large de Naples ou bras mort de l’Yonne, eau agitée ou stagnante, toujours porteuse de poésie ; comme aussi sur les noms des chats dont elle fait la connaissance sur les îles italiennes : Köthene et Bach, « l’oreille et le petit ruisseau », dont la mère s’appelait Arria ; des malices musicales, et surtout un autre trésor, une autre source de poésie : la présence des félins qui rythment la vie de Louise, qui l’attendent patiemment lorsqu’elle est absente, ou qui partagent avec elle des moments intimes et intenses : « Tous les trois dehors dans l’aube laiteuse ils bondirent sur la table et tous les trois nous petit-déjeunâmes de bon cœur. Puis nous parlâmes. Puis nous recommençâmes de manger. Puis nous bûmes. Puis nous fîmes pipi. Puis nous ronronnâmes. Puis le silence su fit. Le soleil nous toucha. De nouveau nous étions présents à ce monde. C’est peut-être la définition du bonheur : immédiat dans la présence. »
Nous sommes au centre des doutes, des malheurs et des bonheurs de Louise, que l’on saisit de l’intérieur (première personne) ou de l’extérieur (troisième personne), Louise hantée par la mort : celle de Peer, ce vieux chat qui lui a permis de découvrir le trésor ; et celle des hommes aimés : « C’est impossible à confesser. C’est encore plus curieux à penser, alors que les trois hommes avec lesquels j’ai vécu sont morts : mon père du temps de l’Aigle, Jean [le père de sa fille] du temps de Metz, Luigi du temps d’Ischia. Quand je considère les quelques garçons avec lesquels j’ai vécu, il me faut dire : « Peer, c’est toi qui as été l’amour de ma vie. » » Et donc aussi, Louise l’amoureuse, qui goûte les trésors de la vie. Il faut la plume précieuse de Pascal Quignard pour dire la complexité du cœur, de l’esprit et du corps, détresse et beauté mêlées : « Le chagrin illumine étrangement le monde. Le deuil y porte son ombre mais cette ombre, souvent, en souligne, en accuse, en augmente la beauté en même temps que la détresse. L’une et l’autre appartiennent au plus insaisissable de l’âme. C’est ainsi que la mélancolie embellit le présent. »
Jean-Pierre Longre
En lire plus sur Pascal Quignard :
http://jplongre.hautetfort.com/apps/search/?s=Quignard
Quignard et la peinture : Le regard et le silence. Terrasse à Rome de Pascal Quignard. .pdf
Quignard et la musique : Les oreilles n'ont pas de paupières... La haine de la musique de P.Q..pdf
20:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, pascal quignard, albin michel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

