03/08/2025
Les déchirements et les découvertes de l’exil
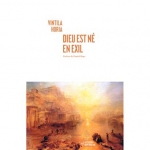 Vintilă Horia, Dieu est né en exil, Les Éditions Noir sur Blanc, 2025
Vintilă Horia, Dieu est né en exil, Les Éditions Noir sur Blanc, 2025
La vie de Vintilă Horia (1915-1992) incarne d’une manière significative l’exil imposé par les forces politiques. Après l’oppression subie par le fascisme de la garde de fer et le nazisme allemand, il refusa de se compromettre avec le régime communiste et vécut dans plusieurs pays dont il adopta tour à tour la langue et la culture : l’Italie, l’Argentine, l’Espagne, la France. C’est en français qu'il publia chez Fayard son roman le plus marquant, Dieu est né en exil. Il devait recevoir le Prix Goncourt, mais cette perspective se heurta à l’opposition de plusieurs intellectuels, accusant l’auteur d’être « réactionnaire » et « ennemi du peuple » dans son pays.
Le déchirement de l’exil y est incarné par le personnage d’Ovide, lui-même relégué aux confins du monde, à Tomis, future Constanţa. Nul doute que la thématique de l’ouvrage ne soit en lien direct avec l’expérience intime de l’auteur, qui combine, ici et ailleurs (par exemple dans Le chevalier de la résignation) la maîtrise de la langue française avec la roumanité et la réflexion sur les rapports avec l'étranger. Écrire en français sur un poète antique chassé de son environnement familier est un moyen, pour Vintilă Horia, d’exorciser la douleur inhérente à l’exil linguistique et géographique, et d’opérer une fusion entre deux cultures d’appartenance par la prise en compte personnelle du bilinguisme.
Peu à peu, perce à travers les vers d’Ovide une évolution de ses sentiments à l’égard du pays et de ses habitants. Il fait des excursions dans l’arrière-pays et le Delta du Danube, apprend à parler le Gète et le Sarmate, écrit des vers gétiques, et reconnaît chez les gens qui l’entourent des marques des sentiments amicaux. C’est peut-être ce qui a conduit l’écrivain roumain à montrer dans son roman un Ovide souvent malheureux, mais plein d’humanité. Dans ce journal imaginaire d’Ovide à Tomes, Horia, s’inspirant des œuvres du poète latin, imagine que celui-ci, dépassant sa solitude, s’initie peu à peu, à travers ses rencontres de sages et de prêtres gètes et grecs, à une spiritualité qui lui fera découvrir une religion à la dimension du christianisme à venir. Il s’agit bien sûr d’une œuvre de fiction, mais dont les personnages et le cadre sont particulièrement attachants.
Redécouvrir Ovide en son exil, c’est donc se replonger dans l’antiquité roumaine, qui se rattache, sous la plume de l’auteur, aux fondements historiques (par exemple les origines grecques de Tomes-Constanţa), géographiques (voir dans Les Pontiques la liste des fleuves qui se jettent dans la Mer Noire), mais aussi mythiques de l’Europe (le poète fait surgir dans ses vers, pour les mettre en relation avec sa terre d’exil, les légendes de la Toison d’Or, de Médée la magicienne, d’Iphigénie...). La terre roumaine représenta pour Ovide les confins du monde « civilisé », mais ses vers nous rappellent qu’elle est à tout point de vue l’un des berceaux de notre vieille Europe. Et Vintilă Horia contribue avec art et détermination à ce rappel.
Jean-Pierre Longre
18:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, vintilă horia, ovide, éditions noir sur blanc, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/07/2025
« Poésie et vérité »
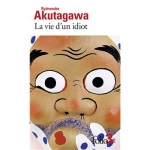 Ryūnosuke Akutagawa, La vie d’un idiot, précédé d’Engrenage, traduit du japonais par Edwige de Chavanes, Folio, 2024
Ryūnosuke Akutagawa, La vie d’un idiot, précédé d’Engrenage, traduit du japonais par Edwige de Chavanes, Folio, 2024
« Rassemblant ses dernières forces, il voulut rédiger son autobiographie. Mais cela fut plus difficile qu’il ne l’avait imaginé : il restait encore trop susceptible, trop sceptique et calculateur aussi. Il ne pouvait s’empêcher de se mépriser. Sans pouvoir par ailleurs s’empêcher de penser : « Que l’on gratte un peu la peau : dessous, nous sommes tous les mêmes. » Poésie et vérité : le titre à son sens de toute autobiographie. » Ces quelques lignes, avec la double référence à des titres de Goethe et d’Éluard, semblent bien dévoiler l’objet de La vie d’un idiot. Une nouvelle qui, composée de 51 textes brefs, est assimilable à un long poème composé d’autant de strophes. Les textes évoquent, sous des formes déroutantes et séduisantes (une caractéristique entraînant l’autre, et vice-versa), l’art (la peinture de Van Gogh, la musique de Mozart…), la littérature (par exemple Voltaire plutôt que Rousseau), la nature (pas toujours réjouissante), mais aussi, en filigrane ou en clair, le moi en proie à la violence, à la maladie et à la mort.
Car cette nouvelle posthume, publiée en 1927, laisse prévoir le suicide de l’auteur, comme celle qui s’intitule Engrenage et qui la précède dans ce recueil. Celle-ci, en six chapitres, raconte à la première personne les trajets et errances d’un homme, au cours desquels il croise une sorte de fantôme « en manteau de pluie », et voit parfois d’étranges engrenages. La mort et la folie le guettent lors de ses étapes et pérégrinations. « Je ne pouvais m’empêcher de sentir que ma vie était […] arrivée à échéance. Et je ne pouvais non plus me défendre du sentiment que ce n’était pas le hasard qui, au bout de dix ans, avait conduit mes pas jusqu’ici. » Et ailleurs, sereinement et fatalement : « Je me sentis comme sauvé et décidai d’attendre l’aube patiemment ; comme un vieillard qui, après avoir survécu aux souffrances d’une longue maladie, attendrait doucement la mort… »
L’image de l’engrenage illustre singulièrement l’art consommé de la narration dont fait preuve Ryūnosuke Akutagawa dans ces deux textes comme dans les précédents. Mystérieusement, progressivement, subrepticement, poétiquement, ses mots et ses phrases nous mènent, à pas comptés, vers l’issue fatale dont il veut nous livrer le secret, en toute vérité.
Jean-Pierre Longre
19:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, japon, ryūnosuke akutagawa, edwige de chavanes, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/07/2025
Virgil Tanase (1945-2025)
 Virgil Tanase, écrivain, homme de théâtre, traducteur, né en 1945, exilé en France en 1977, est décédé en juin 2025.
Virgil Tanase, écrivain, homme de théâtre, traducteur, né en 1945, exilé en France en 1977, est décédé en juin 2025.
Virgil Tanase fait des études de lettres avant d’être admis dans la classe de mise en scène de l’Institut de théâtre de Bucarest.
A la suite de la publication à Paris de son premier roman : Portait d’homme à la faux dans un paysage marin (Flammarion, 1976), interdit en Roumanie, et d’un entretien virulent dans « Les Nouvelles littéraires », il est obligé de quitter son pays.
A Paris, il continue une carrière littéraire couronnée par le Prix de littérature de l’Union latine et le Prix de dramaturgie de l’Académie roumaine. Ses romans, rédigés dorénavant en français, mettent en œuvre une nouvelle forme de construction littéraire : la « métaphore narrative » qui associe des récits disparates dont le voisinage projette une signification qu’aucun ne peut imposer par lui-même.
Après une thèse de doctorat sous la direction de Romand Barthes consacrée à la « sémiologie de la mise en scène », Virgil Tanase reprend son activité de metteur en scène et réalise une trentaine de spectacles en France et en Roumanie. .
Professeur occasionnel dans différentes écoles de théâtre, Virgil Tanase enseigne aujourd’hui l’histoire des spectacles à l’Institut international de l’image et du son.
Source : www.m-e-l.fr
Ci-dessous, deux rappels de son activité littéraire…
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2013/07/20/l-honneur-et-la-litterature-5125620.html
09:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2025
L’honneur et la littérature
 Virgil Tanase, Saint-Exupéry, Gallimard, Folio-biographies, 2013
Virgil Tanase, Saint-Exupéry, Gallimard, Folio-biographies, 2013
Certes, le livre de Virgil Tanase, conforme à l’intitulé de la collection dans laquelle il est publié, est une biographie d’Antoine de Saint-Exupéry, au sens strict du terme. C’est-à-dire que, depuis sa naissance en 1900 (et même depuis l’ascendance lointaine de sa noble famille) jusqu’à sa disparition en mission le 31 juillet 1944, il raconte la vie mouvementée de l’aviateur, amateur de fêtes et de tours de cartes, ami fidèle, amoureux dispersé, inguérissable distrait, dépensier insoucieux, hypocondriaque soucieux, fumeur invétéré, retardataire régulier, écrivain scrupuleux, orgueilleux, modeste et lucide… Aucun épisode important et significatif de la vie de l’auteur de Terre des hommes et du Petit Prince n’est passé sous silence, et l’ensemble est le fruit d’une documentation sans faille et d’une recherche approfondie de la vérité, dégagée du mythe.
Une vraie biographie, donc, de la part de quelqu’un qui s’y connaît, mais qui ne s’en tient pas seulement aux faits. Cette recherche de la vérité, c’est celle de l’homme Saint-Exupéry, et par la même occasion de l’Homme universel, tel que l’écrivain aurait voulu qu’il fût, en quête de ce fameux essentiel qui reste invisible. Virgil Tanase, tout en évoquant l’indispensable contexte historique et l’atmosphère d’une époque tourmentée, analyse finement l’idéal de l’écrivain qui cherche à se libérer de l’emprise matérialiste, qu’elle soit de gauche ou de droite, communiste ou capitaliste, mettant en avant « la civilisation qui permet aux individus de s’épanouir par l’esprit plutôt que de satisfaire des appétits vulgaires », notamment l’enrichissement à tout prix ou ce qu’il appelle « la civilisation du téléphone » (ô combien actuelle !). Ce qui est rapporté ici, c’est la vie extérieure et intérieure d’un homme de paix qui doit s’engager dans la guerre contre le nazisme, d’un artiste tous azimuts qui doit maîtriser son art, d’un homme absolument désintéressé qui doit subvenir à ses besoins et à ceux d’une épouse aussi volage que lui, d’un technicien qui doit jouer les intellectuels, bref d’un homme de « devoir », pour qui l’honneur n’est pas un vain mot. Et comment ne pas deviner, comme en une accointance secrète, ce que ressent Virgil Tanase lorsqu’il écrit, par exemple :
« Il se bat quand même.
Par solidarité, par devoir, persuadé que la vie ne vaut que par le sacrifice qu’on en fait au nom d’un devoir absolu, d’une évidence indiscutable, envers les autres, quels qu’ils soient. » ?
Jean-Pierre Longre
21:15 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biographie, essai, francophone, antoine de saint-exupéry, virgil tanase, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Le poids de l’Histoire et la séduction du Roman
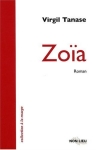 Virgil Tanase, Zoïa, éditions Non Lieu, 2009
Virgil Tanase, Zoïa, éditions Non Lieu, 2009
On pourrait aborder Zoïa comme un roman historique. Tout y serait, sur le plan événementiel, des années 1930 à nos jours, de l’Est à l’Ouest de l’Europe (et même, épisodiquement, jusqu’à Montevideo). Virgil Tanase rappelle, par le truchement de ses personnages, des épisodes de la guerre sur le front de l’Est, de la lutte des résistants en France, de l’avènement du communisme en Roumanie, dans un mélange et une succession d’idéalisme, d’opportunisme, de peur et d’ambition, mai 1968 au Quartier Latin, l’accession de la gauche au pouvoir en France, les bouleversements de 1989-1990 dans les pays d’Europe Centrale et Orientale, particulièrement en Roumanie, le capitalisme sans vergogne et le culte de l’argent prenant le pas sur le collectivisme imposé et l’uniformisation sociale…
Bref, une sorte de bilan historique suscitant – autre plan de lecture possible – réflexions et discussions sur les contradictions des systèmes politiques et économiques, sur les liens plus ou moins patents entre le fascisme et le communisme, sur la place de l’individu dans la collectivité, sur le complexe d’infériorité d’une petite nation et de ses ressortissants exilés, sur la faculté d’adaptation des Roumains aux cultures, aux langages, aux régimes qui les traversent, sur les désillusions des militants : « Je ne suis pas un déçu du communisme. J’y crois toujours ! Non, ce que je ne puis supporter, c’est de vivre sur une terre qui n’est profitable qu’aux vers et aux fauves. Les hommes sont indignes du monde que nous avons rêvé ». Les grands débats, les brassages d’idées dans des dialogues sans fin ne font pas peur à un auteur qui connaît bien tout cela, et dont on sait la prédilection pour le théâtre.
Surtout, Zoïa est une œuvre littéraire, un roman, qui fait de l’Histoire un matériau malléable. « Notre vocation, à nous, romanciers, n’est pas de délivrer un message, ni d’indiquer un sens, mais de proposer au lecteur une épreuve, lui donner l’occasion d’assumer des situations et des conflits qu’il n’a jamais vécus », dit l’un des personnages, écrivain de son état. La chronologie est bouleversée, le rêve se mêle à la réalité, l’illusion et l’action se complètent… Au centre du tourbillon, apparaissant et disparaissant sans crier gare, Zoïa, à qui ses parents, Mircea et Ana, ont donné ce prénom russe par admiration pour l’URSS, Zoïa, belle et flétrie, tendre et cruelle, riant et pleurant, présente et absente, « jetant tour à tour le chaud et le froid », adorant « les situations glauques lui permettant d’exercer une sorte de terrorisme psychologique », Zoïa qui, dans toute son ambiguïté, dans tout son mystère, revêt la séduction des véritables personnages romanesques.
Jean-Pierre Longre
21:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, virgil tanase, non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/07/2025
L’aventure et l’amitié
 Panaït Istrati, Isaac le tresseur de fil de fer suivi de En Égypte, illustrations de Golo, postface de Christian Delrue, coll. Voix d’en bas, éditions Plein Chant, 2025
Panaït Istrati, Isaac le tresseur de fil de fer suivi de En Égypte, illustrations de Golo, postface de Christian Delrue, coll. Voix d’en bas, éditions Plein Chant, 2025
« Les enthousiastes, qu’ils soient ou non juifs, sont toujours des hommes encombrants sur cette terre. » « La destinée du vagabond est totalement contraire à celle que la création octroie au commun des mortels. » Au cas où on ne l’ait déjà fait, on mesure ici combien Panaït Istrati avait le sens de la formule, qu’il s’agisse de relater des aventures vécues par lui-même ou par ses héros. Lui-même ou ses héros : oui, car ce que vivent ceux-ci est souvent tiré de l’expérience de celui-là. La preuve en est donnée ici, grâce à la réunion bienvenue de deux récits relatifs à l’Égypte : Isaac le tresseur de fil de fer (qui sera repris dans La Famille Perlmutter) et En Égypte (précédemment intitulé Entre l’amitié et un bureau de tabac), c’est-à-dire une fiction et une narration autobiographique.
Qu’on ne s’y trompe pas : si les contextes sont similaires, les récits sont différents, dans leur contenu et dans leur style. Christian Delrue le constate dans sa postface : « D’une tonalité plus profonde et d’une progression dans l’intensité favorisée par la dimension restreinte d’une nouvelle, Isaac dégage une force interne et une qualité littéraire peu commune comparables à celles qui se déploient dans le roman Les Chardons du Baragan. » En revanche, même si l’auteur y déploie joyeusement son sens du pittoresque, En Égypte s’en tient à des souvenirs avérés. Revenons à la fiction: Isaac, jeune Juif roumain, a déserté, quitté sa famille et s’est réfugié en Égypte par amour. Situation d’emblée dramatique : un amour perdu, un geste désespéré, un refuge illusoire ; car si en Égypte il trouve de l’amitié – celle du cabaretier Binder, originaire de Galatz, et celle de Youssouf, vieux Juif arabe marchand de loteries –, ces deux amitiés provoquent chez le jeune garçon un incessant tiraillement entre la joie de vivre et la piété intransigeante ; alors, le drame se mue en tragédie, en une progression que seul un véritable écrivain sait ménager. Dans En Égypte, Istrati relate des faits vécus, en mettant en avant son amitié avec Mikhaïl et les aléas du vagabondage avec les peurs qu’il provoque, cela dès le début : « Mon cœur se réduisit aux dimensions d’une puce, au moment où je me sentis livré à ce premier grand hasard de mon existence : oser affronter le monde, sans argent, sans papier, sans même avoir payé sa place. » ; mais aussi, de ce même vagabondage, les bonheurs : « Une vie pleinement vécue, si par vie on veut bien entendre le culte de nos désirs. »
Si, comme l’écrit encore Christian Delrue, ces deux textes « appartiennent au versant oriental de l’œuvre de Panaït Istrati qui a contribué à son succès au moins autant que ses récits roumains », ils sont aussi une bonne initiation à la lecture de ses livres pour un public qui ne les connaîtrait pas. Car, dans leurs différences, ces deux récits sont singulièrement représentatifs de l’art complet de l’auteur, narrateur hors pair, aussi bien dans la fiction que dans l’autobiographie. Et les illustrations de Golo, grouillantes de vie et d’une expressivité inoubliable, donnent un piment artistique supplémentaire à l’écriture littéraire.
Jean-Pierre Longre
09:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, autobiographie, francophone, roumanie, panaït istrati, golo, christian delrue, éditions plein chant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/06/2025
Chute et jubilation
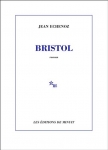 Jean Échenoz, Bristol, Les éditions de minuit, 2025
Jean Échenoz, Bristol, Les éditions de minuit, 2025
Souvenez-vous : dans Vie de Gérard Fulmard, on assistait à la chute de Mike Brant depuis le sixième étage de son immeuble. Voyez maintenant la première phrase du nouveau roman de Jean Échenoz : « Bristol vient de sortir de son immeuble quand le corps d’un homme nu, tombé de haut, s’écrase à huit mètres de lui. » En fait, on ne saura que très tard qui est cet homme, et en vérité ce n’est pas le plus important. Mais une chute initiale dans un roman n’est pas anodine, et on peut se dire qu’elle en préfigure d’autres, surtout lorsqu’on connaît un peu les ruses romanesques de l’auteur. Bristol ? Un réalisateur dont les films n’ont jamais connu un grand succès ; un simple « Clap de bronze » pour l’un d’entre eux, et pour son dernier film, celui dont il est question dans le livre et au tournage africain duquel on assiste, un ratage à peu près complet. La chute de Bristol, en quelque sorte.
Cela dit, le récit ne suit pas un fil continu, loin de là. Méandres, digressions, sauts inattendus d’un épisode à un autre ou d’un personnage à un autre, scènes imprévues comme sait en improviser Bristol au cours du tournage de son film, disparitions et enlèvements… Échenoz promène sans vergogne le lecteur dans la jungle des péripéties, et le lecteur, même si cela lui donne du travail et parfois le tournis, le lecteur, donc, est tout réjoui des surprises que lui réservent la prose de l’auteur et les personnages qu’il a créés. Il y a là, outre le protagoniste, différentes figures qui vont, viennent, disparaissent, réapparaissent : des actrices et acteurs comme Nadia Saint-Clair et Jacky Pasternac, un chauffeur aux divers métiers nommé Brubec, une assistante assez délurée, Marjorie Des Marais, écrivaine à succès qui impose sa protégée Céleste comme actrice dans le film de Bristol, un certain Julien Claveau, drôle de lieutenant de police, un éléphant bien dans son rôle, un commandant Milton Parker à la tête d’une milice armée jusqu’aux dents… Liste non exhaustive, mais visant à donner une idée de l’art de la dénomination (qui va de pair avec l’invention des titres de films), et surtout du bouillonnement narratif (qui va de pair avec la subtilité parodique).
Le bouillonnement narratif en question n’est pas sans s’organiser en mouvements cinématographiques (zooms, gros plans, travellings, panoramiques, plongées ou contreplongées, points de vue variés), avec passages sans transition d’une séquence à l’autre ou, parfois, comme une silhouette fugace en fondu enchaîné, une légère intervention du narrateur (fin d’un chapitre : « Ce qui ne nous arrange pas » ; début du chapitre suivant : « Cela ne fait pas du tout notre affaire… »). Mais le bouillonnement est aussi celui du langage, avec lequel l’auteur joue malicieusement, l’air de rien (« En dépit de toutes les recherches, l’affaire de l’inconnu tombé d’un dernier étage demeure pendante »). Sans parler des aspects ironiques, voire satiriques, de la tonalité. Bref, comme Jean Échenoz nous y a habitués, jamais on ne s’ennuie à la lecture de Bristol. Au contraire, on jubile. À chaque chapitre, à chaque page.
Jean-Pierre Longre
17:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean Échenoz, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/06/2025
Le roman vrai de quatre destinées
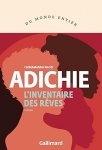 Chimamanda Ngozi Adichie, L’inventaire des rêves, traduit de l’anglais (Nigeria) par Blandine Longre, Gallimard / Du monde entier, 2025
Chimamanda Ngozi Adichie, L’inventaire des rêves, traduit de l’anglais (Nigeria) par Blandine Longre, Gallimard / Du monde entier, 2025
Vers la fin du livre, l’une des protagonistes lance à son interlocutrice : « L’inventaire de tes rêves est incomplet ! » Et quelques pages plus loin : « Quelle conclusion as-tu tirée de l’inventaire de tes rêves ? » C’est à ce moment-là que le titre prend toute sa signification, toute son ampleur, comme un point de convergence de tout ce qui précède – la relation de quatre destinées vécues en fonction des rêves qui y ont présidé.
Quatre femmes, donc, quatre Africaines qui ont en commun, outre les liens familiaux ou amicaux qui les unissent, la volonté d’accomplir leurs rêves, aussi différents soient-ils. Chiamaka, issue d’une riche famille nigériane, tente de satisfaire ses désirs amoureux sans vouloir s’attacher, ainsi que sa soif de voyages en faisant des reportages sur des régions méconnues du globe. On fait la connaissance de son amie Zikora en plein accouchement, elle qui effectivement rêvait mariage et enfants, et qui pourtant ne sera pas entièrement comblée. Omelogor, cousine de Chiamaka, est une femme d’affaires hors pair qui, tout étonnée de devenir millionnaire, va en faire profiter moins chanceux qu’elle : « Tout cet argent pouvait changer de si nombreuses vies. Il pouvait réaliser tant de rêves. » Toutes trois vont être scandalisées lorsque Kiamatou, jeune Guinéenne venue travailler au service de Chiamaka, puis comme femme de chambre dans un grand hôtel de Washington où elle subit une agression sexuelle de la part d’un client aussi célèbre qu’influent, va être déboutée lors du procès sous prétexte qu’elle a menti dans le passé.
Au-delà de leurs différences, les quatre femmes sont animées par des ambitions et des espoirs divers, chacune à sa mesure, chacune selon ses moyens et ses désirs, chacune avec ses tâtonnements, ses déceptions et sa persévérance. Sur fond de confinement dû au Covid et d’exil volontaire, Chimamanda Ngozi Adichie brosse des portraits en action avec un art précis de la description et un sens éprouvé de la narration, une narration tout en va-et-vient temporels et spatiaux, ce qui provoque à la lecture des attentes captivantes.
À propos du personnage de Kadiatou, l’autrice écrit : « L’art a pour objectif d’observer notre monde et d’en être ému, puis de s’engager à essayer de voir clairement ce monde, l’interpréter, le mettre en question. Une sorte de pureté d’intention doit présider à toutes ces formes d’engagement. Ce ne peut être un artifice, il faut que ce soit vrai à un certain niveau. Ce n’est qu’alors que nous pouvons atteindre une réflexion, une illumination et, finalement, espérons-le, une épiphanie. » On peut dire que cet objectif est parfaitement atteint. Les quatre protagonistes sont découvertes à partir de plusieurs points de vue : chacune se raconte elle-même, directement ou indirectement, et chacune est observée par les trois autres, ce qui en révèle d’autres facettes. Au lecteur, saisi par les épisodes ici rapportés, de reconstituer le puzzle présenté en plus de 600 pages. Ainsi comprendra-t-il l’humanité vraie, profondément vraie, de ces héroïnes de fiction en quête de soi, de l’amitié, de l’amour, et d’une place dans le monde. Un beau programme, développé avec brio par une romancière accomplie.
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, nigeria, chimamanda ngozi adichie, blandine longre, gallimard | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/06/2025
Du songe et du théâtre
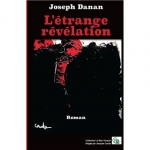 Joseph Danan, L’étrange révélation, éditions Douro, coll. Bleu Turquin, 2025
Joseph Danan, L’étrange révélation, éditions Douro, coll. Bleu Turquin, 2025
« À la fin de L’Illusion comique, […] Alcandre, sortant de sa coulisse comme un lapin de la manche d’un magicien, révèle que tout était théâtre. On aimerait bien. Ou que la vie soit un songe. Variante, d’ailleurs, plus plausible. Se réveiller et que, dans le ciel d’azur de nos enfances, une voix autorisée nous révèle, soulagés, que cette traversée insensée, au bout d’une nuit zébrée d’éclairs, n’était qu’un mauvais rêve. » Nous sommes là presque à la fin du livre, quasiment proches de cette « étrange révélation » que nous promet le titre. Disons que tout ce qui précède semble y converger.
Car avant que tout finisse (d’une manière provisoirement définitive), tout commence par le cauchemar que chacun fait parfois : se retrouver en dehors de chez soi, porte close, sans clefs, en peignoir de bain, obligé de circuler ainsi dans les rues pour, en l’occurrence, se rendre à un mariage. Pourquoi ? Parce qu’on a sorti inopportunément et prémonitoirement les poubelles : « Les ordures déboulèrent dans le conduit métallique… » Tiens ! Les premiers mots de Loin de Rueil de Raymond Queneau. Quelque chose à voir ? Oui : l’imbrication du rêve et du spectacle ; chez Queneau, le cinéma, ici, le théâtre, bien sûr – Joseph Danan étant avant tout un homme de théâtre.
Nous voilà embarqués avec le narrateur (qui aurait pu avoir une vie tranquille avec sa femme et ses enfants), de visions cauchemardesques en rencontres improbables, souvent accompagnés (le narrateur et nous) d’un homme-lapin débrouillard nommé Alfredo, péripéties dédaléennes dans lesquelles l’Université (bien connue de l’auteur) joue le rôle de lieu récurrent, avec son Président, ses étudiants et étudiantes (surtout) et ses drôles de programmes, telle « la nouvelle licence professionnelle des métiers du sexe et du soin relaxant (LPMSSR) »… Réapparaissent parfois Nora, l’épouse, et ses enfants, soit virtuellement (textos, messages téléphoniques), soit physiquement, mais c’est aussitôt pour une nouvelle séparation, bateau manqué ou porte encore fermée… Et parfois notre narrateur tente de faire le point : « La Route de l’Échec s’ouvre dans son évidence. Tandis qu’elle dévide son ruban dans la nuit trouée de la lumière des phares, c’est ma vie qui défile entre les platanes, sur les lambeaux déchirés du ciel. Tout ce qui aura été inaccompli remonte de l’abîme. Les rencontres avortées. Les promesses non tenues. Les livres non écrits. La vie non vécue. Tous ces cauchemars, comme celui de la veille au soir, en dépit du havre d’un souper et d’un sourire, qui ne le rendait que plus cruel, ces nuits perdues, ces voyages immémoriaux, ces pérégrinations sans fin. »
Terrible « sortie du labyrinthe » à prévoir. Heureusement, il y a tout le reste. Le suspense, certes, mais aussi les allusions, les références artistiques (littéraires, musicales…), les souvenirs de l’enfance, et l’humour, comique de situation et manipulations du langage, satire bienvenue et franches plaisanteries… Nous ne sommes pas loin du « pleurire » de Queneau (encore lui), et nous voilà saisis pour un bon moment par le plaisir de la lecture.
Jean-Pierre Longre
22:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, joseph danan, éditions douro, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2025
« Une histoire en cours »
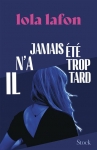 Lola Lafon, Il n’a jamais été trop tard, Stock, 2025
Lola Lafon, Il n’a jamais été trop tard, Stock, 2025
C’est une série de chroniques mensuelles publiées entre fin 2023 et fin 2024 dans Libération, augmentées de plusieurs « P.-S. » prolongeant la réflexion. « Ces notes sont une matière, des couleurs et des textures, des humeurs disparates, un puzzle qui ne révèle aucun paysage connu. À quoi servent-elles, ces notes ? À rien de précis, les mots ne « servent » pas, ils ne sont pas à notre service. Ils se prêtent à nos tentatives. » Modestie de bon aloi, modestie véritable, excessive peut-être. Car ce « rien de précis » permet tout de même à l’esprit du lecteur d’élargir l’horizon de sa réflexion sur des sujets divers.
Il peut s’agir de l’amateurisme, qui « est ce que nous pratiquons le mieux, en toutes choses », car être amateur, c’est aimer ; cela à propos par exemple de la « pratique amateure de la maternité », occupation à plein temps. Ou encore de la « course à la haine » venant de l’extrême-gauche et de l’extrême-droite, alors qu’il faudrait pratiquer la « bienveillance pour ses semblables » et cultiver la perplexité plutôt que la certitude. Ou de l’évocation de la famille paternelle de l’autrice, « exterminée pendant la Shoah », résurgence et perte de la mémoire liées. Et aussi, dans l’actualité proche, du « procès de Mazan » et de ce que cette affaire révèle de terrifiant : « Si tous les hommes ne sont pas des violeurs, les violeurs peuvent apparemment être n’importe quel homme. »
Et de beaucoup de choses encore, révoltes ou doutes, incompréhensions ou lucides constatations, aberrations de notre civilisation ou confiance en l’humain… Et comme un rappel de la qualité d’écrivaine de Lola Lafon, le rôle joué par les mots, leur puissance qui est mise à mal lorsqu’ils sont transformés en instruments de pouvoir (« Les mots se dressent face à nous. Ils ne parlent plus, ils communiquent, ordonnent, réduits à menacer, à sanctionner un doigt d’honneur, une poêle à frire ou du sérum physiologique dans un sac à main. ») ou d’invectives (« Les mots seront sommés de décliner leur identité : de quel côté penchent-ils ? On sera renvoyée à son origine, à sa condition. Hashtag juive. Hashtag femme. Hashtag trop de gauche. Hashtag pas assez. »). Malgré tout, c’est eux, les mots, qui permettent de décliner toutes les nuances de la pensée, qui permettent de vagabonder dans l’imaginaire, de raconter « l’histoire en cours », celle qui fait avancer le monde. C’est tout cela que ce beau livre nous révèle.
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, chroniques, francophone, lola lafon, stock, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/06/2025
Finalement on s’y retrouve, délicieusement
 François Salmon, Merci pour la tendresse, Asmodée Edern, 2024
François Salmon, Merci pour la tendresse, Asmodée Edern, 2024
Au bout de quelques pages, les questions commencent à fuser dans l’esprit du lecteur : que peuvent avoir à faire ensemble Érik Satie (qui a vraiment existé, comme on le sait) et une certaine Minique Brouillard (personnage de fiction, comme on s’en doute), une chanson d’Anne Sylvestre (belle et connue) et les histoires (belles et méconnues) qu’un certain Martin Laroche raconte à sa petite-fille Jeanne, la foudroyante apparition de Suzanne Valadon dans la vie de Satie et la disparition de l’étrange Sylwia, épouse de Lambert Laroche et mère de Jeanne, une épaisse et mystérieuse enveloppe que Minique reçoit dans sa boîte aux lettres et la piscine de Tournai…? Arrêtons ici l’énumération, car le futur lecteur risque de se dire que voilà un livre bien embrouillé, d’autant que l’auteur en personne n’hésite pas à relever la sauce en glissant son grain de sel parmi les ingrédients romanesques.
Arrêtons donc l’énumération, pour simplement dire que cet apparent désordre (comparable à celui que le grand-père de Jeanne entretient dans son appartement) procure une délicieuse lecture exploratoire, dans une alternance de faits avérés et d’événements inventés, de personnes réelles et de personnages fictifs, de lieux identifiés et de pays imaginaires. On apprend à connaître presque intimement Érik Satie dans sa relation brève mais passionnée avec Suzanne Valadon, musique et peinture en fusion ; par ailleurs on suit les tribulations de la famille Lambert et de Minique Brouillard, infirmière dévouée mais bien seule dans la vie, qui ne laisse pas de nous intéresser et de faire notre admiration ; et on se laisse entraîner dans les belles histoires racontées à Jeanne par son grand-père, puis par celle-là à celui-ci…
Finalement, ce que prévoit l’auteur va se réaliser : « Je l’admets : tout cela doit sembler bordélique. Qu’est-ce que c’est que ces notes sur Satie qui déboulent de nulle part alors que rien n’a encore vraiment commencé ! Et cette enveloppe de papier kraft qui n’en finit pas de ne pas tomber ! […] Je fais de mon mieux. Je prends les choses comme elles viennent, un peu dans le désordre c’est vrai, mais tout devrait s’organiser plus tard. Enfin, c’est l’idée… » Effectivement tout s’organise dans un roman malicieux, didactique, plein de péripéties, de personnages attachants, de musique, de drames, de sourires, d’humour et, comme l’annoncent le titre ainsi que, rythmant le récit, la chanson Les gens qui doutent, de tendresse.
Jean-Pierre Longre
22:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, belgique, françois salmon, asmodée edern, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/06/2025
Un voyage insolite et nécessaire
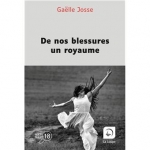 Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet-Chastel, 2025
Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet-Chastel, 2025
Après la dernière représentation, Agnès a décidé de « s’effacer », de quitter ses danseurs qu’elle a menés jusqu’au succès public, ses danseurs qu’elle appelle « mes estropiés, mes esquintés magnifiques, mes abîmés ». Elle qui a perdu Guillaume, son grand amour emporté par la maladie, elle part sur les traces des itinéraires qu’ils ont suivis ou voulu suivre ensemble, des villes visitées ou espérées. De Nice à Milan, de Milan à Trieste, de Trieste à Zagreb, un périple au gré des transports en bus et des hébergements hasardeux, avec « l’essentiel » dans son sac, le Livre : « En dépit de ses quelques centaines de grammes, à peine, il est lourd à porter. Trop lourd. Je le connais par cœur, page après page, il fait partie de moi, que je le veuille ou non. »
Car ce livre, le dernier que Guillaume a lu et s’est fait lire par Agnès, elle voudrait en faire une ultime preuve d’amour en le déposant dans un lieu dédié qui se trouve à Zagreb. Intitulé Quelques Éden, lettres à ma fille, ce vrai-faux roman est composé des lettres que Julien Lancelle adresse à sa fille Emma, née « différente », et qui ne connaît le bonheur que dehors, devant les fleurs et les arbres. Alors le récit qu’Agnès fait de son voyage et de ses souvenirs alterne avec les pages pleines d’amour et de délicatesse du père d’Emma.
Ne nous méprenons pas : ce double roman est entièrement de Gaëlle Josse, qui sait comme personne saisir en mots mûrement choisis et en phrases soigneusement composées les méandres de la sensibilité, la légèreté des instants heureux et le poids des moments désespérés. Sa narration s’adresse autant à Agnès et à son amour disparu qu’à la jeune Emma. Les mouvements de sa prose suivent de près ceux des corps et des cœurs fragiles, leur redonnent le goût de vivre, et il n’est pas indifférent que sa protagoniste-narratrice soit elle-même danseuse. En témoigne l’ultime scène, aussi fascinante pour les lecteurs que pour les passants qui y assistent, une scène tout en mouvements, en rythmes et en sonorités : « Elle danse les larmes et les caresses, les nuits d’insomnie et les jours heureux, elle a dansé les printemps qui reviennent, les nuages qui filent, les neiges dans le cœur des femmes et des hommes, elle danse la terre martyrisée et les cœurs épuisés, elle danse l’espérance et la chute, les voix qui se sont tues et celles qui vont chanter, elle danse ce qu’elle attend et qu’elle ignore. » Un roman ? Certes. Mais aussi un hymne à l’amour, à l’art, aux livres, à la danse… Comme un long poème à l’insolite beauté.
Jean-Pierre Longre
23:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, buchet-chastel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/06/2025
Mère coupable ?
Lire, relire... Laura Kasischke, Esprit d’hiver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet, Christian Bourgois éditeur, 2013, Le Livre de Poche, 2014, Folio, 2025
 Laura Kasischke enseigne l’art du roman, et cela se voit. Elle maîtrise à la perfection les techniques de la narration, les méthodes de construction d’une intrigue, en tenant compte des exigences du genre et en composant avec les contraintes qu’elle s’impose à elle-même.
Laura Kasischke enseigne l’art du roman, et cela se voit. Elle maîtrise à la perfection les techniques de la narration, les méthodes de construction d’une intrigue, en tenant compte des exigences du genre et en composant avec les contraintes qu’elle s’impose à elle-même.
Esprit d’hiver est un huis clos à suspense psychologique respectant les règles non seulement du roman, mais aussi de la tragédie classique : unité de temps (un seul jour, et pas n’importe lequel : celui de Noël) ; unité de lieu (l’intérieur chaleureux de la maison familiale, alors qu’au dehors sévit une tempête de neige) ; unité d’action (la dégradation des relations entre une mère aimante, Holly, et sa fille adoptive, Tatiana). Avec cela, 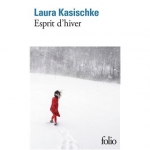 comme au théâtre, des échappées hors scène, dans le temps et dans l’espace, sous la forme d’images entêtantes : l’orphelinat de Sibérie où Holly et son mari Eric sont allés chercher leur petite fille, treize ans auparavant ; la ville et ses alentours, où la circulation est devenue périlleuse à cause du blizzard, et d’autres circonstances mystérieuses et déstabilisantes.
comme au théâtre, des échappées hors scène, dans le temps et dans l’espace, sous la forme d’images entêtantes : l’orphelinat de Sibérie où Holly et son mari Eric sont allés chercher leur petite fille, treize ans auparavant ; la ville et ses alentours, où la circulation est devenue périlleuse à cause du blizzard, et d’autres circonstances mystérieuses et déstabilisantes.
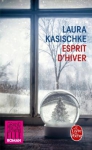 Après une longue phase introductive où, comme pour rassurer tout le monde, se bousculent les clichés américains traditionnels (préparation d’une belle fête de Noël avec famille et amis – désirés ou non –, maison accueillante et foyer aimant), et où seules quelques allusions, s’insinuant comme par hasard, annoncent insensiblement la suite (maladies congénitales et stérilité, ainsi qu’un refrain qui trotte dans l’esprit maternel : « Quelque chose les aurait suivis depuis la Russie jusque chez eux ? »), l’angoisse éclate, au sens quasiment littéral du verbe, en des scènes et des réminiscences dont les liens laissent peu à peu percer la vérité, cette vérité qui était restée enfouie au plus profond de l’esprit de Holly, et dont le lecteur prend conscience en même temps que le personnage. Glaçant.
Après une longue phase introductive où, comme pour rassurer tout le monde, se bousculent les clichés américains traditionnels (préparation d’une belle fête de Noël avec famille et amis – désirés ou non –, maison accueillante et foyer aimant), et où seules quelques allusions, s’insinuant comme par hasard, annoncent insensiblement la suite (maladies congénitales et stérilité, ainsi qu’un refrain qui trotte dans l’esprit maternel : « Quelque chose les aurait suivis depuis la Russie jusque chez eux ? »), l’angoisse éclate, au sens quasiment littéral du verbe, en des scènes et des réminiscences dont les liens laissent peu à peu percer la vérité, cette vérité qui était restée enfouie au plus profond de l’esprit de Holly, et dont le lecteur prend conscience en même temps que le personnage. Glaçant.
Jean-Pierre Longre
www.christianbourgois-editeur.com
11:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, laura kasischke, aurélie tronchet, christian bourgois éditeur, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/06/2025
Mais que savons-nous des « coutumes de la Terre » ?
 Ilarie Voronca, Souvenirs de la planète Terre, préface de Nicolas Cavaillès, Arfuyen, 2025
Ilarie Voronca, Souvenirs de la planète Terre, préface de Nicolas Cavaillès, Arfuyen, 2025
Né Eduard Marcus à Brăila, Ilarie Voronca (1903-1946) fait partie de ces artistes d’avant-garde qui, venus de Roumanie, ont enrichi la culture française de leur inventivité intellectuelle et esthétique, de leurs idées et de leurs œuvres ; on connaît sans doute mieux Tzara ou Fondane, mais Voronca a nourri la littérature d’une particulière modernité, et Souvenirs de la planète Terre, sorte de « testament littéraire » de l’inventeur de l’ « intégralisme », en témoigne singulièrement. Avec cet ouvrage, l’écrivain « offre une expérience littéraire unique, un dépassement des plus sombres constats dans une fausse naïveté conceptuelle et hallucinée qui à chaque page apporte de nouvelles formules merveilleuses », écrit Nicolas Cavaillès.
Le protagoniste du roman, Yves (un prénom manifestement issu des initiales de l’auteur), se voit comme « un voyageur venu d’une planète ou de quelque univers inconnu » et découvre notre monde en une vision qui rebat fondamentalement les cartes : les végétaux plus puissants que les hommes, ou ceux-ci aux ordres des animaux, qui, comme les ânes, sont capables de discuter poésie entre eux ; ou encore les machines (par exemple les moissonneuses-batteuses) à l’origine de la création de l’homme (y compris de son âme)… Yves, peu à peu, fait des découvertes étonnantes et angoissantes sur le monde et la société, sur l’injustice qui fixe les « hommes-vis » à des places dont ils ne peuvent s’extirper, sur l’absurdité de l’existence, sur la vanité humaine (« Tout cela est à démolir », semble-t-il en conclure) ; mais tout n’est pas perdu : « La machine bonne et affable se tiendra aux côtés de l’homme. Elle fera un avec l’homme. Et Yves eut la vision d’un nouveau centaure, d’une nouvelle mythologie. L’homme accouplé à la machine. » Vision en tout cas moins pessimiste qu’une prophétie précédente, pourtant vérifiée : « Ce sont les nouvelles machines qui poussent jusqu’à la dernière limite l’esclavage de l’homme et n’hésitent devant aucun obstacle pour satisfaire leurs caprices. »
Ce qui précède n’est qu’un des angles de lecture possibles. Écrivain de l’absurde, Ilarie Voronca se situe dans lignée de Lautréamont, Urmuz, Raymond Roussel et quelques autres inventeurs de l’absolu. Poète, aussi, et ce roman en porte la marque. Quelques exemples ? À propos des plantes : « Ô pacifiques reines, régnant sur la vie et sur la mort et dont les seules armes sont vos parfums et vos couleurs ! » ; à propos des batteuses : « Ce sont de grands oiseaux migrateurs qui font leur nid pendant les mois de soleil parmi les céréales » ; à propos de la nuit urbaine : « Oh, calme majesté des avenues sous la lune ! Jardins baignés d’une musique qui se déverse d’entre les cordes des arbres dont chacun porte une étoile comme une sourdine. » Et ce bel alexandrin concluant l’un des poèmes insérés dans la prose : « Mes os seront pareils aux herbes arrachées. » Absurde et poésie font aussi bon ménage avec un humour cachant plus ou moins bien l’angoisse, comme dans cette maxime : « Les hommes ne sont des hommes que parce qu’ils croient être des hommes. », ou dans la découverte d’une cruelle anthropophagie : « Yves s’aperçut que les maisons mangeaient. […] Plus elles étaient vieilles, plus elles tombaient en ruines, plus il leur fallait d’hommes, de femmes et d’enfants à mastiquer. »
Souvenirs de la planète Terre est une livre « intégral » où, par le truchement de la limpidité de la prose et du vertige de la poésie, se mêlent l’espoir et le désespoir, l’humour et la soif d’absolu, le mysticisme et la satire, la générosité et la dérision. La formule de Nicolas Cavaillès est parlante : Ilarie Voronca est un « Voyant inquiet », et c’est sans doute l’inquiétude qui l’a emporté.
Jean-Pierre Longre
18:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, ilarie voronca, nicolas cavaillès, arfuyen, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/05/2025
JDD l’ « agent double »
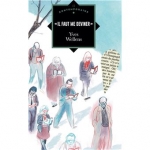 Yves Wellens, « Il faut me deviner », Asmodée Edern, 2025
Yves Wellens, « Il faut me deviner », Asmodée Edern, 2025
Jacques De Decker était dramaturge et romancier, librettiste et traducteur, mais aussi critique littéraire, biographe et professeur. Donc, comme Yves Wellens le résume, écrivain et « passeur », selon une « double démarche », d’où la qualification d’ « agent double » que ce moteur de la vie littéraire belge s’appliquait à lui-même. Et c’est peut-être ce qui a incité le même Yves Wellens à écrire non une biographie au sens traditionnel du terme, mais un « roman biographié », voire une « fantaisie » sur un personnage qu’il avait assez bien connu, en lançant aux lecteurs une injonction reprenant les mots mêmes de ce personnage : « Il faut me deviner. »
Nous avons donc là une sorte d’enquête faisant alterner dix chapitres de récit à la première personne (celle de l’auteur / narrateur) et huit « portraits » à la troisième personne (ceux du personnage). Et dans cette enquête, des énigmes à résoudre, telles ces mentions répétées dans les agendas, notées « Réunion O ; k.- » avec, chaque fois, un mystérieux chiffre correspondant. Nous assistons en outre à l’exploration de la bibliothèque, plus ou moins bien classée, et nous participons aux promenades dans les rues, selon des itinéraires que Wellens, en fin connaisseur de Bruxelles, se plaît à imaginer. Il y a aussi des rêves, qui se déroulent dans des lieux propices à ce genre d’activité mentale : des théâtres… Car JDD avait une activité théâtrale qui l’occupa beaucoup pendant un certain temps : « Et JDD de voler tout naturellement de théâtre en théâtre, comme s’il en dressait une carte d’état-major à l’échelle de la ville : on le sollicite au Théâtre-Poème […], à l’Esprit-Frappeur […], au Théâtre Molière, aux Galeries, au Parc, au Poche, au National, au Théâtre des Martyrs, au Vaudeville, à la Comédie Claude Volter, au Vilar (certes à Louvain-la-Neuve), à la Compagnie Yvan Baudouin dans une salle à Etterbeek, à l’Éveil, au Public, au Palais des Beaux-Arts, c’est-à-dire au Rideau de Bruxelles, alors logé là. » Voilà qui permet de noter au passage combien Bruxelles est une ville théâtrale. Notons aussi, toujours au passage, que JDD, « on ne peut plus belge », avait des « racines linguistiques » flamandes mais écrivait en français (comme Marie Gevers, Jean Ray, Ghelderode et quelques autres).
La méthode judicieusement choisie par Yves Wellens aboutit à un résultat à la fois original (donc d’un intérêt particulier) et esthétique (d’une esthétique littéraire, bien sûr, mais aussi musicale par sa composition, voire visuelle par la magie des « portraits » et de la belle couverture, lecteurs en mouvements et en couleurs, avec le protagoniste récitant et souriant, comme pour nous faire signe – « Zijn knik » en flamand – en résonance avec un épisode du livre). Et troisième conséquence : que l’on ait connu Jacques De Decker ou non auparavant, cette méthode nous le rend familier et nous incite à le lire ou relire, tout en entrant dans le roman de son intimité.
Jean-Pierre Longre
11:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jacques de decker, yves wellens, asmodée edern, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/05/2025
Un festin pour toutes les papilles
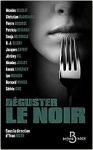 Lire, relire... Déguster le noir, sous la direction d’Yvan Fauth, Belfond, 2023, Harper Collins Poche, 2025
Lire, relire... Déguster le noir, sous la direction d’Yvan Fauth, Belfond, 2023, Harper Collins Poche, 2025
L’avantage d’un recueil de nouvelles, c’est que l’on peut déguster l’une, faire une pause, passer à une autre et ainsi de suite. À la carte, pour ainsi dire. Et ici, « déguster » et « faire une pause » sont véritablement de mise : prendre plaisir à la lecture, un plaisir quasiment physique, et prendre le temps de la digestion entre deux textes. Car certains de ceux-ci n’y vont pas avec le dos de la cuiller pour les épices persistantes, les sauces fortement relevées, les viandes bien saignantes, les saveurs étourdissantes…
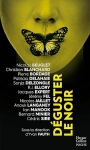 Les treize auteurs choisis par Yvan Fauth, le maître-queux, ont des recettes bien particulières, légères ou copieuses, pour combler les convives. Il y a là des personnages de toutes sortes, perspicaces ou naïfs, des goûteurs conscients des risques qu’ils courent, des cuisiniers originaux, voire bizarres, des criminels endurcis, des victimes, des monstres… Et autour du thème commun de la nourriture, une grande variété de sujets et de registres : boulimie ou anorexie, agueusie ou pléthore gustative, franche horreur ou humour noir, délicatesse ou cannibalisme, fantastique ou réalisme… Avec, en apothéose, un terrible dessert servi avec brio par R.J. Ellory. Après Écouter le noir, Regarder le noir, Toucher le noir, Respirer le noir, Déguster le noir est un festin composé de treize plats qui contentera des papilles délicates et robustes, intrépides et persévérantes, néophytes ou endurcies.
Les treize auteurs choisis par Yvan Fauth, le maître-queux, ont des recettes bien particulières, légères ou copieuses, pour combler les convives. Il y a là des personnages de toutes sortes, perspicaces ou naïfs, des goûteurs conscients des risques qu’ils courent, des cuisiniers originaux, voire bizarres, des criminels endurcis, des victimes, des monstres… Et autour du thème commun de la nourriture, une grande variété de sujets et de registres : boulimie ou anorexie, agueusie ou pléthore gustative, franche horreur ou humour noir, délicatesse ou cannibalisme, fantastique ou réalisme… Avec, en apothéose, un terrible dessert servi avec brio par R.J. Ellory. Après Écouter le noir, Regarder le noir, Toucher le noir, Respirer le noir, Déguster le noir est un festin composé de treize plats qui contentera des papilles délicates et robustes, intrépides et persévérantes, néophytes ou endurcies.
Les auteurs : Nicolas Beuglet, Christian Blanchard, Pierre Bordage, Patricia Delahaie, Sonja Delzongle, R. J. Ellory (traduit par Fabrice Pointeau), Jacques Expert, Jérémy Fel, Nicolas Jaillet, Anouk Langaney, Ian Manook, Bernard Minier, Cédric Sire.
Jean-Pierre Longre
17:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, anglophone, yvan fauth, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/04/2025
"Le maillon rompu"
 Lire, relire... Lionel Duroy, Le chagrin, Julliard, 2010. Rééd. J'ai lu, 2011. Nouvelle réédition, J'ai lu, 2025
Lire, relire... Lionel Duroy, Le chagrin, Julliard, 2010. Rééd. J'ai lu, 2011. Nouvelle réédition, J'ai lu, 2025
Pour Michel Leiris publiant L’âge d’homme, l’ombre de la « corne de taureau » qui guette le torero représente le danger qu’encourt l’autobiographe lorsqu’il se donne pour règle de dire « la vérité, rien que la vérité ». L’écriture est alors un « acte » qui pèse lourdement sur les relations de l’auteur avec son entourage, et donc sur le destin de cet auteur. Là s’arrête l’analogie entre l’ouvrage de Leiris et celui de Lionel Duroy : la construction, le style, l’intention même sont différents. Mais dans les deux cas, l’expression la plus fidèle, la plus sincère possible des souvenirs est un risque délibérément encouru, voulu par la nécessité de la libération personnelle.
De 1944 au début des années 2000, des origines parentales à la création d’une nouvelle famille, les souvenirs de William Dunoyer de Pranassac (alias Lionel Duroy) se succèdent au rythme de ce qui a marqué, voire bouleversé son existence, à commencer par les traumatismes de l’enfance, entre un père en permanente cessation de paiement, une mère dont les rêves mondains déçus provoquent chez elle des dépressions périodiques et une ribambelle de frères et sœurs élevés au gré des circonstances. Une enfance chaotique, marquée par les disputes des parents, une scolarité lacunaire, des bonheurs fugitifs sans lendemains. Puis viennent les voyages, les amours, les ratages, la paternité, le journalisme, l’écriture…
 Cette écriture, qui n’est pas simplement narration – histoire de raconter sa vie pour se satisfaire et satisfaire la curiosité des lecteurs – retrace une évolution personnelle qui, certes, ne manque pas d’intérêt : des complexes enfantins à une certaine assurance, de l’extrême droite familiale à la gauche bon teint, de la soumission à la révolte. Il y a aussi la quête minutieuse du vrai, les documents et les photos palliant les défaillances de la mémoire, le doute et les questions, loin d’être occultés, se faisant même moteur de la recherche. Mais l’écriture est au premier chef, et en dernier lieu, le moyen de survivre. Lorsqu’en 1990 paraît Priez pour nous, c’est la rupture avec toute la famille, parents, frères et sœurs, neveux et nièces : l’auteur s’est livré à la « corne de taureau » en allant jusqu’au bout du règlement de comptes avec sa mère, et c’est au prix de cette brouille qu’il peut poursuivre son chemin.
Cette écriture, qui n’est pas simplement narration – histoire de raconter sa vie pour se satisfaire et satisfaire la curiosité des lecteurs – retrace une évolution personnelle qui, certes, ne manque pas d’intérêt : des complexes enfantins à une certaine assurance, de l’extrême droite familiale à la gauche bon teint, de la soumission à la révolte. Il y a aussi la quête minutieuse du vrai, les documents et les photos palliant les défaillances de la mémoire, le doute et les questions, loin d’être occultés, se faisant même moteur de la recherche. Mais l’écriture est au premier chef, et en dernier lieu, le moyen de survivre. Lorsqu’en 1990 paraît Priez pour nous, c’est la rupture avec toute la famille, parents, frères et sœurs, neveux et nièces : l’auteur s’est livré à la « corne de taureau » en allant jusqu’au bout du règlement de comptes avec sa mère, et c’est au prix de cette brouille qu’il peut poursuivre son chemin.
Le chagrin est en quelque sorte le roman d’un regard sur soi, le roman d’une autobiographie sans concessions : Lionel Duroy raconte comment il en est arrivé à composer une œuvre de révolte, comment il est devenu « le maillon rompu, celui sur lequel s’est cassée la chaîne ». Récit violent et tendre à la fois, plein d’une émotion à peine bridée par l’écriture.
Jean-Pierre Longre
www.jailu.com
http://jplongre.hautetfort.com/tag/lionel+duroy
17:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, lionel duroy, julliard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/04/2025
« Mettre des mots sur le vertige »
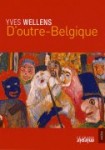 Yves Wellens, D’outre-Belgique, Le Grand Miroir (Groupe Luc Pire), Bruxelles, 2007, édition revue et augmentée, Edern éditions, 2024
Yves Wellens, D’outre-Belgique, Le Grand Miroir (Groupe Luc Pire), Bruxelles, 2007, édition revue et augmentée, Edern éditions, 2024
À pas mesurés, Yves Wellens traverse les zones frontalières de l’actualité immédiate, les banlieues des cités humaines pleines de mystères et d’évidences.
Dans son dernier ouvrage, on reconnaît le style, la manière et parfois la matière de livres précédents : Le cas de figure (Didier Devillez, 1995, réédition Espace Nord, 2014), Contes des jours d’imagination (Didier Devillez, 1996), Incisions locales (Luce Wilquin, 2002), Zones classées (Ker éditions, 2018) : récits plus ou moins brefs, plus ou moins autonomes, unité thématique de chaque volume, ton volontairement impersonnel et détaché permettant d’aller le plus loin possible dans l’exploration des situations, des faits, des esprits. Il y a bien une « écriture » propre à Yves Wellens, une écriture dont la musique, à la fois discrète et implacable, résonne longtemps dans la tête du lecteur.
 D’outre-Belgique rassemble plusieurs récits dont le « motif littéraire » commun, d’une actualité brûlante, est la fin de la Belgique, envisagée sous des angles divers. La coloration de ces récits est tantôt politique (par exemple les dangers de l’extrême droite), tantôt artistique (picturale ou photographique), tantôt humaine (des personnages représentatifs, au sens quasiment physique, de l’état, voire de l’histoire et de la géographie du pays)… Mais toujours, et comme toujours avec Yves Wellens, c’est la littérature qui prime. Il est d’ailleurs remarquable de voir combien la littérature est capable d’anticiper le réel, dans ses aspects les plus cruciaux : rédigé en 2005, renouvelé en 2014, le livre s’appuie sur une situation qui se développe constamment…
D’outre-Belgique rassemble plusieurs récits dont le « motif littéraire » commun, d’une actualité brûlante, est la fin de la Belgique, envisagée sous des angles divers. La coloration de ces récits est tantôt politique (par exemple les dangers de l’extrême droite), tantôt artistique (picturale ou photographique), tantôt humaine (des personnages représentatifs, au sens quasiment physique, de l’état, voire de l’histoire et de la géographie du pays)… Mais toujours, et comme toujours avec Yves Wellens, c’est la littérature qui prime. Il est d’ailleurs remarquable de voir combien la littérature est capable d’anticiper le réel, dans ses aspects les plus cruciaux : rédigé en 2005, renouvelé en 2014, le livre s’appuie sur une situation qui se développe constamment…
En vérité, et c’est peut-être là l’une des explications, les éléments circonstanciels ne sont que des moyens d’accéder à la construction esthétique. Simplement, dans ce quatrième livre, l’auteur paraît jouer davantage avec le réel référentiel, aussi dramatique soit-il. Lui-même (l’auteur) s’y dévoile sous sa propre identité ; Bruxelles et la Belgique y sont présents en tant que tels, avec leur passé, leur présent et leur avenir improbable ; et le lecteur y est profondément sollicité dans ses opinions et ses convictions. C’est bien ici la subtilité du livre : combiner le réel et le fictif, le politique et le poétique, en une constante dualité qui, finalement, assure l’unité de l’ensemble. L’incertitude vertigineuse du devenir de la Belgique sous-tend les variations de l’écriture. « Mettre des mots sur le vertige », tel est l’axe central du recueil, le point de convergence des huit textes. Le dernier récit, relatant la déambulation urbaine d’un groupe d’amis liés par la jeunesse et par la mort, en est la synthèse, le sommet, l’ouverture, le point de suspension…
Jean-Pierre Longre
18:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, belgique, yves wellens, le grand miroir (groupe luc pire) | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/03/2025
Face à la bestialité
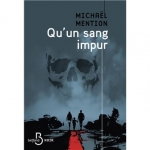 Michaël Mention, Qu’un sang impur, Belfond, 2025
Michaël Mention, Qu’un sang impur, Belfond, 2025
Dans un petit immeuble de banlieue, vivent en bons termes quelques personnes assez représentatives de la société actuelle : un couple genre bobo écolo avec un petit garçon de 4 ans ; une étudiante qu’on ne verra pas ; un écrivain célibataire plutôt de droite ; deux octogénaires, lui aux petits soins pour sa femme atteinte de la maladie d’Alzheimer ; un couple de musulmans avec leurs deux enfants de 5 à 7 ans ; une retraitée assidue à Internet, limite complotiste. Nous sommes visiblement dans un avenir proche, dans une société marquée par les caractéristiques que l’on connaît ou que l’on a connues (Covid, dérèglement climatique, attentats, guerres en Ukraine et ailleurs, injustices sociales…). Dès le début du récit nous suivons Matt sortant de la banque où il travaille et s’apprêtant à rejoindre sa femme et son fils dans le loft qu’ils occupent au troisième étage de l’immeuble, lorsqu’il est soudain témoin comme tout le monde d’une catastrophe inattendue provoquant la plus affolante des paniques.
C’est l’horreur qui survient, d’une violence inouïe : des individus normaux les secondes précédentes deviennent tout à coup des monstres inhumains aux forces décuplées s’attaquant à leurs semblables pour les déchiqueter et les dévorer. Un virus libérant « l’hormone de l’agressivité » ? Une réaction à l’hostilité du monde ? Les « communicants », comme d’habitude, vont de disputer et palabrer, les gouvernants faire des recommandations et tenter de rassurer, la police réprimer et se faire déborder, jusqu’à ce que l’on trouve la cause planétaire de cette fureur anthropophagique. En attendant, les occupants du petit immeuble, confinés, calfeutrés comme tout un chacun, tentent désespérément de faire face aux attaques de bandes cannibales, au manque de nourriture, à la canicule accentuée par l’enfermement, aux questions des enfants, aux variations d’humeur et aux rivalités entrainées par une cohabitation forcée, et n’échappent pas aux conséquences mortelles du fléau.
Dans un style tour à tour percutant et sensible, coloré de satire politico-sociale, avec un remarquable sens de la formule, Michaël Mention a l’art de passer, en résonance et en un instant, de la fresque aux larges dimensions à la description microcosmique. Par exemple : « Ce matin plus qu’hier, ça sent la fin. Endeuillée, terrifiée, sclérosée d’affrontements entre immunisés, la vieille Europe semble vivre ses derniers jours. De la BBC à la Rai en passant par BFM, les spécialistes sont formels : la guerre civile n’est pas loin, et la fin de la civilisation non plus. Survivalistes, néonazis, islamistes, anarchistes… les plus radicaux se tiennent prêts, le chaos dans les crocs. » Même page, quelques lignes plus loin : « Chantal, Yazid et Clem, mutiques dans la cuisine. Écœuré, l’ami du petit déjeuner. Tous nauséeux, à l’idée d’être confrontés les uns aux autres aujourd’hui encore, ils se renvoient en silence leur responsabilité respective dans la mort de Joël. Elle est loin la Fête des voisins. » L’art, aussi, de montrer comment se mêlent, dans la nature humaine, l’incroyable fureur et l’émotion bienveillante, l’égoïsme et l’altruisme, la peur et la lucidité, la lâcheté et le courage. Au-delà de la dimension romanesque, voilà le fond signifiant de la dystopie : une métaphore de la violence des rapports humains. « L’homme est un loup pour l’homme », affirmait Thomas Hobbes au XVIIe siècle. Le XXIe n’échappe pas à cette affirmation, et Michaël Mention en fait une haletante démonstration.
Jean-Pierre Longre
Michaël Mention sera présent au festival « Quais du polar » du 4 au 6 avril 2025. Voir https://quaisdupolar.com/programme-2025/
10:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, michaël mention, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/03/2025
Les risques de la franglophonie
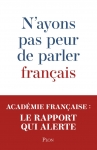 Académie française, N’ayons pas peur de parler français, « Le rapport qui alerte », Plon, 2024
Académie française, N’ayons pas peur de parler français, « Le rapport qui alerte », Plon, 2024
Ce livre bref mais dense veut donner l’alerte face « à la violence d’un phénomène », celui de l’extension « vertigineuse » de « l’utilisation non seulement abusive, mais invasive de termes anglo-américains. » C’est ce qu’écrit Dominique Bona dans la préface, tout en admettant que la langue française « n’a jamais cessé d’évoluer » grâce aux apports d’autres langues. Il s’agit donc, dans ce « rapport », de montrer en quoi la langue française subit « une évolution préoccupante » : « Jusqu’au XXe siècle, l’implantation de vocables étrangers se faisait à travers un processus d’assimilation, de francisation progressive. Actuellement, au contraire, l’entrée quasi immédiate dans la vie publique de mots anglais ou supposés tels, via les moyens de diffusion de masse, sans adaptation aux caractéristiques morphologiques et syntaxiques du français, conduit à une saturation. »
Les exemples ne manquent pas, dans les domaines publics et privés. Ce qui est préoccupant, ce n’est pas que certains mots ou certaines tournures venus du monde anglo-américain s’intègrent dans le français, mais que ces mots ou tournures soient incompréhensibles pour le commun des mortels (« la climatisation bi-split », « OpenClassrooms MOOC », le « crowdsourcing affluence voyageurs » etc.) ; et aussi que l’arrivée de nombreux termes soient injustifiée parce qu’ils existent déjà. « Exemples : concorder, correspondre/matcher ; déployer, répartir/dispatcher ; emballage/packaging ; faux, forgé, mensonge/fake ; foyer/cluster ; mélange/mix ; message/post ; mettre en place, processus/process ; réaliser/implémenter ; réseau/network ; sûr, sécurisé/secure. »
On ne reprendra pas ici les nombreux exemples donnés au fil des pages, une liste qui pourrait s’allonger de jour en jour, par un phénomène expansif de mode, de snobisme (pour utiliser un mot d’origine anglaise mais bien ancré dans le français), ainsi que dans une perspective d'élitisme technocratique, excluant de fait celles et ceux qui n'ont pas accès à ce type de lexique; le langage comme facteur d'exclusion, ce n'est pas nouveau, mais en l'occurrence cela s'avère de façon cruciale. L’ouvrage se clôt sur quelques préconisations destinées à aller « vers une communication claire et efficace ». Sans « s’opposer à l’évolution du français, à son enrichissement au contact d’autres idiomes », les académiciens proposent un triple but à atteindre : « Tenir compte du public dans son ensemble, contribuer au maintien du français et lui permettre de participer à une mondialisation réussie. » Espérons…
Jean-Pierre Longre
Pour donner suite…
Si l’on veut profiter d’une vraie relation harmonieuse entre les langues anglaise et française, rien ne vaut la lecture de belles traductions et de publications bilingues. Voir : https://www.blackheraldpress.com
Et voici quelques rappels
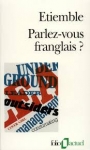 Il y a plus de 60 ans : Étiemble, Parlez-vous franglais ? Première parution en 1964. Nouvelle édition sous-titrée Fol en France Mad in France - La Belle France Label France et augmentée d'un avant-propos de l'auteur en 1991, Folio, 1991
Il y a plus de 60 ans : Étiemble, Parlez-vous franglais ? Première parution en 1964. Nouvelle édition sous-titrée Fol en France Mad in France - La Belle France Label France et augmentée d'un avant-propos de l'auteur en 1991, Folio, 1991
Présentation :
Les Français passent pour cocardiers ; je ne les crois pas indignes de leur légende. Comment alors se fait-il qu'en moins de vingt ans (1945-1963) ils aient saboté avec entêtement et soient aujourd'hui sur le point de ruiner ce qui reste leur meilleur titre à la prétention qu'ils affichent : le français. Hier encore langue universelle de l'homme blanc cultivé, le français de nos concitoyens n'est plus qu'un sabir, honteux de son illustre passé. Pourquoi parlons-nous franglais ? Tout le monde est coupable : la presse et les Marie-Chantal, la radio et l'armée, le gouvernement et la publicité, la grande politique et les intérêts les plus vils. Pouvons-nous guérir de cette épidémie ? Si le ridicule tuait encore, je dirais oui. Mais il faudra d'autres recours, d'autres secours. Faute de quoi, nos cocardiers auront belle mine : mine de coquardiers, l'œil au beurre noir, tuméfiés, groggy, comme disent nos franglaisants, K.O. Alors, moi, je refuse de dire O.K.
Étiemble
 En contrepoint (et contrepied) : Bernard Cerquiglini, La langue anglaise n'existe pas. C'est du français mal prononcé, Folio, 2024
En contrepoint (et contrepied) : Bernard Cerquiglini, La langue anglaise n'existe pas. C'est du français mal prononcé, Folio, 2024
Présentation :
Langue officielle et commune de l’Angleterre médiévale durant plusieurs siècles, le français a pourvu l’anglais d’un vocabulaire immense et surtout crucial. Traversant la Manche avec Guillaume le Conquérant, il lui a offert le lexique de sa modernité. C’est grâce aux mots français du commerce et du droit, de la culture et de la pensée que l’anglais, cette langue insulaire, est devenu un idiome international. Les « anglicismes » que notre langue emprunte en témoignent. De challenge à vintage, de rave à glamour, après patch, tennis ou standard, de vieux mots français, qui ont équipé l’anglais, reviennent dans un emploi nouveau ; il serait de mise de se les réapproprier, pour le moins en les prononçant à la française. Avec érudition et humour, Bernard Cerquiglini inscrit la langue anglaise au patrimoine universel de la francophonie.
Un article ancien : Jean-Pierre Longre, « Franglophones, encore un effort ! », Revue Lettre(s) (Asselaf) n° 43, décembre 2006 - janvier 2007 p. 14-16.
La défense de la langue française passe par son illustration ; le programme ne date pas d’aujourd’hui, et ce que Du Bellay accomplit en son temps, nous pouvons et devons le perpétuer. La richesse, la diversité et l’expressivité du français, admettons-le, sont dues au moins en partie à sa perméabilité aux langues étrangères, et singulièrement à l’anglais – cela non plus ne date pas d’aujourd’hui.
Rappelons-nous que si le français vient globalement du latin (du latin populaire, lui-même bien mêlé), une forte minorité de mots sont d’origine germanique, italienne, arabe, anglaise… De la langue anglaise viennent des termes aussi courants que (au hasard et dans le désordre) chèque, vitamine, autocar, bébé, firme, bifteck, sinécure, station service, bol, paquebot, visualiser, redingote, snob… Et n’oublions pas les va-et-vient entre les deux langues, dont certains sont bien connus : tunnel (qui, venant des tonneau / tonnelle français, est passé par l’anglais pour revenir au français) ; tennis (mot anglais issu de l’impératif français tenez) ; ajourner (de l’anglais d’origine française to adjourn) ; rosbif (de bœuf rôti – rosté en ancien français) ; flirter (flirt venant de fleurette, celle que l’on conte) ; management (issu de l’ancien français), et, évidemment, e-mail (mail venant de la malle-poste)…
Laissons de côté ces aspects historiques, que les connaisseurs complèteront aisément et abondamment, pour reconnaître que les écrivains contribuent à un enrichissement, à une diversification que la notion moderne de francophonie ne peut que confirmer et renforcer. Peut-on encore défendre la langue française ? N’en doutons pas. Mais cela ne se fera pas en piquant des colères aussi néfastes (pour la santé) que vaines (pour ladite défense) contre les méchants Anglo-Américains qui veulent nous imposer leur loi, ou contre les vilains Franco-Francophones qui dépassent les normes strictes de l’idiome académique. Chacun sachant que de nos jours la vie des pays anciens ne peut se passer de la vigueur de l’immigration, intéressons-nous au concept de « naturalisation » ou de « francisation » des mots anglais, que Baudelaire ne s’est même pas donné la peine de mettre en pratique, tant le « spleen » doit correspondre tel quel à un état d’esprit international. N’y cédons pas, et considérons l’inventivité, par exemple, d’un Marcel Aymé qui n’a pas hésité à intituler un de ses romans Travelingue, ou d’un Raymond Queneau qui, en éminent angliciste, s’en est donné à cœur joie avec ses coqutèle, ouisqui, bouledoseur, cloune, niqueurzes, bicause, nokaoute, quidnappeurs (ou guidenappeurs), bloudjinnzes, apibeursdè touillou, gueurle, claqueson, coboille, glasse, cornède bif, bâille-naïte… Et ce petit dialogue des Fleurs bleues, n’est-ce pas du français ?
Il y avait un campeur mâle et un campeur femelle.
- Esquiouze euss, dit le campeur mâle, mà wie sind lost.
- Bon début, réplique Cidrolin.
- Capito ? Egarrirtes… lostes.
- Triste sort.
- Campigne ? Lontano ? Euss… smarriti…
- Il cause bien, murmura Cidrolin, mais parle-t-il l’européen vernaculaire ou le néo-babélien ?
Du français international, sans doute, mais compréhensible tout de même, et si pittoresque… Et peut-on résister à la tentation de reproduire ici celui des Exercices de style qui s’intitule « Anglicismes » ?
Un dai vers middai, je tèque le beusse et je sie un jeugne manne avec un grète nèque et un hatte avec une quainnde de lèsse tressés. Soudainement ce jeugne manne bi-queumze crézé et acquiouse un respectable seur de lui trider sur les tosses. Puis il reunna vers un site eunoccupé.
A une lète aoure je le sie égaine ; il vouoquait eupe et daoune devant la Ceinte Lazare stécheunne. Un beau lui guivait un advice à propos de beutone.
Évidemment, ces triturations sont celles d’un écrivain, qui conçoit la langue comme un instrument de créations aussi poétiques que ludiques ; c’est ce que font, moins systématiquement mais tout aussi sérieusement, dans une pure tradition célino-quenienne, des écrivains (parmi un grand nombre) aussi différents que Daniel Pennac et Pierre Autin-Grenier (qui n’hésite pas à envoyer des « émiles » aussi facilement qu’on pourrait envoyer des « himêles » ou des « y-mêle(s) »). Alors, pourquoi ne pas s’inspirer de ces triturations pour « naturaliser », « assimiler », « intégrer » des mots qui, dans ces conditions, ne seraient pas considérés comme des intrus ou des envahisseurs, mais comme des amis venus nous prêter main-forte ? Une immigration maîtrisée, en quelque sorte. Si les Anglo-américains veulent nous envoyer leurs enfants, accueillons-les, adoptons-les, faisons-en de bons petits francophones.
Dans le même ordre d’idées, on peut se référer à Gaston Miron, que l’on ne risque pas de soupçonner de vouloir saboter la langue française. Pour lui, la langue « n’évolue pas par son propre dynamisme interne » ; se plaçant dans la situation du bilinguisme propre au Québec (mais cette situation, tout bien réfléchi, est celle de la plupart des francophones, y compris, par les temps qui courent, des hexagonaux), voici ce qu’il écrivait dans Décoloniser la langue (1972) :
Il serait étonnant que la langue ne subisse pas d’influences déformantes. Mais, dans l’ouvert et le fermé d’une langue, les facteurs de résistance, de rejet, d’assimilation ne sont pas négligeables. Celui qui dit : « Mon dome light est locké » ou « Y a eu un storm hier » ou « Le dispatcher m’a donné ma slip pour aller gaser » parle québécois, la phrase demeure fidèle au système de la langue, on ne constate qu’une insuffisance de vocabulaire qui s’explique sociologiquement. Ce genre de frottement, de contact avec l’autre langue, est assez superficiel. Ça ne va pas plus loin que l’emprunt lexical, souvent l’emprunt est transitoire ou assimilé. Ce qui est plus grave c’est une influence qui crée un type de symbiose subtile et pénétrante, et qui attaque le système syntaxique. Exemples : Ne dépassez pas quand arrêté, Saveur sans aucun doute, Pharmacie à prix coupés. Ce n’est pas, comme certains le prétendent, une langue nouvelle, ça. C’est la communication de l’autre dans nos signes ; la langue de l’autre informe notre langue de ses calques. Les chasseurs d’anglicismes lexicaux ne trouveront pas un traître mot d’anglais là-dedans ; pourtant c’est de l’anglais en français. La communication de notre langue dé-fonctionne là-dedans sous l’effet du code de l’autre. Ça produit du non-sens, ou un sens autre que le sens que ça devrait produire.
Puisque nous parlons tous le franglais (et aussi le frallemand, le fritalien, le frarabe, le frespagnol etc…), évitons de tirer hostilement la langue aux autres (une langue bien chargée, dont la pureté est illusoire) ; nourrissons-la, en revanche, d’apports lexicaux nouveaux, laissons-la respirer au vent des horizons lointains, en faisant en sorte de préserver ses fonctions vitales. C’est à ce prix qu’elle vivra.
https://www.asselaf.fr/numeros/Lettres43.pdf
23:00 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, rapport, article, francophone, académie française, étiemble, bernard cerquiglini, plon, gallimard, folio, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/03/2025
Puissance de la légèreté
 Lire, relire... Patrick Modiano, La danseuse, Gallimard, 2023, Folio, 2025
Lire, relire... Patrick Modiano, La danseuse, Gallimard, 2023, Folio, 2025
Elle est à peu près la seule à ne pas avoir de nom, mais aussi « la seule dont on pourrait retrouver des photos », et dont il reste au narrateur (qui lui non plus n’a pas de nom) des bribes de souvenirs précis, dans un désordre chronologique dont il voudrait reconstituer le puzzle. À côté du personnage de « la danseuse », il y a son fils, le petit Pierre, dont le père a dû disparaître ; il y a Hovine, que le narrateur, alors jeune homme, relaie pour garder Pierre ; il y a Boris Kniaseff, le professeur de danse ; il y a Verzini, qui a rendu bien des services et sait bien des choses sur le passé, l’éditeur Maurice Girodias, Pola Hubersen, femme au séduisant mystère, d’autres encore qui remontent à la surface de la mémoire et qui parfois suscitent la frayeur, comme cette sorte de « revenant » qui attend la danseuse sur son chemin.
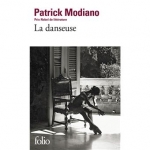 Livre poids plume (95 pages) mais d’une incontestable densité, due à la concentration des souvenirs et à la condensation du temps (« Et soudain, ce 8 janvier 2023, il me sembla que cela n’avait plus aucune importance. Ni la danseuse ni Pierre n’appartenaient au passé mais à un présent éternel. »), La danseuse est un hymne à la légèreté, surtout celle du personnage principal qui pourrait bien « s’envoler, traverser les murs et les plafonds et déboucher à l’air libre, sur le boulevard. »
Livre poids plume (95 pages) mais d’une incontestable densité, due à la concentration des souvenirs et à la condensation du temps (« Et soudain, ce 8 janvier 2023, il me sembla que cela n’avait plus aucune importance. Ni la danseuse ni Pierre n’appartenaient au passé mais à un présent éternel. »), La danseuse est un hymne à la légèreté, surtout celle du personnage principal qui pourrait bien « s’envoler, traverser les murs et les plafonds et déboucher à l’air libre, sur le boulevard. »
Cette légèreté est contagieuse ; du moins la recherche de cette légèreté, dans l’écriture même. Patrick Modiano semble livrer ici une sorte de testament littéraire calqué sur les conseils de Kniaseff, le professeur de danse : « Il fallait d’abord que le corps s’épuise pour atteindre à la légèreté et à la fluidité des mouvements des jambes et des bras. […] Alors on éprouvait un soulagement, celui d’être libéré des lois de la pesanteur, comme dans les rêves où votre corps flotte dans l’air ou dans le vide. » Appliquez cela à l’écriture, et vous aurez le bref roman, ou plutôt le long poème d’un auteur qui tente d’épuiser toutes les ressources de l’esprit et, malgré les apparences, ne laisse rien au hasard.
Jean-Pierre Longre
10:46 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrick modiano, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/03/2025
Maître de la nouvelle
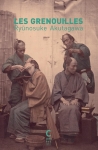 Ryūnosuke Akutagawa, Les Grenouilles, traduit du japonais par Catherine Ancelot et Silvain Chupin, Cambourakis, 2024
Ryūnosuke Akutagawa, Les Grenouilles, traduit du japonais par Catherine Ancelot et Silvain Chupin, Cambourakis, 2024
Parmi les nouvelles que présente ce recueil, entre réalisme et fantastique, entre comique et dramatique, on a le choix. Histoires malicieuses, mystérieuses, pathétiques, poétiques, soliloques ou dialogues, souvenirs d’enfance ou d’amour, la gamme des registres et des thèmes développée au fil des ces huit textes est suffisamment variée pour qu’on ne s’ennuie jamais.
Écrits entre 1915 et 1923, ils s’inscrivent d’une part dans une tradition liée aux légendes, aux coutumes et à la spiritualité japonaises, d’autre part dans une modernité faisant appel à l’absurde, au paradoxe, à l’étrange et à la philosophie. C’est tout l’art de Ryūnosuke Akutagawa qui, né en 1892 et mort par suicide en 1927, est considéré comme « le plus grand nouvelliste du Japon ». Il faut dire que ses récits sont composés avec un art consommé du détail significatif, de la progression habilement menée jusqu’au dénouement discret ou inattendu, poétique ou tragique, parfois tout cela à la fois.
C’est par exemple une femme s’apprêtant à mourir : « Kesa souffle la lampe. Bientôt, un léger bruit dans la pénombre alors que le volet rabattu sous la galerie se soulève. Dans le même temps, un pâle rayon de lune vient éclairer la scène. » Rien de plus, rien d’inutile. Ou un personnage parti explorer le fond d’une mare : « Le voilà, ce monde mystérieux auquel j’aspirais. Tout en nourrissant ces réflexions, mon cadavre resta longtemps à contempler le nénuphar, comme un joyau au-dessus de moi. » La mort et la poésie ne se contredisent pas. Et encore : « Si les serpents ne mangeaient pas les grenouilles, elles se multiplieraient. De sorte que l’étang – le monde – deviendrait à terme trop petit. C’est pourquoi les serpents viennent nous manger. Dis-toi que la grenouille qui s’est fait manger a été sacrifiée pour le bonheur de la majorité. Parfaitement. Même les serpents sont là pour nous, les grenouilles. Toutes les choses de ce monde, de la première à la dernière, existent pour les grenouilles. Que Dieu soit loué ! » Voilà la réponse que j’ai entendue dans la bouche d’une grenouille, une ancienne à ce qu’il me semble. » Une terrible leçon pour l’humanité, qui justifie le titre du livre.
Jean-Pierre Longre
19:07 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, japon, ryūnosuke akutagawa, catherine ancelot et silvain chupin, cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/03/2025
Scènes de la vie d’aujourd’hui
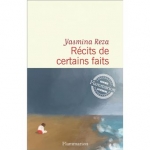 Yasmina Reza, Récits de certains faits, Flammarion, 2024
Yasmina Reza, Récits de certains faits, Flammarion, 2024
On passe sans transition du tribunal correctionnel de Paris à une fin de journée vénitienne, du souvenir d’amis disparus à la garde mouvementée de la petite-fille, de l’évocation d’une employée de maison qu’on appelait Mademoiselle à la Cour d’assises de Nantes… Quels sont les rapports, se demande-t-on, entre ces « faits » relatés sur le ton de l'objectivité ? Comment et pourquoi Yasmina Reza les a-t-elle choisis ? On pourrait être décontenancé devant ce puzzle, et pourtant il y a plaisir et satisfaction à en découvrir les différents éléments.
On s’y retrouve, car ces « faits » sont tous puisés dans la réalité personnelle ou publique, fidèles reflets de la vie courante. Il y a les rencontres de hasard, telle celle de cette petite footballeuse qui triche en jouant avec son père sur la plage du lido ou celle de cet « ascète », « un homme encore jeune de type oriental, d’une grande beauté, qui vit dans la rue » ; il y a les personnes aimées, les membres de la famille, les morts aussi (« Chez les morts, j’ai pas mal d’amis »)… Et il y a, sorte de fil conducteur, les scènes puisées dans la fréquentation des tribunaux, où on assiste avec l’autrice à des jugements d’anonymes – par exemple pour des violences conjugales, de l’escroquerie, voire des meurtres –, ou de personnages publics comme Nicolas Sarkozy, l’animateur Jean-Marc Morandini (pour « corruption de mineurs »), le gangster britannique Robert Dawes (qui nie tout, se prétendant « blanc comme neige »), le prédicateur islamiste Tariq Ramadan (« pour viol et violence sexuelle »), ou encore Jonathan Daval (pour le meurtre de sa femme, dont les parents ont étalé « leurs doléances et revendications hors tout cadre et toutes règles »)…
Le titre choisi par Yasmina Reza annonce des « faits », et c’est bien ce qu’il en est. Ces « faits », elle n’hésite pas à en parler à la première personne, témoin ou même actrice, dans une sorte de confrontation entre « je » et « eux ». Les « récits » se succèdent comme les brèves scènes d’une longue pièce de théâtre, au rythme de la vie, sans commentaires superflus. Ces « récits de certains faits » peuvent se lire comme des scènes de la vie individuelle, sorte de « Theatrum Mundi » d’ici et de maintenant. Yasmina Reza a l’habitude du théâtre, et elle en donne la preuve dans cet ouvrage, brillamment.
Jean-Pierre Longre
06:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, yasmina reza, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/02/2025
Suspense chez les témoins protégés
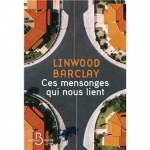 Linwood Barclay, Ces mensonges qui nous lient, traduit de l’anglais (Canada) par Renaud Morin, Belfond, 2025
Linwood Barclay, Ces mensonges qui nous lient, traduit de l’anglais (Canada) par Renaud Morin, Belfond, 2025
Jack se souvient et raconte : son père est parti un jour, définitivement semble-t-il, en lui disant : « Ton papa a tué des gens. » On apprend plus tard qu’il est allé vivre sous une nouvelle identité en tant que témoin protégé, car il a été à la solde d’un homme d’affaires véreux qui le chargeait des sales besognes – intimidations, menaces et meurtres – et aux foudres duquel il cherche à échapper.
Devenu écrivain au succès mitigé et cherchant à gagner sa vie en collaborant à des revues plutôt confidentielles, Jack est contacté par une certaine Gwen, U.S. Marshall s’occupant justement et comme par hasard de ces ex-criminels relevant du statut de témoins protégés, qui lui propose d’écrire contre bonne rémunération de fausses biographies de ces derniers afin de parfaire leur nouvelle personnalité en rapport avec leur nouvelle identité. Jack accepte un premier travail, non sans se poser des questions : « On ne m’avait pas donné beaucoup de grain à moudre. Mon premier sujet, d’après ce que m’avait dit Gwen, était de sexe masculin, blanc, et âgé de quarante ans. Par où commencer ? Quel genre d’existence voulais-je lui créer ? J’ignorais complètement ce qu’il avait fait jusqu’à maintenant – était-il boucher, boulanger, fabricant de bougies ? Et si, par hasard, l’histoire que je lui inventais était trop proche de son véritable passé ? Non, cela semblait improbable. »
Difficile de raconter la suite sans déflorer le suspense entretenu avec grande habileté par Linwood Barclay. Disons simplement que Jack a une petite amie journaliste qui va être impliquée de près dans le déroulement des événements, que l’U.S. Marshall Gwen et ses acolytes réservent des surprises de taille, que les victimes ne sont pas seulement celles du père de Jack, qui soit dit en passant n’a pas disparu pour toujours, que l’écrivain se retrouve avec deux pères, que l’on apprend à connaître le passé et le destin d’un certain nombre de personnages plus ou moins recommandables…
Thriller, roman d’action aux multiples rebondissements, récit à suspense, Ces mensonges qui nous lient est un bel et bon roman noir, qui ne se contente pas de relater une succession de faits inattendus et d’actions violentes. C’est aussi une captivante galerie de personnages qui, derrière leurs profils plus ou moins avérés de « bons » ou de « méchants », recèlent une épaisseur sociologique et psychologique qui les rend véritablement humains. Un vrai roman, donc, au sens plein du terme.
Jean-Pierre Longre
Linwood Barclay sera présent aux « Quais du Polar » à Lyon du 4 au 6 avril 2025: https://quaisdupolar.com/#latest-posts
21:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, thriller, anglophone, linwood barclay, renaud morin, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/02/2025
De l’art du balayage en musique
 Alain Gerber, Le destin inattendu de la tapette à mouches, Frémeaux & associés, 2025
Alain Gerber, Le destin inattendu de la tapette à mouches, Frémeaux & associés, 2025
Il y a un an (janvier 2024), Alain Gerber nous gratifiait d’une belle et indispensable « autobiographie de la batterie de jazz » (voir ici) en nous racontant l’histoire de Deux petits bouts de bois, de l’art desquels il est à la fois expert et pratiquant éclairé. Maintenant, il célèbre les « balayeurs célestes du jazz avec Shelly Manne en point de comparaison », ce grand « Sheldon Manne [qui] fut un des batteurs les plus « littéraires » de l’histoire de l’instrument : un homme recherchant en permanence l’équilibre instable, mais jamais perdu, entre les différentes valeurs des éléments mis en jeu, entre les nuances dynamiques, entre les couleurs sonores, entre les couleurs du temps , entre la distension et la contraction du temps qui passe, l’instinct de vie et son contraire. »
Affirmons-le sans réserve, nul mieux qu’Alain Gerber ne sait lier l’expérience personnelle et le savoir encyclopédique. Ici comme ailleurs, il commence par évoquer un souvenir, celui de l’acquisition de sa première batterie : caisse claire, baguettes, mailloches et… balais. « Depuis cette époque, je porte un amour fou à l’art des balais, ainsi qu’à ceux qui l’ont inventé de toutes pièces et fait évoluer de manière spectaculaire depuis la fin des années vingt ; si dévorante est cette passion qu’elle s’étend aux instruments eux-mêmes. » Et depuis la même époque, il a tout appris des « brosses », de leur pratique et de leurs virtuoses, et il nous en fait tout connaître.
N'oublions pas qu’Alain Gerber est un écrivain, l’un de ceux qui, sans jamais se hausser du col, font partie de l’élite des stylistes, et son érudition musicale ne l’empêche pas de nous faire profiter de sa pratique littéraire, en nous livrant par exemple « une réflexion au passage : en littérature, j’ai toujours penché en faveur des écrivains soucieux d’entretenir une pulsation dans leurs périodes, leurs paragraphes, leurs chapitres. Et d’abord dans chacune de leurs phrases. » Pour lui « c’est affaire de métrique », de « ponctuation » et, « métaphoriquement cette fois, d’accentuation et de nuances dynamiques. » Ou encore de considérations à la fois larges et acérées : « L’un des signes très sûrs de décivilisation est le renoncement massif à l’ironie au profit de la croyance. Il s’agit ici de l’ironie à usage interne et de la croyance sans condition, telle la capitulation du même nom. Je n’ai jamais eu l’âme d’un inconditionnel, et cela ne s’est pas arrangé avec le temps. Le statut de groupie n’aura exercé sur moi qu’une timide attirance. » Un dernier extrait, en guise d’encouragements : « Quels que soient votre âge, votre sexe, votre expérience et votre culture, votre morphologie, vos capacités physiques, votre bagage technique, votre projet esthétique, soyez assuré qu’il existe, ou qu’il existera, la paire de balais la mieux adaptée à votre personnalité. Celle qui va répondre à vos besoins comme si elle avait parié sur vous pour justifier son existence. » Voilà qui donne vie à une paire d’objets apparemment bien anodins mais ô combien précieux. Martine Palmé, agent des plus grands, l’a écrit : ce livre est un « véritable trésor. »
Jean-Pierre Longre
Une autre parution récente chez Frémeaux & associés: Stéphane Carini, Les alchimies discrètes d'Henri Crolla. Accompagné de deux CD.
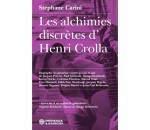 Guitariste virtuose et figure emblématique du jazz français, Henri Crolla (1920-1960) a laissé une empreinte indélébile sur la musique de son époque. Fils d’immigrés napolitains, il s’impose comme l’un des guitaristes les plus talentueux de sa génération. Malheureusement, sa carrière fulgurante a été interrompue par sa mort prématurée en 1960. L’anthologie de Stéphane Carini rend justice à l’oeuvre d’un artiste injustement oublié et nous invite à redécouvrir la richesse inouïe et la diversité de son répertoire : du jazz à la chanson, de la poésie aux musiques de film.
Guitariste virtuose et figure emblématique du jazz français, Henri Crolla (1920-1960) a laissé une empreinte indélébile sur la musique de son époque. Fils d’immigrés napolitains, il s’impose comme l’un des guitaristes les plus talentueux de sa génération. Malheureusement, sa carrière fulgurante a été interrompue par sa mort prématurée en 1960. L’anthologie de Stéphane Carini rend justice à l’oeuvre d’un artiste injustement oublié et nous invite à redécouvrir la richesse inouïe et la diversité de son répertoire : du jazz à la chanson, de la poésie aux musiques de film.
Patrick FRÉMEAUX
« APRÈS LUI, IL N’Y A PLUS DE GUITARISTES »
NAGUINE REINHARDT (ÉPOUSE DE DJANGO REINHARDT)
20:15 Publié dans Essai, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, jazz, alain gerber, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/02/2025
« Je parle d’homme à homme »
 Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu / Verdier Poche, 2006, rééd. 2025
Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu / Verdier Poche, 2006, rééd. 2025
Né à Iaşi (Roumanie) en 1898, mort à Auschwitz en 1944, Benjamin Wechsler, devenu ensuite B. Fundoianu puis Benjamin Fondane, manifesta très tôt son intérêt pour la littérature française en publiant en roumain, en 1921, Images et livres de France, contenant des textes sur Baudelaire, Mallarmé, Gide et quelques autres, préfigurant des essais à venir publiés à Paris, où il s’installe dès 1923. « Importateur de culture européenne », selon la formule de Petre Raileanu, il joue un rôle décisif d’une part dans les mouvements de va-et-vient entre l’Est et l’Ouest, d’autre part dans la vie culturelle française et européenne. « De Dada à l’existentialisme, Benjamin Fondane a […] parcouru un long chemin avec la pensée de son temps. Témoin lucide et exigeant, il l’a accompagnée et bien souvent précédée, au risque de ne pas être entendu par ses contemporains », a écrit Michel Carassou.
Penseur, critique, homme de théâtre, Fondane fut aussi – et surtout, devrions-nous dire – un grand poète de langue française. La réunion et la réédition chez Verdier de ces cinq livres de poèmes est salutaire, et d’ailleurs conforme au désir exprimé par le poète dans une lettre envoyée à sa femme depuis le camp de Drancy, avant de partir vers la mort.
Cinq livres, donc : Ulysse (publié en 1933, remanié jusqu’en 1944), Le mal des fantômes (écrit en 1942-1943, resté inachevé), Titanic (1937), Exode (écrit vers 1934, complété en 1942 ou 1943), Au temps du poème (écrit entre 1940 et 1944).
En septembre 1943, Fondane écrivait :
Je pense au poète vieilli.
Voyez : il écrit un poème.
En a-t-il écrit, des poèmes !
Mais celui-là c’est le dernier.
Cette strophe, tirée d’un poème inédit publié par Monique Jutrin dans Poèmes retrouvés, est pour ainsi dire prémonitoire et n’est pas sans annoncer ce que dit Henri Meschonnic dans son « retour du fantôme » liminaire : « Benjamin Fondane s’écrit d’avance mort ». Mais aussi – toujours Henri Meschonnic – « pas un n’a écrit la révolte et le goût de vivre mêlé au sens de la mort comme Benjamin Fondane. Sa situation de fantôme lui-même y est sans doute pour quelque chose : un émigrant de la vie traqué sur les fleuves de Babylone ».
Ulysse / Fondane est le « Juif errant », celui qui se demande : « Est-ce arriver vraiment que d’arriver au port ? », celui qui, dans un perpétuel exode, chante l’Amérique et l’Argentine, et la mélancolie de l’exil :
Sur les fleuves de Babylone nous nous sommes assis et pleurâmes
que de fleuves déjà coulaient dans notre chair
que de fleuves futurs où nous allions pleurer
le visage couché sous l’eau,
celui qui interroge la légitimité du poème :
Quelle chanson chanterais-je sur une terre étrangère […]
car l’homme n’est pas chez lui sur cette terre.
L’émigrant chante, navigue et se souvient de ses origines :
Pourquoi l’océan me fait-il penser à ces plaines de Bessarabie
on y marchait longtemps et c’était long la vie.
Et s’il aspire au port, c’est sans illusions :
Nous ne parlons aucune langue
nous ne sommes d’aucun pays
notre terre c’est ce qui tangue
notre havre c’est le roulis.
De la fuite incessante à la révolte et à la résistance, le mouvement est naturel, comme l’avoue le « Non lieu » écrit par Fondane en guise de présentation du « Mal des fantômes » : « J’ai voulu écrire ces poèmes dans le goût dévorant de mon siècle. Si j’ai résisté, d’où m’est venue cette résistance ? »
La poésie de Benjamin Fondane est de toutes dimensions. Poésie du mythe et du sacré (L’Odyssée, La Bible…), poésie de l’amour pour « la frêle bergère » et « la fiancée promise et noire du Cantique des Cantiques », elle est avant tout poésie humaine :
Je parle d’homme à homme,
avec le peu en moi qui demeure de l’homme,
avec le peu de voix qui me reste au gosier.
Fondane, c’est un homme qui tente de se dire avec son universalité, ses contradictions, ses imperfections, dont le chant peut n’être « qu’un cri, qu’on ne peut pas mettre dans un poème parfait », mais qui tente de se donner « un visage d’homme, tout simplement ».
Jean-Pierre Longre
Sur Benjamin Fondane, voir aussi CECI et CELA
 Cahiers Benjamin Fondane n° 27, 2024. « L'art en questionS, années 20 ». Édition établie par Agnès Lhermitte et Serge Nicolas avec la collaboration de Monique Jutrin. Faux Traité d’esthétique, inédit de 1925.
Cahiers Benjamin Fondane n° 27, 2024. « L'art en questionS, années 20 ». Édition établie par Agnès Lhermitte et Serge Nicolas avec la collaboration de Monique Jutrin. Faux Traité d’esthétique, inédit de 1925.
Extrait de l’introduction par Agnès Lhermitte :
« En 1938, Fondane réutilise le titre de Faux Traité d’esthétique pour publier un essai qui a cette fois pour sous-titre « Essai sur la crise de réalité ». Il ne s’agit pas pour autant d’une reprise du manuscrit de 1925. Treize années ont passé, le contexte culturel a changé. Le jeune émigré récent encore incertain de ses orientations s’est nourri de nouvelles lectures. Il est devenu un poète maître de son art et un philosophe résolument existentiel qui aura approfondi et affermi sa pensée grâce à la rencontre de deux maîtres à penser. Chez Léon Chestov, qui guide ses lectures, il trouve la vision existentielle de la duplicité tragique de soi ; chez Lucien Lévy-Bruhl, la pensée de participation des primitifs, qui lui offre une voie d’accès au réel. Le sous-titre confirme la teneur nettement philosophique du nouvel essai.
Fondane y poursuit une réflexion qui récuse les problématiques esthétiques stricto sensu pour s’attaquer de front à la question primordiale : Pourquoi l’art ? Pourquoi justement l’art chez le seul animal raisonnable ? Il se concentre alors sur la poésie, son propre champ d’action et d’interrogation, dans un mouvement inverse de celui qui, en 1925, lui faisait élargir à l’art la crise de la littérature étudiée par Rivière. Bien des questions abordées alors, restées sans réponse ou devenues obsolètes à ses yeux, comme l’enracinement socio-historique de l’art ou la forme, encore liée à l’ordre, à la raison, auront été évacuées. Mais l’idée essentielle, déjà présente dans le manuscrit, d’un art vivant, sera devenue le principe du nouveau traité, présenté comme la mise au point vitale d’un enjeu existentiel, et où la poésie, expérience mystique du réel, se confond avec la vie de l’homme. »
Sommaire
Introduction, Agnès Lhermitte
Faux Traité d’esthétique (1925)
- La Crise du Concept de l’Art
- Erreur de l’art moderne « en tant que progrès »
- L’Idée de l’originalité
- « Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison » : (Blaise Pascal)
- Règne de l’homme théorique
- L’Art autonome
- De Dada au surréalisme – ou de « l’idiotie pure » au suicide
Textes annexes
- Préface du Faux Traité d’esthétique
- Foi et dogme
- Le Concept du beau
- Faux concepts de l’art classique
Textes complémentaires
- « Faut-il brûler le Louvre ? »
- Réflexions sur le spectacle
Études
- L’Art en question : un premier cheminement philosophique, Serge Nicolas
- Une pensée en images, Agnès Lhermitte
19:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, essai, francophone, roumanie, benjamin fondane, patrice beray, michel carassou, monique jutrin, henri meschonnic, agnès lhermitte, serge nicolas, non lieu, verdier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2025
Maternelle et tenace
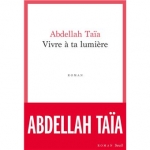 Lire, relire... Abdellah Taïa, Vivre à ta lumière, Le Seuil, 2022, Points 2025
Lire, relire... Abdellah Taïa, Vivre à ta lumière, Le Seuil, 2022, Points 2025
Abdellah Taïa joue franc jeu, dès la dédicace : « Pour ma mère : M’Barka Allai (1930-2010). Ce livre vient entièrement de toi. Son héroïne, Malika, parle et crie avec ta voix. » Histoire vraie, donc, mais devenue roman par le truchement des mots d’un écrivain donnant la parole à sa protagoniste qui monologue, se raconte, raconte les siens, ses proches et tout compte fait la vie du Maroc (d’un certain Maroc) de la fin du XXème siècle.
Une autobiographie en trois temps. À Béni Mellal, elle a trouvé toute jeune l’amour d’Allal, qu’elle épouse avec la bénédiction de son père et le consentement de sa belle-famille, mais qui part faire la guerre des Français en Indochine, pensant gagner suffisamment d’argent : « Un an ou deux de guerre et me voilà riche, un peu riche. » Il n’en reviendra pas, et Malika sera chassée par ses beaux-parents, qui avaient pourtant promis de la traiter comme leur fille.
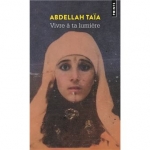 Nous la retrouvons à Rabat, bien des années plus tard, avec son second mari, un homme « gentil » qui l’a aidée à sortir de son complet dénuement et lui a fait de nombreux enfants. Mais c’est elle qui mène son monde, prend les initiatives et défend sa fille Khadija contre la mainmise de Monique, une Française qui voudrait prendre Khadija à son service. Non, Malika rêve que sa fille épouse un homme puissant et riche, un de ceux qui fréquentent le palais royal tout proche. Le destin en ira autrement.
Nous la retrouvons à Rabat, bien des années plus tard, avec son second mari, un homme « gentil » qui l’a aidée à sortir de son complet dénuement et lui a fait de nombreux enfants. Mais c’est elle qui mène son monde, prend les initiatives et défend sa fille Khadija contre la mainmise de Monique, une Française qui voudrait prendre Khadija à son service. Non, Malika rêve que sa fille épouse un homme puissant et riche, un de ceux qui fréquentent le palais royal tout proche. Le destin en ira autrement.
Le troisième épisode, qui se situe à Salé, est une confrontation entre Malika et Jaâfar, un jeune voisin tout juste sorti de prison qui la menace d’un couteau pour voler son argent. Elle lui tient tête, lui parle d’Ahmed, son fils parti en France qui ne donne plus de nouvelles. Impitoyable et maternelle, elle résiste au délinquant et au récit sordide de la vie des prisonniers marocains.
Malika est ce que d’autres appelleraient une « femme puissante ». Mais sa puissance n’est ni politique, même si d’importantes digressions évoquent Ben Barka et le roi Hassan II, ni économique, puisque sa famille vit dans les conditions les plus précaires, même si elle fait tout pour lui construire une maison et la nourrir. « Des années tous les onze dans une seule pièce. Onze ! J’ai économisé centime après centime. J’ai économisé tout ce que je pouvais. Certains mois, je ne leur préparais qu’un seul repas par jour. Ils râlaient. Ils criaient. Nous avons faim ! Nous avons faim, maman ! Je ne pouvais rien faire d’autre. Il fallait économiser encore et encore. Ils trouvaient tous que j’étais devenue impitoyable. Ce n’était pas grave. Un jour, ils comprendraient les sacrifices que j’avais faits pour eux. Les humiliations que j’avais subies à cause d’eux, pour leur donner un toit, une maison. Une vraie maison. » Quoi de plus parlant que ce qu’écrit Abdellah Taïa de cette mère lumineuse, volontaire, tenace ? « C’est Malika qui parle ici. Tout le temps. Elle raconte avec rage les stratégies pour échapper aux injustices de l’Histoire. Survivre. Avoir une petite place. » Son fils, par la magie de la littérature, lui a donné une vraie place.
Rappel: le récent livre du même auteur, Les Bastion des Larmes
Jean-Pierre Longre
10:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, maroc, abdellah taïa, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/02/2025
Une jeunesse prometteuse : Le Persil a 20 ans
 Le Persil Journal, n° 222-223, juillet 2024 et 224-225-226-227-228, décembre 2024.
Le Persil Journal, n° 222-223, juillet 2024 et 224-225-226-227-228, décembre 2024.
En juillet 2024, Marius Daniel Popescu continuait à relater dans la suite du Cri du barbeau les anecdotes qui jalonnent sa vie passée et sa vie présente : « Tu es à la fois dans ton pays d’ici et ton pays de là-bas […], les mots naissent sans parents sur la feuille, ta mémoire les baptise encore et encore. » Ces mots lui servent à raconter par exemple la visite récente du plombier et sa conversation avec lui, ou les parties de pêche faites dans son enfance avec d’autres garçons… d’autres épisodes encore…
Quelques mois plus tard, paraît un numéro exceptionnel, celui des 20 ans de ce « journal qui pousse la littérature dans nos vies », « avec des textes et des images de plus de 1200 personnes en 228 numéros répartis en 99 publications et 3636 pages… » Avant des inédits de Heike Fiedler, Jean-Christophe Contini et Quentin Moron, avant l’historique de l’Association des Amis du Journal Le Persil, grâce à qui tout cela peut se faire, se multiplient les témoignages, à commencer par les débuts artisanaux racontés par celles, compagne et filles, qui ont accompagné Marius Daniel Popescu dans la création du journal. « En rentrant du travail, encore habillé de son uniforme des chauffeurs de bus, il a posé deux feuilles A3 sur la table pour y coller en lettres capitales LE PERSIL. Après avoir découpé et scotché les textes qu’il avait écrits, il les a ajustés à la mise en page. » C’est ainsi que tout a continué, et tous les souvenirs qui s’accumulent au fil des pages suivantes sont autant de preuves de l’obstination de son créateur à garder l’esprit et la manière des débuts.
Il est écrit dans ce numéro que Le Persil est d’une constante audace. Cette audace, c’est celle d’un accueil tous azimuts, d’une hospitalité littéraire sans discrimination ni censure, sans considérations de notoriété ni souci de gloriole. Les autrices et auteurs, néophytes ou expérimentés, disposent à leur guise des feuilles épanouies d’un journal obstinément « inédit », c’est-à-dire, avec tous les risques que cela comporte mais aussi les chances ainsi données, composé d’écrits toujours nouveaux. Pas de commentaires superflus, pas de prétentions analytiques, pas d’apparats critiques – rien que des textes littéraires (et aussi des illustrations) dans toute leur originalité, avec leurs tâtonnements inquiets ou leur tranquille maturité. Et si la pluralité des contributeurs et la diversité des styles favorisent la qualité et l’intérêt des publications, parfois une livraison est consacrée à un seul écrivain. Avec ténacité, brillamment, savoureusement, c’est de la belle et bonne lecture que nous offre Marius Daniel Popescu, dont l’origine roumaine se marie parfaitement avec l’esprit romand pour enrichir, avec une singularité parfois déroutante, toujours séduisante, le patrimoine littéraire européen.
Pour qui veut aller plus loin, les pages centrales offrent les listes bien instructives de tous les numéros publiés (dates et thèmes principaux) et de tous les contributeurs. Et une nouveauté : le site internet qui donne tous les renseignements possibles. Voir ci-dessous. Un Persil à consommer et un site à consulter sans modération…
Jean-Pierre Longre
19:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, le persil, francophone, suisse, roumanie, marius daniel popescu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/02/2025
La force des mots
 Ana Blandiana, Poèmes résistants, traduits du roumain par Hélène Lenz, édition bilingue révisée et présentée par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2024
Ana Blandiana, Poèmes résistants, traduits du roumain par Hélène Lenz, édition bilingue révisée et présentée par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2024
Comment résister à l’oppression ? Ouvertement, en s’exposant à la violence de la répression ; par l’exil, en espérant un avenir meilleur ; en luttant par les mots, en prose ou en poésie. Ana Blandiana a résisté de l’intérieur, au risque, à plusieurs reprises, de se voir interdite de publication, mais avec une notoriété de plus en plus grande dans son pays. Et si, dans la présentation de Poèmes résistants, Jean Poncet a raison d’écrire que « le combat de Blandiana fut toujours plus éthique que politique », il fait sentir à juste titre que ce combat est avant tout poétique. Ce recueil, qui donne à lire les textes en roumain et leur traduction en français par Hélène Lenz, reprend des poèmes parus en 1984 (quatre, publiés dans la revue Amfiteatru), 1985 (Étoile de proie) et 1990 (L’architecture des vagues, livre terminé en 1987 mais publié après la chute de Ceauşescu, et contenant des poèmes à propos desquels l’autrice écrivit significativement le 28 décembre 1989 : « Je les dédie à ceux qui, en mourant, ont rendu possible, à côté de bien d’autres choses, le retour de la poésie pour la poésie. »)
L’unité de l’ensemble est assurée par une tonalité commune qui laisse apparemment le pessimisme l’emporter sur l’espoir, la révolte sur la sérénité, les questionnements sans réponses sur les certitudes, et qui met en avant les hésitations concernant les formes de la résistance : « Le pouvoir de choisir / Entre être impliqué / Et être seul. / Le courage d’opter / Entre la souffrance du hurlement / Et celle du silence. /La force de décider / Entre la fuite au dehors / Et la fuite à l’intérieur. » L’une de ces formes est aussi l’ironie, lorsque la poésie s’écrie, en réponse à l’officiel « On doit tout faire pour réussir » : « Nous avons tout » : « Feuilles, mots, larmes, / Boîtes d’allumettes, chats, / Tramways quelquefois, queues pour la farine, / charançons, bouteilles vides, discours […] ».
Tout compte fait, l’unité est assurée par l’art que possède et pratique Ana Blandiana : celui de tout métamorphoser en poésie, en persistant « à répartir / les signes, les mots, les lettres… » L’œil se transforme en étoile, « Les atomes se changent en sable, / Le sable forme des cailloux, / Les cailloux deviennent des lettres. / Quant aux lettres, elles germent puis donnent des bourgeons, / Qui font des moissons de mots. » Et cette poésie, finalement, « Arrachant au chaos / La vague périssant après la vague », peut laisser entrevoir l’espoir : « À travers les yeux des menottes / Il y a le futur du verbe être. » Voilà le miracle des mots apprivoisés par Ana Blandiana. Comment résister ? Par la poésie.
Jean-Pierre Longre
http://jplongre.hautetfort.com/tag/ana+blandiana
Voir aussi: https://www.blackheraldpress.com/ma-patrie-a4-1
10:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, roumanie, ana blandiana, hélène lenz, jean poncet, jacques andré éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/01/2025
Confrontations et affection
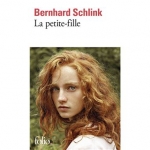 Bernhard Schlink, La petite-fille, traduit de l’allemand par Bernard Lortholary, Gallimard, 2023, Folio, 2024
Bernhard Schlink, La petite-fille, traduit de l’allemand par Bernard Lortholary, Gallimard, 2023, Folio, 2024
En 1964, à l’époque où l’Allemagne était divisée en deux blocs, Kaspar, venu épisodiquement de l’Ouest, et Birgit, jeune femme de l’Est, s’éprennent l’un de l’autre et prévoient de vivre ensemble à Berlin Ouest. Ce que ne sait pas Kaspar, c’est que Birgit est enceinte d’un amoureux éphémère, et qu’avant de partir elle accouche en secret d’une fille qu’elle décide d’abandonner, faute de pouvoir lui faire passer avec elle le rideau de fer, et aussi par rejet de son géniteur. Cette fille cachée, elle ne la reverra jamais, ne connaîtra pas son destin. Mais une mère ne vit pas impunément ce genre de situation, et ses relations avec Kaspar vont s’en ressentir : « Je ne savais pas le mal que fait à long terme le silence qu’on garde. Si je l’avais su, si j’avais pensé en termes de longues années – est-ce que cela aurait changé quelque chose ? », écrit-elle dans son journal secret, qu’elle compose comme un roman.
Ce journal, Kaspar le découvre après la mort prématurée de Birgit, qui a auparavant tenté de fuir ses sombres pensées et d’enfouir sa culpabilité en se réfugiant dans des activités sans suite, en partant un certain temps en Inde, en sombrant dans l’alcool… Kaspar apprend donc l’existence de la fille de Birgit, et décide d’aller à sa recherche. Il découvre qu’elle s’appelle Svenja, qu’elle a été élevée par son père biologique et son épouse, qu’elle vit avec son mari dans un village de l’Est, sorte de communauté néo-nazie qui ne cherche qu’à glorifier l’Allemagne blanche qu’il faudrait débarrasser des Juifs et des immigrés ; le couple a une fille adolescente, Singur, elle-même embrigadée dans l’extrémisme nationaliste. En échange de l’héritage de Birgit, Svenja et son mari acceptent de confier Singur à Kaspar pendant les vacances scolaires.
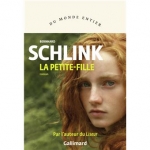 Alors, entre le septuagénaire, libraire aux idées libérales et progressistes, et la jeune fille endoctrinée mais prête à s’ouvrir à diverses connaissances et aux discussions, s’engage une série d’échanges parfois difficiles, mais affectueux. Kaspar ne veut pas brusquer Singur, ne veut pas lui laisser croire qu’il méprise ses idées et celles de ses parents. Délicatement, il la fait accéder à sa propre culture en l’emmenant au concert, au musée, en la faisant travailler à la librairie où elle découvre des livres qu’elle ne connaissait pas ; et elle se passionne pour la musique, prend des cours de piano, une heure tous les matins chaque fois qu’elle séjourne à Berlin chez celui qu’elle appelle ouvertement et naturellement « Grand-Père », et qui s’émerveille des progrès rapides qu’elle fait en jouant notamment Bach.
Alors, entre le septuagénaire, libraire aux idées libérales et progressistes, et la jeune fille endoctrinée mais prête à s’ouvrir à diverses connaissances et aux discussions, s’engage une série d’échanges parfois difficiles, mais affectueux. Kaspar ne veut pas brusquer Singur, ne veut pas lui laisser croire qu’il méprise ses idées et celles de ses parents. Délicatement, il la fait accéder à sa propre culture en l’emmenant au concert, au musée, en la faisant travailler à la librairie où elle découvre des livres qu’elle ne connaissait pas ; et elle se passionne pour la musique, prend des cours de piano, une heure tous les matins chaque fois qu’elle séjourne à Berlin chez celui qu’elle appelle ouvertement et naturellement « Grand-Père », et qui s’émerveille des progrès rapides qu’elle fait en jouant notamment Bach.
Une sorte de rivalité s’installe entre Kaspar et les parents de Singur, qui voient d’un mauvais œil l'influence qu’il a sur elle. Mais en a-t-il vraiment ? « Il lui avait fait une place dans son cœur – mais à condition qu’elle abjure son monde et qu’elle trouve accès au sien ? Non, il ne voulait pas aimer ainsi. Et comment pouvait-il penser, ne fût-ce qu’un instant, que sa personne, sa présence, son influence pourraient corriger en quelques semaines ce qui avait mal tourné pendant quinze ans ? Quelle prétention, quelle impatience ! » Le destin de Singur ne sera pas forcément celui que son « Grand-Père » et ses parents attendaient, mais il sera représentatif de celui d’une certaine jeunesse. Le roman de Bernhard Schlink, à la fois dur et émouvant, entraîne, à partir d’un exemple particulier, une réflexion sur l’histoire contemporaine de l’Allemagne, plus largement sur celle de l’Europe et, au vu de son état actuel, sur celle du monde.
Jean-Pierre Longre
19:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, histoire, allemagne, bernhard schlink, bernard lortholary, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

